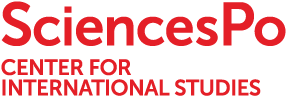Christian Milelli
The « new economy » in South Korea rhymes with the Internet. In 2003, the “land of morning calm” has actually become the most connected country in the world. The present study tackles this phenomenon from a number of angles. The Internet is not only considered as a physical network but a lever of transformation of the country’s economic and social life. Although the role of the state has been decisive and remains focal, it is not enough to explain the extreme rapidity with which the new electronic medium spread, which is due to a broad range of causes. The Korean experience differs from former ones in that it extends well beyond the market sphere (e-commerce) to areas such as education, volunteer associations and even politics. The emergence of a national dimension constitutes another characteristic that at first seems paradoxical, since the Internet is so universal in scope. Yet observation of the evolution of Internet traffic on the national level confirms this trend. South Korea is far from an exceptional case in Asia, but the country has taken the lead over its neighbors, becoming a new “model.” Beyond these singular features, the Korean experience in the use of the Internet again demonstrates that a global “information revolution” – in other words, a process that is quickly reshaping the material bases of an entire society – is underway.
Sébastien Colin
Depuis la reprise de leurs pourparlers au milieu des années quatre-vingt, les relations entre la Chine et la Russie – qui était encore l'Union soviétique lors de cette relance – sont particulièrement dynamiques. Sur le plan international, les deux pays possèdent en effet plusieurs points de vue qui convergent. Ces préoccupations communes ont abouti à la signature d'un partenariat stratégique en 1997, puis à celle d'un nouveau traité d'amitié en 2001. La complémentarité qui règne entre les deux pays dans les secteurs de l'énergie et de l'armement rend également la coopération dynamique. Cependant, cette alliance n'est pas sans limites. Principalement visés par elle, les Etats-Unis ont largement les moyens de la court-circuiter, comme ils l’ont fait juste après les attentats du 11 septembre 2001. Dans le domaine de la coopération, l'intensité et la structure du commerce entre les deux pays sont également insuffisantes. L'évolution du commerce durant la décennie quatre-vingt-dix a été très irrégulière et marquée par une chute entre 1994 et 1996, dont les causes principales se situent à l'échelle locale, le long de la frontière sino-russe. Après avoir été dynamique entre 1988 et 1993, l'ouverture de la frontière a provoqué l'apparition de nouveaux problèmes comme l'immigration illégale chinoise dans les régions frontalières peu peuplées de la Russie. Si cette dernière a été très mal vécue par les populations locales russes, c'est surtout la question de la rétrocession de certains territoires à la Chine, lors de la démarcation frontalière entre 1993 et 1997, qui a radicalisé les esprits, paralysant la coopération frontalière. Les gouvernements russe et chinois sont intervenus activement pour essayer d'apporter des solutions à la plupart de ces problèmes, comme le montre l'épisode du programme Tumen. Depuis, les différentes autorités des deux pays tentent de relancer la coopération frontalière, mais il subsiste encore un certain nombre de problèmes, principalement d'ordre économique, qui varient selon les régions frontalières.
Sébastien Colin
Since the resumption of talks between China and Russia – still the Soviet Union when this occurred in the mid- 1980s, relations between the two countries have been particularly dynamic. On the international level, the two countries in fact share the same viewpoint on a number of issues. These mutual concerns led to the signing of a strategic partnership in 1997, then a new treaty of friendship in 2001. The complementarity between the two countries in the energy and arms sectors also stimulates cooperation. However, this alliance is not without its limits. The United States, its primary target, can easily short-circuit it, as it did just after the September 11, 2001 attacks. In the field of cooperation, the intensity and structure of trade between the two countries are both inadequate. The rise in trade during the 1990s was very uneven and marked by a drop between 1994 and 1996. The main causes of this are situated at the local echelon along the Chinese-Russian border. After the dynamism characteristic of the 1988-1993 period, the opening of the border triggered new problems, such as illegal Chinese immigration in the little-inhabited border zones of Russia. Although this trend caused friction among the local Russian population, it was mainly the retrocession of certain Russian territories to China when the border was demarcated between 1993 and 1997 that radicalized the inhabitants, paralyzing border cooperation. The Russian and Chinese government played an active role in attempting to resolve most of these disputes, as the Tumen program illustrated. Since then, the various authorities in the two countries have tried to revitalize border cooperation, but a number of problems remain that are mainly economic in nature and vary depending on the border region.
Frédéric Massé
Le conflit colombien est devenu en l’espace de quelques années un véritable « casse-tête » pour les Etats-Unis comme pour les Européens. Violations massives des droits de l’homme, déplacements forcés de population, trafic de drogue, terrorisme... La Colombie semble désormais incarner tous les problèmes sécuritaires d’aujourd’hui. Avec le lancement du Plan Colombie en 1999, les Etats-Unis ont considérablement renforcé leur aide à ce pays. Aujourd’hui, les Américains soutiennent activement le gouvernement d’Alvaro Uribe dans sa lutte contre les mouvements de guérillas désormais qualifiés de « narcoterroristes » et les rumeurs d’intervention armée reviennent régulièrement à l’ordre du jour. Longtemps restée en marge de la « tragédie colombienne », l’Europe semble quant à elle condamnée à jouer les seconds rôles. L’option militaire représentée par le Plan Colombie avait dégagé un espace politique que les Européens avaient commencé à occuper. Mais avec la rupture des négociations de paix, cet espace s’est rétréci et a peut-être même définitivement disparu. Face aux efforts américains pour monopoliser la gestion du conflit colombien, on voit en effet mal comment l’Union européenne pourrait revenir sur les devants de la scène dans cette région du monde qui reste le pré carré des Etats-Unis. D’autant que l’on n’entend plus guère de voix s’élever pour demander aux Européens de faire contrepoids aux Etats-Unis. Entre concurrence, recherche de complémentarité et incompréhension, le cas colombien est une nouvelle illustration de l’état des relations Europe-Etats-Unis.
Frédéric Massé
The conflict in Colombia has, in the space of a few years, become a real headache for the United States as well as for Europe. Countless human rights violations, forced population displacement, drug trafficking and terrorism make Colombia a textbook case for examining the entire range of security problems today. With the launching of Plan Colombia in 1999, the United States considerably increased its aid to the country. Today, the American administration actively supports Alvaro Uribe’s government in its fight against guerilla movements, labeled “narcoterrorists,” and rumors of armed intervention regularly resurface. Having long remained on the sidelines of the “Colombian tragedy,” Europe seems to be relegated to playing second fiddle. The military option represented by Plan Colombia had opened up a political spaced that the Europeans began to occupy. But with the break-off of peace negotiations, this space has shrunk and has maybe even disappeared for good. In the face of American efforts to monopolize management of the Colombian conflict, it is in fact hard to see how the European Union can return to the forefront in this area of the world that remains the United States’ preserve. All the more so since virtually no voices can be heard asking the Europeans to counterbalance the United States. The situation in Colombia is a new illustration of the state of U.S.-European relations today, between competition, a search for complementarity and a mutual lack of understanding.
Emmanuelle Le Texier
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, la visibilité nouvelle des Latinos en politique a fait parler du réveil d'un « géant endormi ». Le changement qualitatif de leur prise de parole politique, qu'il s'agisse des mobilisations contestataires durant les mouvements pour les droits civiques ou de la participation au système électoral, marque un tournant de l'intégration des Hispaniques dans la sphère publique américaine. Avec un nombre croissant d'électeurs, de candidats et d'élus, les Latinos sont sortis de l'ombre. Le rôle de plus en plus influent de groupes d'intérêt panethniques et les nouvelles opportunités de participation politique créées par le développement de stratégies transnationales contribuent à l'élaboration de ce nouveau cadre participatif. Pourtant, leur poids électoral et politique reste en deçà de l'importance démographique, économique, sociale et culturelle de ces quelque 35 millions d'individus qui forment plus de 12 % de la population américaine. Pour la majorité des minorités, les obstacles à l'accès au politique restent importants. Ils sont d'ordre structurel, mais aussi internes au groupe : aux divisions sur enjeux domestiques ou extérieurs, s'ajoutent des fragmentations selon l'origine nationale, le statut ou la génération. La nature singulière de l'immigration en provenance d'Amérique Latine, la continuité des flux migratoires et leur diversité, ravivent en permanence les divergences sur la stratégie de participation des Latinos au débat public. Elles mettent aussi en lumière le caractère fictif, à la fois fonctionnel et dysfonctionnel, de la catégorisation ethnique aux Etats-Unis. Instrument de participation, le carcan ethnique peut aussi s'avérer être un obstacle majeur à l'entrée en politique des minorités.
Emmanuelle Le Texier
Since the early nineteen-eighties, the new political visibility of Latinos has been referred to as the awakening of a “sleeping giant.” Their increased political expression, be it in the form of protest action during civil rights movements or electoral participation, marks a turning point in the integration of Hispanics in the American public sphere. With a growing number of voters, candidates and elected officials, Latinos have emerged on the political scene. The increasingly influential role of pan-ethnic interest groups and new opportunities for political participation created by the development of transnational networks have contributed to the elaboration of this new participative framework. Yet their electoral and political influence remains below the demographic, economic, social and cultural importance of these some 35 million individuals who make up over 12 percent of the U.S. population. Most of the minority groups still encounter major obstacles to political access. These are partly structural, but also internal to the group: not only is it divided over domestic or foreign issues, it is fragmented by national origin, status and generation. The singular nature of immigration from Latin America, the continuity of migratory flows and their diversity, all constantly rekindle divergences over what strategy Latinos should adopt for participating in the public debate. They also highlight the fictional, both functional and dysfunction, nature of ethnic categorization in the United States. The ethnic card may be an instrument of participation, but it can also prove to seriously fetter minorities’ entry into politics.
Ivan Crouzel
En Afrique du Sud, la transition négociée qui vise à la construction d’un ordre politique postapartheid a conduit à une transformation radicale de l’Etat. Un enjeu central de cette refondation était relatif à la forme territoriale du nouvel Etat. Les négociations constitutionnelles se sont traduites par la production d’un système hybride de type fédéral qui consacre un renforcement marqué de la sphère du gouvernement local, notamment pour en faire un contrepoids aux neuf provinces. Dans le même temps, un mode plus fluide de relations intergouvernementales a été introduit avec le principe du « gouvernement coopératif ». En rupture avec le système centralisé de l’apartheid, le gouvernement local est consolidé par un nouveau statut constitutionnel, qui lui garantit notamment une « part équitable » du revenu national. Il permet également la représentation des municipalités au niveau central à travers une organisation nationale du gouvernement local qui participe à différentes structures de relations intergouvernementales. Le nouvel espace d’autonomisation ainsi accordé au gouvernement local se heurte cependant à la pratique centralisatrice des relations intergouvernementales. Dans le contexte sud-africain, le gouvernement coopératif se révèle être un vecteur de consolidation du pouvoir national. Cette logique est également accentuée par la configuration du système de parti sud-africain. La position dominante de l’ANC à tous les échelons de gouvernement a ainsi un impact centralisateur sur la gestion des relations centre-périphérie. Pourtant, cette dynamique résulte en partie d’une centralisation « par défaut » liée à la faiblesse institutionnelle des gouvernements sub-nationaux. L’utilisation par les municipalités de leur nouvel espace constitutionnel dépend donc étroitement des capacités dont elles disposent, traduisant ainsi une dynamique d’autonomisation asymétrique. Faute de ressources propres, les municipalités rurales demeurent fortement dépendantes du gouvernement central. Au contraire, les métropoles parviennent à renforcer leur pouvoir et à se positionner en concurrentes de certaines provinces, devenant des acteurs centraux des relations intergouvernementales.
Ivan Crouzel
In South Africa, the transition negotiated in order to build a post-apartheid political order has brought about a deep-seated transformation of the state. A central issue of this radical reform had to do with the territorial arrangement of the new state. Constitutional negotiations resulted in a hybrid federal type of system that distinctly reinforced the power of local government, particularly to counterbalance that of the nine provinces. At the same time, a smoother form of intergovernmental relations was introduced with the concept of “cooperative government.” In contrast to the centralized system that held sway under apartheid, local government has been strengthened by a new constitutional status, which in particular guarantees an “equitable share” of the national revenue. It also ensures that municipalities are represented nationally through intergovernmental structures involving the participation of local governments. The new space of autonomization that local governments henceforth enjoy nevertheless comes up against the centralizing tendencies of intergovernmental relations. In South Africa, cooperative government has turned out to be a means of consolidating national power. The configuration of the South African political party system also plays up this rationale. The dominant position of the ANC at every level of government thus has a centralizing effect on the management of center-periphery relations. Yet this dynamic is partly the result of a centralization “by default” due to the institutional weakness of sub-national governments. The use local governments make of the new constitutional space granted to them greatly depends on their own capacities, thus producing an asymmetrical dynamic of autonomization. Without their own resources, rural municipalities remain highly dependent on the central government. On the contrary, metropolitan areas manage to strengthen their power and position themselves as competitors with certain provinces, thus becoming central actors in intergovernmental relations.
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
Olivier Cattaneo
Cette étude se propose de fournir toutes les clés nécessaires à la bonne compréhension du nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales lancé par les membres de l’Organisation mondiale du commerce, à Doha, le 14 novembre 2001. Elle présente d'abord les circonstances qui ont entouré et permis le lancement d’un nouveau cycle de négociations. En effet, après l’échec de la conférence ministérielle de Seattle, de sérieux doutes planaient sur la possibilité d’ouvrir de nouvelles négociations commerciales multilatérales. Néanmoins, différents facteurs, tels que l’amélioration des relations transatlantiques, la prise en compte des revendications des pays en développement et de la société civile, une meilleure préparation de la conférence et les événements du 11 septembre ont créé un contexte favorable à Doha. Elle décrit ensuite les caractéristiques et les enjeux du nouveau cycle de négociations. La lecture de la Déclaration de Doha est complexe, y compris pour les négociateurs eux-mêmes, tant ce texte recèle de compromis diplomatiques de dernière heure. L’organisation et les modalités pratiques des négociations sont également confuses et méritent quelques efforts de clarification. Cette étude présente donc, de manière synthétique, d’une part les différents sujets de négociations ainsi que leurs enjeux, et d’autre part l’organisation et les principales échéances des négociations. Elle analyse, enfin, l’état des lieux et les perspectives des négociations, sans entrer dans les détails, ni prédire l’avenir. Alors que les membres de l’OMC sont en cours de négociations, toute conclusion de ce type aurait vocation à être immédiatement dépassée. Néanmoins, cette étude révèle que le contexte qui prévalait à Doha n’existe plus, et que le progrès des négociations se heurte aujourd’hui à de nombreux obstacles, ainsi qu’en témoignent leurs débuts difficiles.
Olivier Cattaneo
This study aims to provide all the necessary keys to understanding the new round of multilateral trade negotiations set off by the World Trade Organization members in Doha on November 14, 2001. It first presents the circumstances that framed the conference, enabling a new round of talks to begin. After the failure of the Ministerial Conference in Seattle, serious doubts indeed hovered as to whether new multilateral trade talks could be launched. Nevertheless, various factors, such as improved transatlantic relations, consideration of the demands of developing countries and civil society, better Conference preparation and the events of September 11 all created a favorable context for Doha. The study then proceeds to describe the characteristics of the new negotiation round and the stakes involved. In drafting the Doha Declaration, so many last-minute diplomatic compromises were made that the document is complex to interpret, even for the negotiators themselves. How the negotiations will be organized from a practical standpoint is also unclear, and warrants clarification. This study thus summarizes the various issues slated for negotiation and what is at stake, as well as the organization and main deadlines for negotiation. Lastly, it analyzes the current state of negotiations and perspectives in view, without going into detail or predicting the future. At a time when WTO members are in the process of negotiation, any conclusion in this regard would quickly be outdated. However, this study reveals that the context that prevailed at Doha no longer exists, and that today the progress of negotiations has run up against several obstacles, as can be seen in the difficulties they are encountering at this early stage.
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
Luisa Palacios
Cette étude analyse la transformation institutionnelle du secteur pétrolier en Amérique latine et examine différents choix politiques et calendriers de réforme. L’Amérique latine, qui offre plusieurs modèles d’ouverture et de dynamique énergétique, fournit un cadre d’analyse intéressant sur le processus de libéralisation dans le cas d’un pays importateur (Brésil), d’un pays traditionnellement autosuffisant (Argentine) et chez des exportateurs (Mexique et Venezuela). On a prouvé que le niveau d’ouverture du secteur pétrolier d’un pays donné est en raison inverse de son degré de dépendance à l’égard des revenus du pétrole : les pays les plus dépendants de leur secteur pétrolier pour les revenus d’exportations et leurs recettes fiscales ont tendance à être moins ouverts à l’investissement étranger. En général, ce principe s’applique aussi en Amérique latine : les importateurs de pétrole et les pays autosuffisants tels que l’Argentine, le Pérou, la Bolivie et le Brésil ont de fait des industries pétrolières plus ouvertes à la participation du secteur privé que les exportateurs (Venezuela, Colombie, Équateur et Mexique). Toutefois, le degré d’ouverture varie beaucoup au sein même de chacune de ces catégories très générales. Cette étude montre que les différences entre pays de même catégorie sont fonction de la situation stratégique et financière de la compagnie nationale du pétrole antérieurement à la réforme, laquelle est liée à l’évolution institutionnelle de l’industrie pétrolière dans ces pays.
Luisa Palacios
This paper studies the institutional transformation of Latin America’s oil sector. It discusses specific policy choices and the timing of reforms in this industry. Latin American countries present different models of openness and energy-sector dynamics, and allow for an analysis of the liberalization process from a range of points of view: that of an importer (Brazil), of a historically self-sufficient country (Argentina) and of oil exporters (Mexico and Venezuela). The degree of dependence on oil revenues has proven in general to be negatively correlated with the level of openness of the oil sector. That is, countries more dependent on their oil sector for foreign and fiscal revenues tend to be less liberalized and open to private investment. This principle also holds true in Latin America: oil importers and self-sufficient countries like Argentina, Peru, Bolivia and Brazil indeed have oil industries that are relatively more open to private sector participation than those of the oil exporters in the region (Venezuela, Colombia, Ecuador and Mexico). However, different levels of openness exist within these general categories of importers and exporters. This paper will further argue that differences among countries in the same category are a function of the strategic and financial position prior to reform of their respective National Oil Companies (NOC), which is in turn related to the institutional evolution of the oil industries in these countries.
Jae-Seung Lee
La coopération économique en Asie orientale a été poursuivie activement ces dernières années, en particulier depuis la crise financière asiatique. Plusieurs accords bilatéraux ou multilatéraux de zones de libre-échange ont été conclus ou sont en cours de négociation. Le rapport du Groupe de vision pour l'Asie orientale (East Asia Vision Group), récemment publié, offre des indications plus concrètes pour l'établissement d'une Communauté économique est-asiatique. La zone de libre-échange de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (AFTA) est devenue une réalité après une période de dix ans de réduction des tarifs douaniers. L'ASEAN+3 (Asie du Sud-Est, Japon, Chine, Corée du Sud) a également proposé de créer une zone de libre-échange de l'Asie orientale (EAFTA). Le Japon a signé un accord de libre-échange avec Singapour, tandis que la Chine et l'Asie du Sud-Est ont prévu de créer une zone de libre-échange d'ici dix ans. Sur le plan financier, l'initiative de Chiang Mai a permis la création d'un fonds monétaire régional, en étendant l'accord existant sur les échanges de devises à l'ensemble des pays membres de l'ASEAN, et en l'augmentant d'accords bilatéraux entre l'ASEAN et la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Les pays d'Asie orientale ont aussi établi un mécanisme de veille de leurs performances économiques respectives. Mais il reste plusieurs obstacles au développement de la coopération économique régionale. L'hétérogénéité politique, économique et culturelle de l'ensemble des pays d'Asie orientale fait partie des problèmes structuraux. Les faibles légalisation et efficacité d'institutions régionales imbriquées les unes dans les autres rendent difficile l'approfondissement de la coopération régionale. L'instabilité interne des pays d'Asie du Sud-Est peut aussi ralentir cette coopération. La rivalité du Japon et de la Chine dans la région doit être observée de près. La coopération économique est-asiatique ira en s'accélérant dans un avenir proche. Depuis l'annonce d'accords de libre-échange entre l'ASEAN et la Chine, le Japon a cherché des alliances pour faire face à la montée en puissance chinoise, et pour maintenir sa propre influence dans la région. Les prochaines années verront l'apparition de nombreuses relations bilatérales ou multilatérales, financières et commerciales, en Asie orientale.
Jae-Seung Lee
East Asian economic cooperation has been actively pursued during the past few years, especially after the Asian financial crisis. A number of bilateral and multilateral Free Trade Area (FTA) agreements were concluded or are being negotiated. The recently published East Asia Vision Group Report provides a more concrete roadmap for an East Asian economic community. The ASEAN Free Trade Area (AFTA) became a reality on January 1, 2002, following a 10-years tariff reduction schedule. AFTA aims not only at trade facilitation but at inducing more investment. An ASEAN+3 (i.e. Japan, China and South Korea) FTA was also suggested to build an East Asian Free Trade Area (EAFTA). Japan signed an FTA with Singapore of ASEAN, while China and ASEAN agreed to create FTA within 10 years. On the financial side, the Chiang Mai Initiative created a regional liquidity fund by expanding the existing ASEAN Swap Arrangement to include all ASEAN members and augmented it by a network of bilateral swap arrangements among the ASEAN countries, China, Japan and South Korea. East Asian countries have also established a surveillance mechanism to monitor their economic performance. However, there are many obstacles in further enhancing regional economic cooperation. Structural problems involve political, economic, and cultural heterogeneities among East Asian countries. Low legalization and effectiveness of overlapping regional institutions render deeper regional cooperation difficult. Domestic instability of the ASEAN countries may hamper rapid regional cooperation. Regional rivalry between Japan and China should be an important object of observation. East Asian economic cooperation will be accelerated in the near future. Since the announcement of the ASEAN-China FTA agreement, Japan has attentively sought alliances to vie with growing China and to maintain her influence in the region. The next few years will see the emergence of a number of new bilateral and multilateral relations, both in trade and finance, in East Asia.
Gilles Dorronsoro
Gilles Dorronsoro
Frédéric Grare
Frédéric Grare
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
Elise Massicard
Marc Parant
Marc Parant
Elise Massicard
Dominique Malaquais
Dominique Malaquais
Emmanuel Mathias
Emmanuel Mathias
Eric Foster
Eric Foster
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
Caroline Vincensini, Petia Koleva
Caroline Vincensini, Petia Koleva
Benoît de Tréglodé
Benoît de Tréglodé
Vincent Simoulin
André Grjebine
André Grjebine
Vincent Simoulin
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
Gilles Dorronsoro
Gilles Dorronsoro
John Fitz Gerald
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
Gilles Bertrand
Jean-Pierre Pagé
Gilles Bertrand
John Fitz Gerald
Yves Zlotowski
Yves Zlotowski
Jean Coussy
Jean Coussy
Paolo Giordano, Javier Santiso
Paolo Giordano, Javier Santiso
André Grjebine
Yves Zlotowski
André Grjebine
Yves Zlotowski
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé