En écoute...
The Franco-German Observatory of the Indo-Pacific
Speaker:
Dr. Sana Hashmi is Visiting Fellow at Taiwan-Asia Exchange Foundation since March 2021. She is an affiliated scholar with the Research Institute for Indo-Pacific Affairs (RIIPA). Her primary research focuses on Taiwan’s foreign relations, China’s foreign policy, Taiwan’s New Southbound Policy, Taiwan-India relations, China’s territorial disputes, Indo-Pacific, and Asian security.
She was Taiwan’s Ministry of Foreign Affairs Fellow at the Institute of International Relations, National Chengchi University in 2020. She is a former Consultant in the Ministry of External Affairs (MEA), Government of India, where she worked on the Southeast Asian region and the Indo-Pacific with a focus on China from 2016-19. In 2017, she was named United Kingdom’s next-gen foreign and security policy scholar.
Chairs & Moderation:
Prof. Dr. Amrita Narlikar is the President of the German Institute for Global and Area Studies (GIGA) and Professor of International Relations at Hamburg University. She also is Honorary Fellow of Darwin College (University of Cambridge), non-resident Senior Fellow at the Observer Research Foundation (ORF) in an honorary capacity, and non-resident Distinguished Fellow of the Australia India Institute.
Dr. Mathieu Duchâtel is Director of the Asia Program at Institut Montaigne. Before joining the Institute he was Senior Policy Fellow and Deputy Director of the Asia and China Program at the European Council of Foreign Relations, Senior Researcher and the Representative in Beijing of the Stockholm International Peace Research Institute.
Débat organisé dans le cadre de la Chaire d'études sur le fait religieux
Débat organisé à l'occasion de la parution des livres:
Lucien Jaume : L'éternel défi. L’État et les religions en France des origines à nos jours, Tallandier, 2022
Alain Dieckhoff, CNRS, Directeur du CERI-Sciences Po
Stéphane Lacroix, CERI-Sciences Po
The Center for International Studies (CERI)/Sciences Po, in partnership with the European Institute for Asian Studies (EIAS), is pleased to invite you to a hybrid seminar (online and physical attendance at CERI).
The European Union’s “Global Gateway” is a major plan to support the development of infrastructure around the world. While boasting an impressive budget of €300 billions, the Global Gateway is also, and foremost, a geopolitical strategy. The case of Taiwan offers a unique perspective to assess the various implications of Europe’s approach to connectivity in East Asia. This will be the focus of a discussion with distinguished representatives of different EU institutions and from Taiwan’s government and private sector.
Dr. Harry Ho-Jen Tseng, Deputy Minister of Foreign Affairs, Taiwan
Responsables scientifiques de l'évènement : Christian Lequesne, Karoline Postel-Vinay et Earl Wang
Co-organised by the Center for International Research (CERI) of Sciences Po and the Hague Journal of Diplomacy

Program
Introduction
Moderator: Jan Melissen, Leiden University and University of Antwerp
PRACTICE
Practitioners views from Paris and The Hague
Manuel Lafont Rapnouil, Arjan Uilenreef, Ministries of Foreign Affairs France and the Netherlands
GENDER
Gender in the work of foreign ministries
Birgitta Niklasson, University of Gothenburg
POLITICS
The Politician-Diplomat Nexus
Geoffrey Wiseman, De Paul University, Chicago
Spoken columns
Christian Lequesne, CERI – Sciences Po, Paris
Kamna Tiwary, Jawarhal Nehru University, New Delhi
TECHNOLOGY
The Mediatisation of MFAs and the Digitalisation of Diplomacy
Ilan Manor, Ben Gurion University of the Negev
Q&A
Caitlan Read, Leiden University
Wrap-up
Jan Melissen, Leiden University and University of Antwerp
Responsable scientifique de l'évènement : Christian Lequesne, Sciences Po-CERI
Une séance de séminaire organisée dans le cadre du groupe de recherche : Sciences Sociales et Psychanalyse.
Intervenant:
Denis Pelletier, Directeur d’études à l’EPHE, Psychanalyse et religion, le cas du Président Schreiber
Responsables scientifiques : François Bafoil, Sciences Po - CERI / CNRS (UMR 7050) et Paul Zawadzki, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL/UMR 8582).
Une séance organisée dans le cadre du Séminaire sur les approches postcoloniales (SAP).
L’objet de ce séminaire mensuel est de construire un espace qui accueille des doctorant.e.s et des professeur.e.s, ainsi que des étudiant.e.s de masters intéressé.e.s par ces approches scientifiques. Le format régulier de ce séminaire consiste en une présentation d’un travail de recherche suivie d’une discussion.
Intervenant :
Guillaume Blanc, Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Rennes 2, nous présentera ses travaux à partir de son livre L'invention du colonialisme vert publié en 2020 et de son projet de recherche actuel : "L'évènement postcolonial : constructions de la nature, de l'Etat et de l'Afrique indépendante".
Discutante :
Claire Duboscq, doctorante au CERI (Sciences Po)
Mina Kleiche-Dray, directrice de Recherche HDR , Ceped (Université de Paris-IRD) et Frédéric Ramel, professeur agrégé des universités, Sciences Po-CERI.
Comité d’organisation :
Ayrton Aubry (doctorant, Sciences Po - CERI), Pablo Barnier-Khawam (doctorant, Sciences Po - CERI), Léonard Colomba-Petteng (doctorant, Sciences Po - CERI), Claire Duboscq (doctorante, Sciences Po - CERI), Luciana Landgraf, doctorante Ceped (Université de Paris-IRD), Aline Martello (doctorante, Université de Lausanne), Salomé Molina (doctorante, CLESTHIA, Université de Paris), Iris Padiou (doctorante, CEDITEC, Université Paris-Est Créteil), Louise Perrodin (doctorante, Université Paris-Est Créteil/LIPHA), Charlotte Vampo (post-doctorante, LPED, Université Aix-Marseille).
In his new book, A Cultural History of the Soul: Europe and North America from 1870 to the Present (Columbia University Press), Kocku von Stuckrad argues that contemporary forms of popular spirituality have a genealogy that can be traced back into the nineteenth and early twentieth centuries, and that secular sciences have been instrumental in shaping these new spiritualities, metaphysical worldviews, and religious practices. Today, these trends also manifest in environmental politics and social movements around the world. What is the role of secular institutions in the transformation of religions and spiritualities? Has secularism been “religiously productive” itself? What does this mean for our understanding of secularity and religion in contemporary Europe and North America?
Bernard Reber, Moral and Political Philosopher, CNRS-affiliated Senior Research Fellow at CEVIPOF-Sciences Po
Une séance de séminaire organisée dans le cadre du groupe de recherche : Sciences Sociales et Psychanalyse.
Hamit Bozarslan (EHESS) - Un spectre : Anti-démocratie, Nationalisme, et religions
Responsables scientifiques : François Bafoil, Sciences Po - CERI / CNRS (UMR 7050) et Paul Zawadzki, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL/UMR 8582).
Une séance organisée dans le cadre du Séminaire sur les approches postcoloniales (SAP).
L’objet de ce séminaire mensuel est de construire un espace qui accueille des doctorant.e.s et des professeur.e.s, ainsi que des étudiant.e.s de masters intéressé.e.s par ces approches scientifiques. Le format régulier de ce séminaire consiste en une présentation d’un travail de recherche suivie d’une discussion.
Intervenante :
Artemisa Flores Espínola, Maîtresse de conférences à l’INSPE, Laboratoire LIRTES, Paris-Est Créteil
Discutantes:
VAMPO Charlotte, chercheure en anthropologie, post-doctorante au LPED (IRD/ Aix-Marseille Université) et TOURE Niandou , enseignant-chercheur à l’USJPB (Bamako, Mali), chercheur associé au CEPED et à DEVSOC, rédacteur en chef de la revue Migrations Société
Mina Kleiche-Dray, directrice de Recherche HDR , Ceped (Université de Paris-IRD) et Frédéric Ramel, professeur agrégé des universités, Sciences Po-CERI.
Comité d’organisation :
Ayrton Aubry (doctorant, Sciences Po - CERI), Pablo Barnier-Khawam (doctorant, Sciences Po - CERI), Léonard Colomba-Petteng (doctorant, Sciences Po - CERI), Claire Duboscq (doctorante, Sciences Po - CERI), Luciana Landgraf, doctorante Ceped (Université de Paris-IRD), Aline Martello (doctorante, Université de Lausanne), Salomé Molina (doctorante, CLESTHIA, Université de Paris), Iris Padiou (doctorante, CEDITEC, Université Paris-Est Créteil), Louise Perrodin (doctorante, Université Paris-Est Créteil/LIPHA), Charlotte Vampo (post-doctorante, LPED, Université Aix-Marseille).
Masterclass de Yode et Siro
Co-organisée avec les étudiants de l’Association Sciences Po pour l’Afrique (ASPA), cette séance s’inscrit dans le cadre de la Semaine africaine qui se tient à Sciences Po à l’initiative de l’ASPA du 4 au 7 avril sur le thème du Soft power africain. Elle est portée par l’African Humanities Program (Sciences Po – Columbia) et le Séminaire Afrique, citoyenneté, violence et politique du CERI.
Né au début des années 1990 sur les campus d’Abidjan, le zouglou s’est imposé en Côte d’Ivoire comme une musique de luttes sociales et politiques, avant de connaître un succès international avec le groupe Magic System. La guerre civile des années 2000 s’est traduite par une guerre des rythmes, et aujourd’hui encore on « libère en zouglou » pour dénoncer les difficultés du quotidien ou les défis de la gouvernance post-conflit dans les maquis et discothèques. Yode et Siro, les deux grandes stars ivoiriennes du genre, auteurs d’un dernier album très politique, viendront dialoguer avec les étudiants et le public lors d’une masterclass exceptionnelle d’enjaillement académique et culturel.
Intervenants :
Yode et Siro
Modérateurs-trice :
Andréa Aka et Clémence Kouamé, Sciences Po - ASPA
Richard Banégas, Sciences Po – CERI
Responsable scientifique : Richard Banégas, Sciences Po – CERI
Jalel harchaoui, spécialiste de la libye
The Franco-German Observatory of the Indo-Pacific
Speaker:
Prof. Dr. Steven Ratuva is Director of the Macmillan Brown Centre for Pacific Studies (University of Canterbury, New Zealand). He is an award winning interdisciplinary Fijian scholar whose global expertise spans international relations, political science, sociology, history, development studies, conflict and peace studies, indexology and digitised social control, social protection, affirmative action, globalized knowledge and the politics of climate emergency. He was Fulbright Senior Fellow at the University of California (LA), Duke University and Georgetown University. He is one of the few Distinguished Professors in New Zealand and a Fellow of the Royal Society of New Zealand. He has advised and done consultancy work for a number of international organisations such as UNDP, ILO, British Council, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Pacific Islands Forum, Commonwealth Secretariat, and Asian Development Bank.
Chairs & Moderation:
Prof. Dr. Patrick Köllner is Vice President of the GIGA, Director of the GIGA Institute for Asian Studies, and a political science professor at the University of Hamburg.
Marianne Péron-Doise is Research Fellow at the Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (IRSEM), Paris.
Présidence :
Anne de TINGUY, chercheur au CERI-Sciences po, professeur des universités émérite à l’INALCO
Intervenant.e.s :
Mykola RIABCHUK, Senior Research Fellow at the Institute of Political Studies, Kyiv and Visiting Researcher at the Institute of Advanced Studies, Paris - Who Are These People? Putin's Imaginary "Ukrainians" and Advance of Reality”
Alexandra GOUJON, maîtresse de conférences à l’Université de Bourgogne – « Les ‘idées reçues’ sur l’Ukraine à l’aune d’une résistance nationale »
Kathy ROUSSELET, directrice de recherches, CERI-Sciences po – « Les Eglises orthodoxes dans la guerre »
Jacques RUPNIK, directeur de recherches émérite, CERI-Sciences po – "Central European neighbours facing the war: security concerns, coping with refugees flow, 'fast-track' to the EU"
Responsable scientifique : Anne de TINGUY, Sciences Po-CERI
Lors de la prochaine séance du séminaire "Sociologie et anthropologie sociale du politique", nous aborderons la question de la ville que Fariba Adelkhah a souvent traitée dans ses travaux par des chemins de traverse, notamment à travers son analyse de la fiscalité, des rapports entre la municipalité et l'Etat ou encore des enjeux socio-politiques de programmes de développement.
Ainsi nous penserons grâce à elle tout en pensant à elle et avec elle.
Intervenants :
Laurent Fourchard, CERI/SciencesPo - Taxes ou extorsions ? Gouverner les gares routières à Lagos
Nadia Hachimi-Alaoui, Université de Turin et CRESC Rabat - Casablanca : le tramway, le maire et l’Etat
Eric Verdeil, CERI/SciencesPo - Beyrouth : effondrement, mobilisations urbaines et reconstruction des interstices
Responsable scientifique : Béatrice Hibou, CNRS, Sciences Po – CERI
De l’Encyclique Laudato Si du Pape François à la diffusion de la pleine conscience, de l’agriculture biodynamique aux jeûnes pour le climat, l’écologie interroge les croisements entre religion, éthique et politique. Que penser de la religion, qui est affaire de liens (religare), en période de crise de nos relations avec le vivant ? Que nous dit son évolution contemporaine de nos façons d’envisager la nature ? Comment repenser l’opposition entre religion et politique à l’aune de la crise écologique ?
Intervenant.e.s :
Catherine Larrère, professeure de philosophie émérite, Paris-I Panthéon-Sorbonne
Mathieu Gervais, politiste et sociologue, docteur associé au GSRL, mention spéciale 2021 du prix du premier livre de la Chaire d'Études sur le fait religieux pour son ouvrage "Nous, on se sauve nous-mêmes"
Modérateur : Isacco Turina, Assistant professor au département des sciences politiques et sociales, Université de Bologne (Italie)
Responsables scientifiques :
Alain Dieckhoff, CNRS, directeur du CERI-Sciences Po
Stéphane Lacroix, CERI-Sciences Po
Elisabeth Miljkovic, CERI-Sciences Po
Table ronde #3
Cette rencontre est la troisième de la série de rencontres publiques « Médias, migrations : la fabrique de l’opinion » co-organisées par Sciences Po-Ceri (Projet PACE), l’Institut Convergences Migrations (revue De Facto Migrations) et l’association Désinfox-Migrations.

Programme :
Mot d’accueil :
Perin Emel Yavuz, ICM, présidente de Désinfox-Migrations
Table ronde modérée par Hélène Thiollet, chargée de recherche au CERI-CNRS/Sciences Po
Présentation de résultats de la recherche :
Julia Cagé, professeure d’économie à Sciences Po
François Héran, professeur au Collège de France (chaire Migrations et Sociétés), directeur de l’Institut Convergences Migrations
Discussion :
Nora Hamadi, France culture, Arte
Marie Verdier, La Croix
Responsable scientifique : Hélène Thiollet, Sciences Po-Ceri
The Franco-German Observatory of the Indo-Pacific
Speaker:
Prior to joining ASPI, she taught at the Australian National University and held research positions at the ISEAS–Yusof Ishak Institute in Singapore and the Institute of International Relations at the National Chengchi University in Taiwan. She has also worked and lived in Kuala Lumpur, Jakarta, and Seoul, among others. Dr. Le Thu holds a PhD from the National Chengchi University and an MA in international studies from Jagiellonian University in Poland. She speaks five languages and has published in four of them.
Chairs:
Dr. David Camroux is Honorary Research Fellow and Adjunct Professor, Sciences Po-CERI.
Prof. Dr. Patrick Köllner is Vice President of the GIGA, Director of the GIGA Institute for Asian Studies, and a political science professor at the University of Hamburg.
Une séance de séminaire organisée dans le cadre du groupe de recherche : Sciences Sociales et Psychanalyse.
Marcel Gauchet (EHESS)
Responsables scientifiques : François Bafoil, Sciences Po - CERI / CNRS (UMR 7050) et Paul Zawadzki, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL/UMR 8582).
Une séance organisée dans le cadre du cycle de séminaires organisés en partenariat avec EDF/RD
Ouverture
Patrick Criqui, Directeur de recherche émérite CNRS
Economie politique du climat : Monde, Europe, France, trois niveaux d’analyse
Après la COP 26 et alors que le monde est encore aux prises avec une crise sanitaire sans précédent, les perspectives des politiques climatiques sont plus que jamais incertaines. A l’échelle de la négociation internationale, les avancées sont encore insuffisantes, notamment sur la question critique de la sortie du charbon qui aura constitué un point de blocage lors de la COP26. En Europe, la volonté de s’inscrire sur des trajectoires de « neutralité carbone » en 2050 est affirmée avec vigueur. Le paquet « Fit for 55 », qui vise, sur ce chemin, une réduction de 55% des émissions dès 2030, doit permettre de structurer les efforts selon trois piliers : une tarification du carbone étendue, des objectifs sectoriels plus ambitieux, un système de normes d’émission renforcées. Enfin, dans chaque Etat membre, les feuilles de route existent, avec en France en particulier la Programmation Pluriannuelle de l’Energie pour l’horizon 2030 et la Stratégie Nationale Bas Carbone pour 2050. Mais les feuilles de route ne suffisent pas, encore faut-il activer des leviers de transformation. L’introduction d’une taxe carbone uniforme apporterait la solution la plus efficace selon nombre d’économistes mais la crise des gilets jaunes est encore proche et l’on peut douter du caractère socialement acceptable de cette solution. D’autant que la hausse et l’instabilité des prix de l’énergie est déjà difficilement soutenable pour les ménages les plus modestes.
Discussion
Responsable scientifiques : François Bafoil (Sciences Po-CERI / CNRS), Ferenc Fodor (EDF R&D, Verso project), Rachel Guyet (CIFE)
Le 24 janvier, le président Poutine a annoncé « une opération militaire spéciale » en Ukraine. A la guerre sans justification alors déclenchée par la Russie, l’Ukraine oppose une résistance farouche que Moscou n’avait apparemment pas anticipée. Volodymyr Yermolenko, philosophe, Tetyana Ogarkova, politiste, chercheurs ukrainiens qui habitent à Kiev, s’interrogeront sur la signification et le sens de l’invasion russe. Ils reviendront sur l’identité ukrainienne et sur la résistance de la société, sur le soutien que leur pays attend du monde extérieur ainsi que sur les perspectives de ce conflit. Anne de Tinguy, Loulia Shukan et Christian Lequesne animeront ce débat.
Présidente :
Anne de TINGUY, chercheure émérite Sciences Po-CERI, professeure des universités émérite à l’INALCO
Intervenant.e.s :
Tetyana OGARKOVA, journaliste, responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center (UCMC), Kiev
Volodymyr YERMOLENKO, philosophe et essayiste, Kiev
Ioulia SHUKAN, maîtresse de conférences à l’Université Paris Nanterre et chercheure à l’Institut des sciences sociales du politique
Christian LEQUESNE, professeur, Sciences Po-CERI
Responsable scientifique : Anne de TINGUY, Sciences Po-CERI
Organisateur : Consortium sur les « Grandes Stratégies Françaises »
Où est passée la France au Moyen-Orient ? Quel rôle peut-elle encore jouer en Afrique ? L’Union européenne est-elle son assurance-vie ? A-t-elle encore une voix singulière ? A rebours de l’étrange idée, en France, que la politique internationale n’a pas sa place dans une campagne présidentielle, cette conférence vise à montrer, à travers une sélection d’enjeux saillants, qu’une présidence aboutie ne peut être décorrélée de performances internationales robustes. Les chevauchements, nombreux et fréquents, entre la politique interne et la politique étrangère obligent donc tous les acteurs à mieux apprécier comment s’articulent les défis et se négocient les solutions entre ces différentes échelles. Issus d’horizons variés, les intervenants auscultent le monde qui attend le prochain quinquennat et suggèrent quelques pistes concrètes pour s’y engager efficacement.
Thierry Balzacq, CERI-Sciences-Po et Frédéric Charillon, Université de Clermont Auvergne & Sciences Po
Samuel Faure - Que veut dire « autonomie stratégique » ?
Eberhard Kienle, CERI-Sciences Po - Méditerranée / Proche-Orient : un « déclassement français » ?
Niagalé Bagayoko, African Security Network - Que peut encore la France en Afrique ?
Alice Ekman, Institut des études de sécurité de l’Union européenne - La Russie et la Chine, même combat ?
Olivier Schmitt, IHEDN & University of Southern Denmark - La dissuasion pour quoi faire ?
Pierre Buhler, Sciences Po - L’outil diplomatique : quelle place pour la culture ?
Pernille Rieker, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Oslo - Vu d’ailleurs : Jusqu’où porte la voix de la France ?
Marie Durrieu, Université de Clermont Auvergne - Quel message pour la France dans le monde ?
Frédéric Ramel, CERI-Sciences Po - Un multilatéralisme à la Française ?
Frédéric Charillon, Université de Clermont Auvergne & Sciences Po - A l’épreuve des guerres d’influence
Thierry Balzacq, CERI-Sciences-Po - La France, un navire démâté ? A propos de la grande stratégie
Modérateur : Christian Lequesne, CERI-Sciences Po
Responsables scientifiques :
Thierry Balzacq, CERI-Sciences-Po
Frédéric Charillon, Université de Clermont Auvergne & Sciences Po
Frédéric Ramel, CERI-Sciences Po
Il y a comme une évidence à consacrer une séance du séminaire à Erich Fromm (1900-1980). Dès la fin des années 1920, Fromm a en effet thématisé le problème des rapports entre psychanalyse et sociologie [1] ce qui, sans jamais abandonner le freudisme, l’a conduit à élaborer toute une série de propositions pour renouveler la théorie des pulsions et des passions [2]. La violence des critiques qui lui adressèrent par la suite Horkheimer puis Adorno et Marcuse feraient presque oublier le rôle central qu’il a joué dans les premiers efforts de l'Institut de recherches sociales de Francfort pour concilier Freud et Marx.
[1] « Psychoanalyse und Soziologie » (1929) tr. Suzanne Kadar, Le Coq-Héron n°182/2005, pp. 81-83 ; voir aussi par ex. « Méthode et fonction d’une psychologie sociale analytique » (1932) repris dans Erich Fromm, La crise de la psychanalyse. Essais sur Freud, Marx et la psychologie sociale, tr. J.-R. Ladmiral, Paris, Anthropos, 1971
[2] Erich Fromm, Revoir Freud. Pour une autre approche en psychanalyse, tr. J. Roland et G. D. Khoury, Paris, Armand Colin, 2000, p. 35.
Responsables scientifiques : François Bafoil, Sciences Po - CERI / CNRS (UMR 7050) et Paul Zawadzki, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL/UMR 8582).
Amba-series on the new geopolitics of Higher Education and Research
The Sciences Po/CERI partners with the British Council in France and the French Embassy in the UK to organise a joint amba-series on the new geopolitics of Higher Education and Research which will be twofold: one dedicated to the Sino-American relationships and another one on the new map of European collaboration.
The first policy dialogue of this series will be dedicated to the Sino-American relations in Higher Education & Research and its consequences for other countries, especially the UK and Australia. Assuming the strategic rivalry between China and the US will shape tomorrow’s world in all sectors, it is quite clear that the global geopolitics of Higher Education & Research will be impacted. New players are currently emerging, which could either represent an opportunity or a threat. Especially countries such as the UK and Australia, will need to readapt their strategies to keep up with their leading role in Higher Education & Research. This first conference aims at better understanding the ongoing geopolitical changes and its consequences.
Roundtable on “Sino-American relations in Higher Education and Research : constraints and opportunities for direct partners”:
Introduction by Anne Duncan, President of The British Council in France.
Introduction by Minh-Hà Pham, Scientific Counsellor at the French Embassy in the UK
Opening remarks by Ambassador Pierre Buhler, Policy Officer in charge of Influence Diplomacy at the Center for prospective and Strategy of the French Foreign Affairs Ministry
Keynote by Pr. Stéphanie Balme, Dean of the Undergraduate College of Sciences Po
Roundtable moderated by Pierre Tapie, President of PAXTER and Honorary Chairman of the Conférence des Grandes Ecoles
Panelists :
Sarah Spreitzer, Assistant Vice President & Chief of Staff of the American Council on Eudcation
Pr. Simon Marginson, Professor of Higher Education, Department of Education and Linacre College, University of Oxford
Q&A
Si le Coran a donné lieu à une religion et une civilisation, il se nourrit en même temps d’univers culturels divers et complexes. Témoin de la transition du monde antique vers le Moyen Âge, le livre saint de l’Islam se compose de multiples couches sémantiques et discursives qui n’ont cessé d’interpeller ses lecteurs venant d’horizons les plus variés. Aujourd’hui, le champ de recherche s’attelant à reconstituer ces couches et à les rendre intelligibles à la lumière d’approches historiques, philologiques ou codicologiques constitue l’un des domaines les plus dynamiques de l’islamologie. La table ronde organisée par la Chaire d’études sur le fait religieux (Sciences Po, CERI) a pour objectif de proposer une réflexion sur les principaux débats et idées qui traversent les études coraniques à l’attention d’un public plus large des sciences humaines et sociales. L’enjeu est de mettre en exergue la profondeur historique d’un texte que les lectures du présent ont parfois tendance à faire oublier.
Présidence :
Stéphane Lacroix, CERI-Sciences Po
Intervenant.e.s :
Mohammad Ali Amir-Moezzi, EPHE
Mohammad Ali Amir-Moezzi, Professeur des universités, est Directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes/PSL. Membre de l’Académie Ambrosienne d’Italie et de nombreuses sociétés savantes, il a comme principaux domaines de compétence l’islam chiite, les origines de l’islam et l’histoire du Coran. Parmi ses publications récentes, on peut mentionner les monographies La Preuve de Dieu. La mystique shi’ite à travers l’œuvre de Kulaynî (9e-10e s.) (Cerf, 2018, Prix Bernheim d’histoire des religions de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres) ; Ali. Le secret bien gardé. Figures du premier Maître en spiritualité shi’ite (CNRS Editions, 2021) et l’ouvrage collectif, qu’il a dirigé avec Guillaume Dye, Le Coran des historiens (Cerf, 2019, prix du meilleur livre de l’année des Rendez-vous de l’Histoire de l’Institut du Monde Arabe).
Mehdi Azaiez, Université de Louvain
Mehdi Azaiez est Professeur d'islamologie à l'Université de Louvain (UCL). Son domaine de recherche est le Coran et les premiers siècles de l'Islam. Il est notamment l’auteur d'une monographie intitulée le contre discours coranique (Berlin, De Gruyter, 2015) et d'articles sur la rhétorique et l'herméneutique coranique. Depuis plus d'une dizaine d'années, il anime un site académique de référence sur le Coran (Coran et sciences de l'Homme). Il publiera prochainement un ouvrage coédité intitulé : Quranic Studies, Between History, Theology and Exegesis (Atlanta, Lockwood Press, 2022).
Muriel Debié, EPHE
Muriel Debié est directrice d'études à l'EPHE sur la chaire "Christianismes orientaux", un champ qu'elle aborde au travers des études syriaques. Elle explore depuis quelque temps le rôle qu'a joué le christianisme syriaque dans la période de naissance du Coran et des débuts de l'Islam et l'importance des écrits syriaques pour écrire aujourd'hui l'histoire de cette période. Elle est l'autrice de L'écriture de l'histoire en syriaque : Transmissions interculturelles et constructions identitaires entre hellénisme et islam(Peeters 2015) et avec Françoise Briquel Chatonnet du Monde syriaque : sur les routes d'un christianisme ignoré (Les Belles Lettres, 2017 - grand prix du livre d'histoire du monde arabe et prix de la Dame à la licorne en 2018). Son prochain livre, à paraître en 2022, s'intitule : Alexandre le Grand en syriaque : du roman grec aux apocalypses chrétiennes et au Coran (Les Belles Lettres).
Rencontre modérée par Ismail Warscheid, CNRS-IRHT, Université de Bayreuth
Responsables scientifiques :
Alain Dieckhoff, CNRS, directeur du CERI-Sciences Po
Stéphane Lacroix, CERI-Sciences Po
Ismail Warscheid, CNRS-IRHT, Université de Bayreuth
Débat à l’occasion de la publication de REGARDS SUR L’EURASIE. L’ANNEE POLITIQUE 2021, sous la direction d’Anne de Tinguy, dans la collection Les Etudes du CERI.
Présidence :
Alain Dieckhoff, directeur de recherche au CNRS, directeur du CERI-Sciences po
Intervenant.e.s :
Anne de Tinguy, professeur des universités émérite, CERI-Sciences po et INALCO – « L’Eurasie trente ans après la fin de l’URSS »
Annie Daubenton, journaliste et essayiste – « L’Ukraine face à la crise internationale »
Catherine Poujol, professeur des universités à l’INALCO, ancienne directrice de l’IFEAC (Institut Français d’Etude de l’Asie centrale), Bichkek – « De la pandémie à l’explosion sociale, le cas du Kazakhstan, 2020-2022 »
Françoise Dauce, directrice d’études à l’EHESS, directrice du CERCEC (Centre d’Etudes des mondes russe, caucasien et centre-européen) – « ‘Agents de l’étranger’, ‘indésirables’ et ‘extrémistes’ : quand la politique devient un délit, en Russie et au-delà »
Sergeï Guriev, professeur des universités, Sciences po, ancien économiste en chef de la BERD - “30 years of transition to market economy : lessons learned "
Responsable scientifique : Alain Dieckhoff, directeur de recherche au CNRS, directeur du CERI- Sciences Po
Discussion du World Nuclear Industry Status Report 2021 présenté par ses auteurs.
Introduction: Dr Benoît Pelopidas, CERI / Nuclear Knowledges
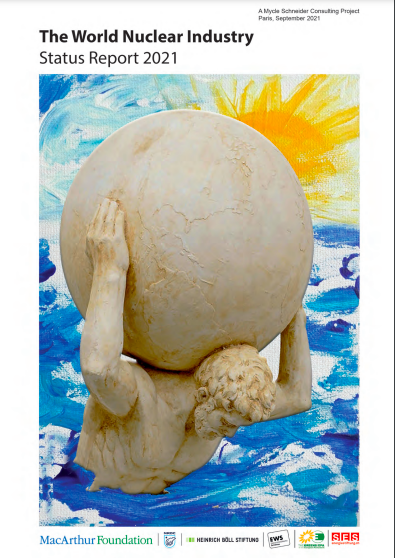 Mycle Schneider, Coordinateur et éditeur du WNISR - Résumé de la situation globale et point sur la France
Mycle Schneider, Coordinateur et éditeur du WNISR - Résumé de la situation globale et point sur la France
M.V. Ramana, University of British Columbia, Vancouver, co-auteur du WNISR - Small Modular Reactors (SMR), en anglais
Thibault Laconde, Ingénieur conseil, Callendar, co-auteur du WNISR - Le nucléaire et la résilience climatique
Mathilde Le Moal, Criminologue, co-auteur du WNISR - Le nucléaire et l’énergie criminelle
Antony Froggatt, Chatham House, Londres, co-auteur du WNISR - Nuclear Power vs. Renewable Energy Deployment, en anglais
Une séance de séminaire organisée dans le cadre du groupe de recherche : Sciences Sociales et Psychanalyse.
Intervenant.e.s:
Annette Becker, Paris X
Françoise Davoine, EHESS
Responsables scientifiques : François Bafoil, Sciences Po - CERI / CNRS (UMR 7050) et Paul Zawadzki, Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL/UMR 8582).

Speaker:
Dr. Collin Koh is research fellow at the Institute of Defence and Strategic Studies which is a constituent unit of the S. Rajaratnam School of International Studies, based in Nanyang Technological University, Singapore. He has research interests on naval affairs in the Indo-Pacific, focusing on Southeast Asia. Collin has published several op-eds, policy- and academic journal articles as well as chapters for edited volumes covering his research areas. Collin has also taught at Singapore Armed Forces professional military education and training courses. Besides research and teaching, he also contributes his perspectives to various local and international media outlets, and participates in activities with geopolitical risks consultancies.
Chairs:
Dr. Hugo Meijer is CNRS Research Fellow at Sciences Po, Center for International Studies (CERI).
Dr. Christian Wirth is Research Fellow at the GIGA.
Un débat à l'occasion de la parution du Hors-série Déchiffrer 2022 de la revue Alternatives Économiques (n° 124 décembre 2021) réalisé en partenariat avec Le CERI.
Elsa Tulmets (Centre Marc Bloch de Berlin), Jean-Louis Rocca (Sciences Po-Ceri), Luis Martinez (Sciences Po-Ceri) et Christophe Jaffrelot (Sciences Po-Ceri), viendront présenter leurs articles* et débattront des grands enjeux et défis internationaux qui se dessinent pour 2022.
Xi Jinping n’est pas un nouveau Mao (Jean-Louis Rocca)
La France peut-elle contrer les jihadistes au Sahel ? (Luis Martinez)
Cinquante nuances "d'Indo-Pacifique" (Christophe Jaffrelot)
Série de rencontres Médias Migrations: La Fabrique de l’opinion
Cette rencontre s’inscrit dans un cycle de rencontres publiques co-organisées par Sciences Po-Ceri (Projet PACE), l’Institut Convergences Migrations (revue De Facto Migrations) et l’association Désinfox-Migrations.
Alors que la pré-campagne pour l’élection présidentielle d’avril 2022 bat son plein, l’immigration est au cœur des discours publics de plusieurs candidats et candidates, et fait l’objet de nombreuses infox et propos de désinformation qui impactent l’opinion publique. En parallèle, le fact-checking, et notamment sur le sujet des migrations, n’a jamais été aussi important.
Dans ce contexte, et à l’occasion de la sortie du dernier De Facto Migrations “Médias et migrations”, Sciences Po (Projet PACE), l’Institut Convergences Migrations et l’association Désinfox-Migrations s’associent pour faire dialoguer des chercheurs et des journalistes, dans leur diversité et ainsi promouvoir un débat public informé sur le sujet des migrations.
1er février
Introduction: Perin Emel Yavuz, ICM, présidente de Désinfox Migrations
Modération: Laurent Greilsamer, Le Un
Présentation de résultats de la recherche (De facto)
Emeric Henry, Sciences Po - Que peut le fact-checking sur les questions de migrations ?
Discussion :
Julien Pain, Rédacteur en chef et présentateur du Vrai du Fake sur France Info
Céline Pitelet, Responsable fact checking BFMTV
Tania Racho, Responsable des formations Les Surligneurs
2 février
Introduction: Barbara Joannon, Désinfox Migrations
Modération: Laurent Greilsamer, Le Un
Présentation de résultats de la recherche ( De facto)
Jérôme Valette, Université Paris 1 - L'immigration, un traitement médiatique qui a un impact - À la télévision
Katharina Tittel, Medialab Sciences Po - L'immigration, un traitement médiatique qui a un impact - Sur les réseaux sociaux
Discussion :
Julia Pascual, journaliste migrations, Le Monde
Shahzad Abdul, journaliste migrations, AFP
Julia Dumont, journaliste InfoMigrants
Responsable scientifique : Hélène Thiollet, Sciences Po-Ceri











