Les Etudes du CERI
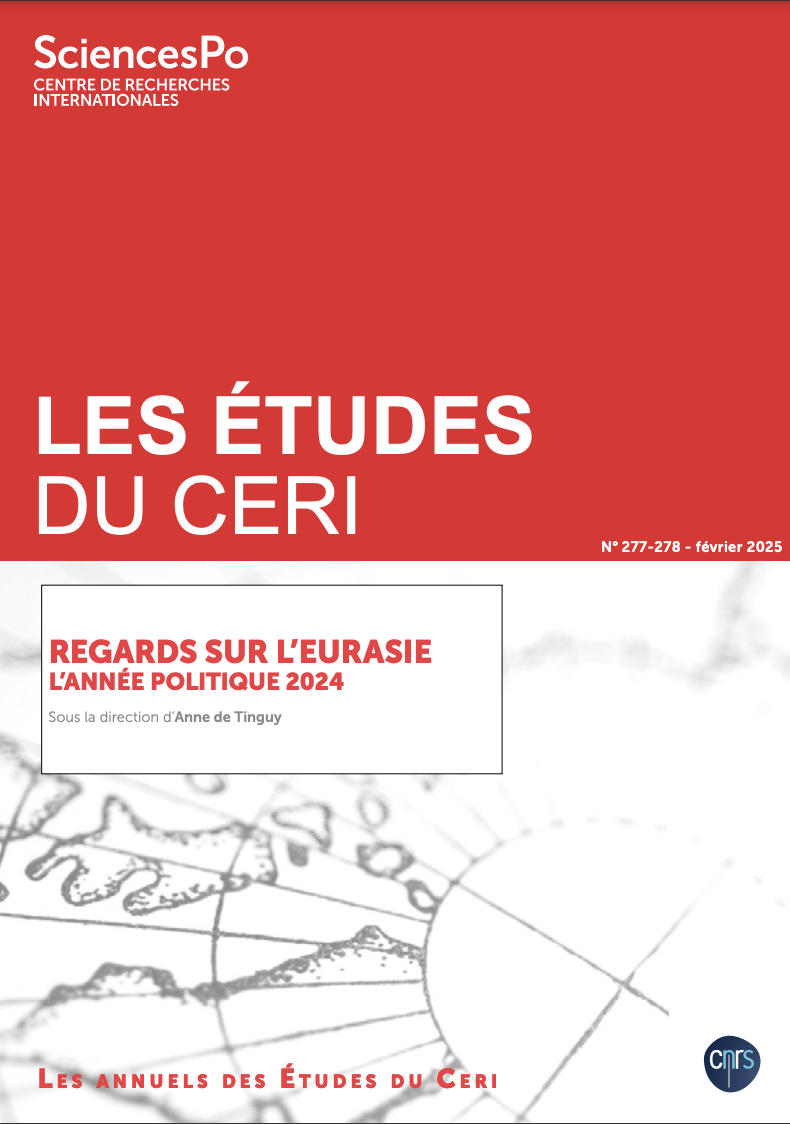 La particularité des Études du CERI est de proposer des analyses qui peuvent tout autant éclairer les non spécialistes que servir de référence aux chercheurs. Quel qu’en soit le thème – un enjeu global majeur ou une évolution spécifique au « local » – chaque volume obéit aux règles d’une publication scientifique à comité de lecture, la double évaluation anonyme par les pairs étant appliquée lors de la sélection des textes. Autre trait significatif de cette collection, chaque livraison est le fruit d’une enquête de terrain réalisée par l’auteur.
La particularité des Études du CERI est de proposer des analyses qui peuvent tout autant éclairer les non spécialistes que servir de référence aux chercheurs. Quel qu’en soit le thème – un enjeu global majeur ou une évolution spécifique au « local » – chaque volume obéit aux règles d’une publication scientifique à comité de lecture, la double évaluation anonyme par les pairs étant appliquée lors de la sélection des textes. Autre trait significatif de cette collection, chaque livraison est le fruit d’une enquête de terrain réalisée par l’auteur.
En plus des monographies, la collection offre deux publications collectives à périodicité annuelle, consacrées l’une à l’Amérique latine, l’autre à l’Eurasie. Tous les volumes parus depuis 1995 sont disponibles en libre accès sur ce site.
Rédactrice en chef : Judith Burko, judith.burko@sciencespo.fr, tél. +33158717004
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
, Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale 2009 (volume 2) / Les Études du CERI, N°162, Décembre 2009, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
, Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale 2009 (volume 1) / Les Études du CERI, N°161, Décembre 2009, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Jean-Marc Siroën
Le nouveau cycle de négociations multilatérales (« Round ») ouvert à Doha en 2001 s’est enlisé et n’a pu aboutir à un accord final, dont la ratification par les Etats-Unis ne serait d’ailleurs pas acquise. Ce retard s’explique notamment par l’évolution du contexte, qui est parfois la conséquence des choix de Doha. L’adhésion des gouvernements et des opinions publiques s’est émoussée, avec une préférence de plus en plus affirmée pour des accords bilatéraux permettant, notamment, d’intégrer de nouveaux sujets bloqués à l’OMC (normes de travail, concurrence, investissement, marchés publics, environnement). L’affirmation des pays émergents a déséquilibré le co-leadership Etats-Unis-Union européenne et impliqué une modification du processus de négociation qui ne s’est pas stabilisé. La crise économique a remis en cause certains objectifs de la négociation agricole et révélé la difficulté d’une organisation qui raisonne dans le long terme à adapter sa doctrine aux conditions de court terme. Les quelques propositions formulées visent à réviser la doctrine pour mieux l’insérer dans une problématique moderne ; elles défendent l’inclusion de nouveaux sujets qui élargissent le champ des négociations. Si le principe du consensus n’est pas remis en cause, la réhabilitation des accords plurilatéraux pourrait désamorcer une orientation vers le bilatéralisme, dangereuse à terme par son caractère discriminatoire.
Jean-Marc Siroën
, L’OMC face à la crise des négociations multilatérales / Les Études du CERI, N°160, Décembre 2009, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Gilles Lepesant
Le modèle de développement des pays d’Europe centrale a jusque-là reposé sur un taux d’épargne faible, une forte croissance de la consommation, une forte dépendance à l’égard des flux de capitaux extérieurs, une ouverture commerciale importante notamment vis-à-vis de l’Europe de l’Ouest, et pour certains sur une spécialisation industrielle dans des secteurs cycliques (automobile). La crise a dans ce contexte mis en lumière, d’une part la différenciation croissante entre les pays de l’Est européen, d’autre part la forte interdépendance qui prévaut désormais entre les économies européennes et qui impose une solidarité intéressée à l’échelle de l’Union européenne. Si le scénario des années 1930 est improbable dans le cas européen, le risque d’un rattrapage en trompe l’oeil qui prévalut dans l’entre-deux guerres n’est, lui, pas écarté. En témoigne le cas du secteur de l’automobile, qui s’est développé en Europe centrale jusqu’à représenter une part importante du PIB et de l’emploi, mais dont les perspectives sont incertaines. La politique régionale dont les nouveaux Etats-membres bénéficient doit en principe permettre que l’innovation, les politiques actives du marché du travail, le développement durable soient valorisés en vue d’un rattrapage effectif.
Gilles Lepesant
, Géographies de la crise en Europe centrale / Les Études du CERI, N°159, Décembre 2009, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Adeline Braux
Les discours hostiles aux migrants, voire xénophobes, demeurent la plupart du temps la norme en Russie. Pour autant, la politique migratoire de la Fédération de Russie apparaît relativement souple, en particulier à l’égard des pays membres de la CEI, dont les ressortissants bénéficient de procédures simplifiées pour l’entrée sur le territoire russe et l’obtention d’un permis de travail. Les autorités russes, échaudées par l’expérience des pays d’Europe occidentale, entendent ainsi favoriser l’immigration de travail et limiter l’immigration familiale. Parallèlement, afin de favoriser la cohésion de la nation russe dans son ensemble, la Fédération de Russie entend mener une politique de promotion de la diversité culturelle ambitieuse, tant envers les différents peuples constitutifs de Russie qu’envers les communautés immigrées présentes sur son territoire. Ce « multiculturalisme à la russe » n’est d’ailleurs pas sans rappeler la folklorisation dont les cultures et traditions des différents peuples d’URSS étaient l’objet pendant la période soviétique. Toutefois, faute d’une véritable ligne directrice au niveau fédéral, les autorités locales ont été plus actives en la matière, notamment à Moscou.
Adeline Braux
, Politique migratoire et gestion de la diversité culturelle en Russie : l’exemple de Moscou / Les Études du CERI, N°158, Novembre 2009, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Depuis le début des années 1990, la thématique des risques et des catastrophes « naturels » a émergé sur la scène internationale. Un véritable « monde » des catastrophes « naturelles » s'est constitué au niveau international et s’est peu à peu institutionnalisé. Comment ses acteurs en légitiment-ils la nécessité ? Que nous révèle-t-il de la façon dont le monde contemporain gère ses peurs au niveau global ? Une approche diachronique de ce processus d’internationalisation et d’institutionnalisation permet de resituer ce phénomène dans un contexte historique et mondial, notamment de transformation de la notion de sécurité. L’analyse sociologique des principales organisations intergouvernementales, qui jouent un rôle central dans cette dynamique, invite à saisir les différentes lignes de tension qui la traversent et à entrevoir sa complexité. En effet, malgré les tentatives visant à faire apparaître cet espace comme une « communauté » de sens et de pratiques, de fortes disparités caractérisent les approches des différents acteurs.
Burcu Gorak Giquel
Dans le cadre des politiques européennes de développement régional, les coopérations transfrontalières représentent un élément de toute première importance, pour trois raisons : elles renforcent les partenariats entre, d’une part, les acteurs centraux, régionaux et locaux, d’autre part, les acteurs publics privés et associatifs ; elles s’adossent à l’architecture décentralisée des Etats en assignant à chaque niveau d’intervention son propre rôle en matière de développement ; enfin, elles favorisent l’initiative locale. Elles deviennent ainsi les vecteurs de la « gouvernance à niveaux multiples » qu’entend promouvoir l’Union européenne (UE), en liant l’organisation de l’action publique, les coopérations entre acteurs et l’ancrage dans les territoires. Pour un Etat très centralisé comme la Turquie il s’agit d’un défi et d’une chance : défi, parce que la régionalisation concerne directement la structure unitaire de l’Etat. Chance, parce que l’UE n’oblige à aucune décentralisation forcée. Au contraire, elle laisse aux acteurs nationaux le soin d’aménager leur propre architecture territoriale en fonction de leur trajectoire historique et de la négociation entre centre et périphérie. Cette Etude le démontre en insistant sur deux aspects des transformations turques : la décentralisation n’est nullement un préalable à l’adhésion ; des coopérations différentiées existent aux frontières avec la Bulgarie et avec la Syrie, preuve de la dynamique d’européanisation des administrations turques.
Burcu Gorak Giquel
, Les coopérations transfrontalières à l’épreuve de l’UE. Une comparaison Europe centrale-Turquie / Les Études du CERI, N°156, Juillet 2009, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Damien Krichewsky
La stratégie de développement post-interventionniste, adoptée dès le milieu des années 1980 par le gouvernement indien, a permis aux entreprises d’accroître considérablement leur participation à la croissance économique du pays. Cependant, les bénéfices de la croissance sont très inégalement répartis, alors même que les externalités sociales et environnementales des entreprises pèsent de plus en plus lourd sur la société indienne. Dans ces conditions, face à un régulateur public qui allège les contraintes juridiques sociales et environnementales susceptibles d’entraver une croissance rapide des investissements, de nombreuses organisations de la société civile renforcent et multiplient leurs actions de régulation civile des entreprises, tout en plaidant pour un rééquilibrage de l’action publique en faveur d’une plus grande protection des groupes sociaux affectés par les entreprises et une préservation plus effective de l’environnement. En réponse, les grandes entreprises indiennes révisent leurs stratégies et pratiques de RSE (responsabilité sociale d’entreprise), afin de protéger leur légitimité sociale et de préserver l’attitude conciliante des pouvoirs publics. A travers une analyse détaillée des enjeux et des dynamiques qui animent la régulation publique, la régulation civile et l’autorégulation des entreprises, la présente étude rend compte d’une recomposition des relations et des rapports de force entre les acteurs du marché, l’Etat et la société civile sur fond de modernisation du pays.
Damien Krichewsky
, La régulation sociale et environnementale des entreprises en Inde / Les Études du CERI, N°155, Juin 2009, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].La crise du Darfour a permis de mettre en lumière des crises irrésolues sur ses frontières au Tchad et en République centrafricaine. Le point commun de ces différents conflits est sans doute l’existence de mouvements armés transnationaux qui survivent et se recomposent dans les marges qu’autorisent les dynamiques étatiques dans la région, ainsi que les apories des politiques de résolution des conflits de la communauté internationale – apories redoublées par les choix de certaines grandes puissances. Une analyse de la conjoncture en Centrafrique et de l’histoire de certains mouvements armés, inscrits dans cet espace régional, plaide pour une approche moins conventionnelle des politiques de sorties de crise. Elle met en exergue une zone centrée sur la Centrafrique et ses frontières avec les pays voisins comme véritable site d’analyse du factionnalisme armé depuis les indépendances, ainsi que des trajectoires spécifiques de construction étatique.
Avec plus de 8 millions d’expatriés, la population représente la principale exportation nationale des Philippines. Les transferts de fonds constituent 13?% du PIB et font des expatriés des acteurs économiques centraux. L’Etat philippin a-t-il instrumentalisé cet exode afin d’en récolter les fruits ? Répondre à cette question nécessite de distinguer trois concepts fondamentaux : l’Etat, la diaspora et le transnationalisme. Le texte suggère que l’utilisation de la dichotomie de la force et de la faiblesse d’un Etat doit se fonder sur une analyse du rôle de ce dernier dans l’émigration. Les typologies de Robin Cohen servent par ailleurs à démontrer que les communautés philippines d’outre-mer répondent à des caractéristiques propres à des communautés diasporiques plus généralement reconnues. Reste qu’il faut s’interroger sur les expériences de cette diaspora hétérogène pour mettre en avant la distinction entre émigrés permanents, saisonniers, travailleurs en mer et personnes en situation irrégulière. La vie de ces groupes et leurs relations avec leur "mère patrie" remet en question la prédominance de la notion de "transnationalisme". Cette analyse critique est renforcée par l’examen du rôle de l’Etat dans la création d’une diaspora instrumentalisée au cours de trois périodes de politiques d’immigration depuis 1974. Les caractéristiques qui ressortent de cette analyse sont des formes de "nationalisme longue distance" (Anderson, Schiller) et de "cosmopolitanisme enraciné" (Appiah). D’autres pistes de recherche plus fructueuses peuvent naître de l’exploration des multiples identités, des loyautés et dans le cas philippin des "nationalismes binaires".
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
, Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale 2008 (volume 2) / Les Études du CERI, N°151, Décembre 2008, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
, Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale 2008 (volume 1) / Les Études du CERI, N°150, Décembre 2008, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Chloé Froissart
Le hukou est un système d’enregistrement et de contrôle de la population instauré à l’époque maoïste pour servir le projet de développement socialiste. Il a créé une division durable entre les villes et les campagnes et donné naissance à un système de statuts en contravention avec la Constitution chinoise qui stipule l’égalité des citoyens devant la loi. Son maintien en dépit de la réintroduction du marché explique la formation d’une nouvelle catégorie sociale : les travailleurs migrants qui représentent une réserve de main-d’oeuvre qui tire la croissance chinoise. L’habileté avec laquelle cette institution communiste a été adaptée pour répondre aux mutations socio-économiques du pays contribue largement à expliquer le maintien du PCC au pouvoir. Le hukou permet de gérer le développement en maîtrisant l’urbanisation et en favorisant une industrialisation rapide au moindre coût pour l’Etat. Dans la mesure où l’accélération des réformes dont il a fait l’objet ces dernières années maintient l’inégalité des citoyens, le hukou continue de servir la stratégie du Parti qui consiste à diviser pour mieux régner. Ces réformes remettent cependant en cause le système de statuts codifié à l’époque maoïste et, tout en instaurant une plus grande mobilité sociale, contribuent à rallier les élites au pouvoir. Ce système constitue donc toujours la clé de voûte d’un régime autoritaire dont il sert les deux priorités : maintenir la stabilité sociale et un fort taux de croissance.
Chloé Froissart
, Le système du hukou : pilier de la croissance chinoise et du maintien du PCC au pouvoir / Les Études du CERI, N°149, Septembre 2008, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Sébastien Peyrouse
Depuis le début de la décennie 2000, la République populaire de Chine s’est invitée dans le « Grand Jeu » centre-asiatique qui opposait jusque-là principalement la Russie et les États-Unis. Aujourd’hui, l’avenir de l’Asie centrale se joue en partie dans sa capacité à éviter les déstabilisations du Moyen- Orient voisin et à intégrer, via l’influence chinoise, la zone Asie-Pacifique. En moins de deux décennies, la Chine a réussi une entrée massive et multiforme dans l’espace centre-asiatique : elle s’est imposée comme un partenaire fidèle sur le plan de la diplomatie bilatérale et a réussi à faire de l’Organisation de coopération de Shanghai une structure régionale appréciée par ses membres. Elle est devenue un acteur économique de premier plan en Asie centrale, dans le secteur commercial, dans le domaine des hydrocarbures et dans celui des infrastructures. Toutefois, les phobies sociales liées à cette présence grandissante de Beijing se sont développées en parallèle et nombre d’experts centre-asiatiques spécialisés sur la Chine ne cachent pas leurs appréhensions politiques, économiques et culturelles face à un voisin avec lequel il sera difficile de gérer sur le long terme un tel différentiel de puissance.
Sébastien Peyrouse
, La présence chinoise en Asie centrale. Portée géopolitique, enjeux économiques et impact culturel / Les Études du CERI, N°148, Septembre 2008, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].André Grjebine, Eloi Laurent
La « méthode suédoise » désigne la capacité collective des Suédois à s'adapter, dans la période contemporaine, aux défis économiques et sociaux auxquels ils sont successivement confrontés. Notre étude tente à cet égard de poser et d'éclaircir deux questions : quels sont les ressorts profonds de la « méthode suédoise » ? Comment évaluer sa pérennité dans la phase actuelle de mondialisation ? En somme, nous voulons déterminer dans quelle mesure la confiance et la cohésion sociale, au coeur du succès suédois, pourraient être affectées par les changements de politique publique qu'induit une stratégie d'ouverture et d'adaptation dont la Suède a beaucoup poussé les feux ces dernières années. Après avoir passé en revue la littérature sur les rapports entre confiance, cohésion sociale et performance économique afin de mesurer l'importance respective des facteurs de cohésion sociale, nous montrons comment ces composantes se sont institutionnalisées selon trois logiques socioéconomiques, la Suède ayant choisi la voie sociale-démocrate. L'étude revient ensuite sur les performances économiques et sociales de la Suède dans la période contemporaine et détaille sa stratégie de croissance actuelle, typique d'un « petit » pays. Nous détaillons finalement l'évolution des politiques macro-économiques, fiscales, d'immigration et d'éducation et nous mettons en avant l'affaiblissement des protections collectives et l'altération de certaines politiques publiques déterminantes – altération qui pourrait à terme remettre en cause la stratégie de gouvernance suédoise par l'affaiblissement de la cohésion sociale.
André Grjebine, Eloi Laurent
, La méthode suédoise : la cohésion sociale au défi de l’adaptation / Les Études du CERI, N°147, Septembre 2008, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].José Allouche, Jean-Luc Domenach, Chloé Froissart, Patrick Gilbert, Martine Le Boulaire
José Allouche, Jean-Luc Domenach, Chloé Froissart, Patrick Gilbert, Martine Le Boulaire
, Les entreprises françaises en Chine. Environnement politique, enjeux socioéconomiques et pratiques managériales / Les Études du CERI, N°145-146, Juillet 2008, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Antoine Vion, François-Xavier Dudouet, Eric Grémont
L’étude propose d’analyser les liens complexes entre standardisation et régulation des marchés de téléphonie mobile selon une perspective d’économie politique tenant compte, dans une perspective schumpetérienne, des déséquilibres de marché et des phénomènes monopolistiques associés à l’innovation. Elle vise d’abord à souligner, pour les différentes générations de réseaux (de 0 G à 4G), la particularité de cette industrie en matière de retour sur investissement, et le rôle clé que tient la standardisation des réseaux dans la structuration du marché. Cette variable-clé du standard explique en grande partie la rente qu’a représenté le GSM dans les dynamiques industrielles et financières du secteur. L’étude explore ainsi les relations entre les politiques de normalisation, qui ne sont évidemment ni le seul fait d’acteurs publics ni de simples règles de propriété industrielle, et les politiques de régulation du secteur (attribution de licences, règles de concurrence, etc.). Elle souligne que les vingt-cinq dernières années rendent de plus en plus complexes les configurations d’expertise, et accroissent les interdépendances entre entrepreneurs de réseaux, normalisateurs et régulateurs. Dans une perspective proche de celle de Fligstein, qui met en avant différentes dimensions institutionnelles de la structuration du marché (politiques concurrentielles, règles de propriété industrielle, rapports salariaux, institutions financières), il s’agit donc ici de souligner les relations d’interdépendance entre diverses sphères d’activité fortement institutionnalisées.
Antoine Vion, François-Xavier Dudouet, Eric Grémont
, Normalisation et régulation des marchés : la téléphonie mobile en Europe et aux Etats-Unis / Les Études du CERI, N°144, Avril 2008, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Shahrbanou Tadjbakhsh
Au cours des dix dernières années, les modalités de l’engagement international dans les opérations de rétablissement de la paix ont évolué. Une comparaison entre les accords qui en 1997 ont marqué la fin de cinq ans de guerre civile au Tadjikistan, et le début de l’intervention en Afghanistan menée dans un contexte international de guerre contre le terrorisme, en témoigne. Elle met l’accent sur les défis auxquels ces interventions ont dû faire face : l’échec des phases de stabilisation, de transition et de consolidation du rétablissement de la paix ; le manque de netteté des véritables motifs de l’engagement international ; l’ambiguïté des méthodes utilisées pour la reconstruction des Etats concernés et l’appropriation des processus de paix par les Etats engagés. Le succès du processus de paix au Tadjikistan peut être attribué à la collaboration entre organismes internationaux et puissances régionales, mais aussi à l’ordonnancement progressif des différentes étapes : négociations autour du partage du pouvoir puis consolidation et reconstruction de l’Etat. En revanche, l’échec du rétablissement de la paix en Afghanistan s’explique en partie par la diversité des motifs de l’engagement international, l’isolement de l’alliance occidentale dans la région et les positions prises dans la guerre par certains acteurs extérieurs. Quoi qu’il en soit, seule l’appropriation du processus de paix par les populations locales lui confère la légitimité propre à le pérenniser
Shahrbanou Tadjbakhsh
, International Peacemaking in Tajikistan and Afghanistan Compared: Lessons Learned and Unlearned / Les Études du CERI, N°143, Avril 2008, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
, Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale 2007 (volume 2) / Les Études du CERI, N°142, Décembre 2007, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
, Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale 2007 (volume 1) / Les Études du CERI, N°141, Décembre 2007, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Alexandrine Brami Celentano, Jean-Marc Siroën
Depuis les années 1970 on observe dans le monde un mouvement de démocratisation, d’ouverture et de décentralisation. Le Brésil a suivi cette tendance avec une constitution démocratique et décentralisatrice et une politique libérale d’ouverture. Toutefois, depuis le plan Real (1993), on y observe une tendance à la recentralisation. La forte augmentation des dépenses publiques se réalise au profit de l’Union qui impose de nouvelles contraintes aux États et Municipalités. Si l’intégration internationale est souvent associée à la limitation des prélèvements et à la décentralisation, le Brésil s’écarterait de la tendance générale. Toutefois l’intégration du Brésil est récente et limitée. Elle ne semble pas avoir aggravé des inégalités qui justifieraient un transfert « centralisé » des régions « gagnantes » vers les régions « perdantes ». La recentralisation budgétaire associée à l’augmentation des dépenses s’explique en partie par la volonté de réduire les inégalités initiales et de développer la protection sociale. Nous montrons qu’elle est aussi la conséquence de la structure fiscale et, notamment, de la nature des prélèvements sociaux et du mode d’imposition de la TVA (ICMS) prélevée par les États.
Alexandrine Brami Celentano, Jean-Marc Siroën
, Mondialisation et politique fiscale au Brésil / Les Études du CERI, N°140, Décembre 2007, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Le 2 décembre 2004, dans le cadre de l’opération militaire multinationale Althea, l’Union européenne a pris la relève des forces déployées en Bosnie-Herzégovine par l’OTAN après la signature des Accords de Dayton. Ce déploiement militaire européen, présenté par ses initiateurs comme un test majeur pour la PESD, s’inscrit dans une dynamique d’européanisation des dispositifs internationaux déployés dans le pays. A travers l’analyse d’Althea, il s’agit de réfléchir ici à l’émergence de savoir-faire européens en matière de gestion militaire et civile des sorties de conflit. Abordant Althea à partir des expériences des acteurs de terrain, la réflexion porte en particulier sur les conditions d’inscription de la présence européenne dans une histoire plus longue des interventions internationales en Bosnie-Herzégovine, les difficultés de l’articulation entre les divers acteurs européens et les défis d’une appropriation, par les acteurs locaux comme par les militaires déployés, de la mission « européenne ». L’étude souligne enfin la complexité de la formulation d’une politique européenne d’exit, dont la rationalité obéit davantage à des logiques institutionnelles intraeuropéennes qu’à une évaluation sereine de la situation en Bosnie- Herzégovine.
Bayram Balci
L’Azerbaïdjan post-soviétique est le théâtre d’un renouveau de l’islam dans l’espace public, conséquence directe de la sortie de l’empire et de l’accession à l’indépendance qui s’est traduite par une réhabilitation du religieux, voire par l’intégration de l’islam à la nouvelle politique identitaire nationale. L’Azerbaïdjan se singularise dans toute l’ex-URSS par le fait qu’il est le pays musulman le plus laïcisé à cause d’une entrée précoce dans le giron de la Russie et parce qu’il fut longtemps le terrain d’affrontements idéologiques entre les Empires perses chiites et l’Empire ottoman sunnite. La convergence de facteurs internes – un islam préservé en dépit d’une politique soviétique antireligieuse – et externes – l’influence des pays voisins, Turquie, Iran et monde arabe – a présidé à la recomposition de l’islam azerbaïdjanais après la chute du communisme. Soucieux de préserver une laïcité qui fait la fierté de ses élites et de veiller à ce que le renouveau religieux ne crée pas de tensions entre les deux composantes (chiite et sunnite) de sa population, l’Etat a mis en place, avec difficulté et parfois une certaine maladresse, une politique religieuse loin d’être acceptée par tous. Toutefois, même contestées dans leur gestion de l’islam, les autorités azerbaïdjanaises contrôlent le phénomène religieux par une politique qui oscille entre tolérance et répression.
Bayram Balci
, Le renouveau islamique en Azerbaïdjan, entre dynamiques internes et influences extérieures / Les Études du CERI, N°138, Octobre 2007, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Depuis le début de la guerre en 2002, un mouvement social d’ampleur inédite s’est affirmé en Côte d’Ivoire, celui de la « Jeunesse patriotique », qui se mobilise dans la violence d’un discours ultranationaliste et anticolonialiste. Encadrés par des organisations de masse qui quadrillent l’espace urbain, les Jeunes patriotes sont devenus des acteurs centraux du jeu politique et une arme de choc au service du pouvoir. Tout en reconnaissant cette instrumentalisation politique, l’Etude dépasse les lectures fonctionnalistes du phénomène des Jeunes patriotes pour tenter d’en saisir les ressorts sociologiques et d’en mesurer la portée. Fondée sur des enquêtes inédites menées à Abidjan auprès de militants de base de la « galaxie patriotique », elle démontre que dans la grande geste nationaliste se joue également l’émergence d’une nouvelle génération politique, passée par le syndicalisme étudiant de la Fesci, qui aujourd’hui réclame violemment des droits et une reconnaissance sociale. Le registre anticolonialiste apparaît, dans cette hypothèse, comme un langage d’énonciation d’une révolution générationnelle, d’émancipation d’une fraction de la jeunesse ayant expérimenté la violence dans la lutte syndicale et dans la guerre. Elle s’interroge in fine sur l’influence de ce phénomène quant aux perspectives de sortie de crise. Par-delà ses dimensions institutionnelles, l’accord de Ouagadougou n’ouvre-t-il pas la voie à un changement de génération politique, celles des « fescistes » – patriotes et rebelles confondus – qui aura su s’imposer aux héritiers de l’houphouëtisme ?
Isabelle Rousseau
Dans un environnement complexe, où se multiplient les incertitudes et les risques sur les plans économique, géopolitique et climatique, les compagnies pétrolières – nationales et internationales – ont cherché à rationaliser leurs structures organisationnelles pour mieux résister à la compétition. C’est le problème qu’affronte Pemex, la société nationale pétrolière mexicaine qui occupe le troisième rang mondial en termes de production de pétrole. Le processus de réformes n’est pas aisé car il implique des changements à la Constitution alors que, avec le processus de démocratisation du pays, aucune force ne domine l’échiquier politique. Les équipes qui ont dirigé Pemex depuis le début des années 1990 se sont efforcées de répondre aux questions suivantes : quelles sont les modalités organisationnelles qui, dans un tel contexte, pourraient permettre à Pemex de conserver son statut d’entreprise d’Etat tout en fonctionnant d’après les modalités et les critères en vigueur dans le secteur privé ? Plus concrètement, comment simuler un environnement de marché au sein d’un monopole d’Etat sans modifier le texte constitutionnel, comment forger une nouvelle culture d’entreprise alors que le tout puissant syndicat pétrolier fonctionne selon une vieille logique corporatiste et comment introduire des critères de responsabilité sociale lorsque les traditions discrétionnaires ont été de mise ? Face aux réponses que ces responsables ont apportées, quel bilan peut-on faire aujourd’hui des réformes entreprises ?
Isabelle Rousseau
, A la recherche d’une meilleure gouvernance d’entreprise : Petróleos Mexicanos (Pemex) / Les Études du CERI, N°136, Juillet 2007, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].La crise somalienne a été appréciée par la communauté internationale à l’aune de ses intérêts plus que dans sa réalité nationale. Après avoir échoué à concevoir une véritable réconciliation entre 2002 et 2004, les pays occidentaux se sont préoccupés de faire survivre un gouvernement sans véritable légitimité, mais soutenu par l’Ethiopie et le Kenya. L’émergence des Tribunaux islamiques en juin 2006 a reconfiguré la donne. Plus que leur radicalisation, deux arguments ont décidé du retour de la guerre : l’Ethiopie ne pouvait accepter de voir surgir sur son flanc sud un pouvoir autonome et ami de l’Erythrée, les Etats-Unis voulaient affirmer l’absolue primauté de la lutte antiterroriste sur toute autre considération. Une telle posture permettait de tester une nouvelle doctrine de sécurité donnant au Pentagone un ascendant sur la poursuite des supposés terroristes et permettant de coopter de nouvelles puissances régionales sur le continent africain, les alliés européens se montrant une fois de plus singulièrement atones face à cette nouvelle dérive militariste de Washington. Incapable d’occuper l’espace politique, le gouvernement transitoire somalien a poussé à la radicalisation. La perspective d’un nouvel Irak à l’africaine se dessinait dès la précaire victoire de l’Ethiopie en janvier 2007.
Ioulia Shukan
Depuis la Révolution orange de l’automne 2004 qui a permis l’arrivée au pouvoir de l’ancienne opposition politique réunie autour de la candidature de Viktor Iouchtchenko, l’Ukraine connaît une nouvelle phase de transition. Si le changement est perceptible sur de nombreux plans, l’héritage économico-politique du régime autoritaire de Leonid Koutchma continue à peser sur la vie politique du pays. La combinaison d’une approche sociologique des acteurs et d’une analyse institutionnelle permet d’évaluer les changements à partir de deux enjeux clefs : la dissociation du pouvoir politique et des intérêts économiques et la réforme constitutionnelle. L’attitude de l’équipe orange au pouvoir à l’égard des oligarques a beaucoup évolué, passant de la menace d’expropriations par reprivatisation à la reconnaissance de leur poids dans l’économie nationale. Un retour sur les termes de la réforme constitutionnelle permet de montrer que si celle-ci a rendu possible une cohabitation politique inédite au sommet de l’Etat entre un Président et un Premier ministre de tendances opposées, elle rencontre cependant de sensibles difficultés de mise en place, donnant lieu à des conflits d’interprétation et à des affrontements entre les chefs de l’Etat et du gouvernement pour la redéfinition de leurs champs de compétences respectifs. Ces transformations ont pour conséquence une modification récurrente des règles du jeu politique et sont susceptibles de remettre en cause les progrès accomplis sur le plan de la démocratisation.
Ioulia Shukan
, Ukraine : les principaux enjeux de la vie politique depuis la Révolution orange / Les Études du CERI, N°134, Avril 2007, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Depuis une dizaine d’années, l’aide et l’investissement chinois au Cambodge ont crû de manière exponentielle, ce qui est révélateur de la montée en puissance de la Chine populaire, notamment dans les pays où elle peut s’appuyer sur une importante communauté chinoise d’outre-mer. Or l’aide chinoise, libre de toute rhétorique démocratique, peut autoriser les gouvernements qui en bénéficient à s’affranchir des conditionnalités imposées par les bailleurs de fonds, le Cambodge étant l’un des pays les plus tributaires de l’aide publique au développement. Une analyse en termes de contingence historique renvoie à la conjonction de deux processus d’accaparement rentier de l’économie, en Chine comme au Cambodge. De fait, l’aide et l’investissement chinois contribuent à consolider une économie politique fondée tout à la fois sur l’arbitraire, le renforcement des inégalités et de la violence, et le chevauchement des positions de pouvoir et d’accumulation. A cet égard, l’aide des autres donateurs est partie prenante de l’analyse, non seulement parce qu’elle se trouve désormais en concurrence avec l’aide chinoise, mais aussi, et avant tout, parce qu’elle a concouru depuis les Accords de Paris, certes indirectement, à asseoir le pouvoir du Premier ministre Hun Sen.
Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
, Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale 2006 (volume 2) / Les Études du CERI, N°132, Décembre 2006, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].Jean-Pierre Pagé
Jean-Pierre Pagé
, Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale 2006 (volume 1) / Les Études du CERI, N°131, Décembre 2006, [en ligne, www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude].









