Accueil>Qui est Fariba Adelkhah ? La chercheuse reçoit le Prix Irène Joliot-Curie de la Femme scientifique 2020
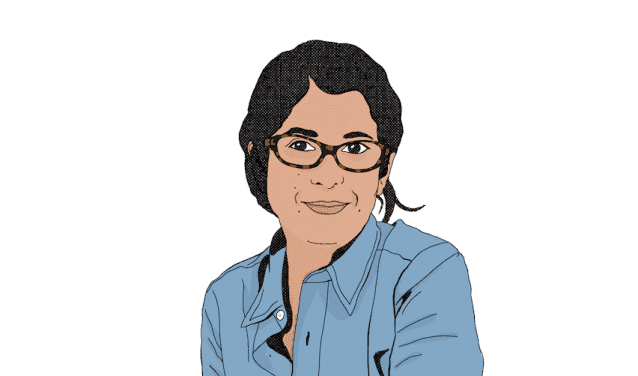
12.10.2019
Qui est Fariba Adelkhah ? La chercheuse reçoit le Prix Irène Joliot-Curie de la Femme scientifique 2020
Fariba Adelkhah a reçu en décembre 2020 le Prix Irène Joliot-Curie de la Femme scientifique de l'année 2020, décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. À cette occasion, nous republions le portrait scientifique de la chercheuse du Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI) incarcérée en juin 2019 en Iran, et toujours assignée à résidence à Téhéran depuis octobre 2020.
Par Jean-François Bayart (portrait publié en octobre 2019)
Une chercheuse de terrain
Fariba Adelkhah est née en 1959, à Téhéran, dans une famille de la petite classe moyenne originaire du Khorassan. Ce détail n’est pas anecdotique. Fariba Adelkhah a consacré certains de ses travaux à cette région, qui reste l’un de ses terrains favoris. Le Khorassan lui a aussi fourni un tremplin pour déployer des recherches sur l’Afghanistan voisin, dans les années 2010. En effet, il vit en symbiose avec ce pays au point de constituer avec lui un « Grand Khorassan » sur lequel Fariba Adelkhah a très tôt attiré l’attention. Pour des raisons historiques : l’ouest de l’Afghanistan a fait partie des « pays protégés » des dynasties iraniennes jusqu’au milieu du 19e siècle, et des Hazara se sont réfugiés dans l’empire qajar, à la fin du 19e siècle, à la suite de la politique d’extermination conduite à leur encontre par Kaboul. Et aussi, bien sûr, pour des raisons économiques et sociales plus contemporaines, liées aux infrastructures routières et ferroviaires, au commerce, à la contrebande, au trafic de narcotiques, à l’immigration, aux flux de réfugiés qu’ont engendrés les différentes phases de la guerre en Afghanistan depuis 1980.
Par ailleurs, Ali Shariati, l’un des grands idéologues de la révolution iranienne de 1979, auquel la République islamique tournera le dos, était issu d’un lignage khorassanais de clercs. Comme la plupart des étudiants de sa génération, Fariba Adelkhah l’a lu et reste marquée par son exigence de vérité et de justice, au sens que revêt le terme de haqq dans la philosophie mystique du chiisme iranien.
Étudiante, Fariba Adelkhah fit une autre lecture qui la marqua tout autant : Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui avait été traduit en farsi. On ne peut sans doute pas comprendre son choix d’entamer des études de sociologie en France, à l’Université de Strasbourg, à l’automne 1977, si l’on ne garde pas à l’esprit ce fait.
La Révolution sous le voile : une œuvre d'anthropologue
Néanmoins, Fariba Adelkhah n’a jamais coupé les ponts avec l’Iran où elle a continué de se rendre chaque année pour voir sa famille, mais aussi pour y mener ses premières enquêtes de terrain, sous les bombes irakiennes, dans la perspective de son doctorat en anthropologie, à l’École des hautes études en sciences sociales, sous la direction de Jean-Pierre Digard. Son objet était la mouvance des femmes révolutionnaires se réclamant de l’islam, dont elle a fait une analyse subtile et nuancée en concentrant son propos sur leurs pratiques du voile et sur leurs réunions religieuses (jaleseh). Elle en a tiré son premier livre, La Révolution sous le voile. Femmes islamiques d’Iran (Karthala, 1991) qui a pu donner lieu à malentendu car il a immédiatement été lu à la lumière d’un double débat (ou combat) idéologique, celui des laïcistes français, et celui du féminisme nord-atlantique, très occidentalo-centré. En réalité, Fariba Adelkhah n’a rien d’une « femme islamique », même si elle connaît de l’intérieur la religiosité de son pays natal, de par son éducation, au contraire de la plupart des chercheurs en sciences sociales d’origine iranienne, généralement issus de milieux aisés et très sécularisés. Elle a fait œuvre d’anthropologue, et non d’idéologue, soulignant à l’envi que sa recherche ne portait que sur une catégorie de femmes, dans un contexte historique précis, et n’avait aucune portée générale, notamment pas à l’aune des polémiques françaises sur le voile. De même, sa recherche actuelle sur la circulation des clercs, en particulier afghans, dans l’espace transnational qui couvre l’Afghanistan, l’Iran et l’Irak, s’inscrit dans une réflexion plus générale et ancienne, qu’elle a entamée dès le milieu des années 1990, sur la place du voyage dans la société iranienne.
En réalité, son maître, outre Jean-Pierre Digard, a été l’anthropologue Gérard Althabe (1932-2004) dont elle a toujours admiré l’œuvre, l’humanité et la modestie. Aussi son anthropologie ne s’en tient-elle ni à la question féminine ni à celle de l’islam, comme on a tendance à la présenter. Bien au contraire, Fariba Adelkhah s’est à plusieurs reprises insurgée, en particulier dans des articles de la revue Politix, contre le réductionnisme des interprétations publiques de la République islamique et contre le cantonnement d’une bonne partie des sciences sociales au seul objet tentaculaire de l’islam.
Sans délaisser ces questions des femmes et de l’islam, les deux livres les plus importants de Fariba Adelkhah, Être moderne en Iran (Karthala, 1998) et Les Mille et une frontières de l’Iran. Quand les voyages forment la nation (Karthala, 2012), réfléchissent à des problématiques beaucoup plus larges : d’une part, celle de l’être-en-société (adam-e ejtemai) qui cherche à mettre en harmonie son extériorité (zâher) et son for intérieur (bâten), sa vie privée et sa présence dans la sphère publique, c’est-à-dire, au fond, qui travaille à l’émergence de la citoyenneté, d’un espace public, fût-il éventuellement d’orientation religieuse, de formes inédites de modernité y compris féminine ; d’autre part, la problématique des relations que l’Iran a entretenues, dans la longue durée, avec le reste du monde (et non pas seulement avec le Moyen-Orient auquel il est supposé appartenir) et qui ont contribué à en définir la société culturelle et politique contemporaine. Fariba Adelkhah a ainsi signé quelques-unes de ses pages les plus éblouissantes sur les figures, souvent très ambiguës, de la bienfaisance, sur la contrebande, sur les cimetières, sur le Hadj, sur la diaspora iranienne en Californie, à Dubaï et au Japon, sur les colombophiles, sur les immigrés afghans, sans pour autant négliger les pratiques religieuses concrètes et la scène électorale, qu’elle a analysée avec précision en montrant que la République islamique, certes non démocratique, n’était pas non plus la dictature que l’on dit.
La complexité des faits, loin des idées reçues
Cela lui a valu bien des sarcasmes et des suspicions tant de la part des opposants à la République islamique que de celle de ses services de sécurité qui l’ont interrogée et lui ont confisqué son passeport à plusieurs reprises afin d’essayer de l’intimider. Certains se sont demandés si elle n’était pas la Han Suyin du régime, prompte à refouler toute critique par naïveté ou pour ménager ses intérêts, sa liberté, son accès à ses terrains. C’était bien mal la connaître, comme l’attestent l’article qu’elle a consacré, dans la revue Esprit, à Neda, la jeune manifestante téhéranaise tuée par les forces de l’ordre lors de la contestation des résultats officiels de l’élection présidentielle de 2009, ou la lettre ouverte qu’elle a adressée au président Ahmadinejad lors du procès de la doctorante française Clotilde Reiss. Simplement, Fariba Adelkhah n’a jamais fait « de politique », ne s’est jamais posée en militante, a toujours porté un jugement équilibré sur la République islamique. En anthropologue qu’elle est, elle s’en est toujours tenue à la complexité des faits, des pratiques effectives, au risque de froisser les « idées reçues » - elle a signé un joli livre sur l’Iran dans la collection qui porte ce nom, au Cavalier bleu - et les préjugés ou les automatismes idéologiques.
L’un de ses leitmotivs a été de relativiser la césure qu’a constituée la révolution de 1979. Non qu’elle en méconnaisse l’événement, le pathos, l’émotion, qui demeurent un facteur de légitimation du régime dans la population, ne serait-ce que parce que la révolution a apporté à l’Iran, au prix fort, son indépendance par rapport aux États-Unis et que nul ne songe à la restauration de la monarchie. Mais parce que la République islamique a reconduit certaines des logiques de l’ancien régime et reproduit certains de ses intérêts, en particulier dans le domaine agraire comme elle l’a à nouveau démontré dans son Étude du CERI de 2017. En bref, sa compréhension de la révolution de 1979 est toute tocquevillienne, de même que son analyse de l’islam n’est pas sans évoquer celle du protestantisme par Ernst Troeltsch, du méthodisme anglais par Edward Thompson, ou du catholicisme breton par Michel Lagrée, auteurs qu’elle cite au demeurant.
Une enquêtrice intrépide
Fariba Adelkhah est une formidable enquêtrice de terrain, intrépide au point de se rendre au cœur du pays hazara en Afghanistan au nez et à la barbe des talibans, pratiquant l’observation participante des pèlerinages, suivant des cours de fiqh à Qom, restituant avec subtilité et ironie les faits relevés, mais avec toujours beaucoup d’empathie et de respect pour les gens qu’elle étudie. Elle nous a donné sans doute les meilleurs écrits sur l’Iran contemporain, mais bien au-delà ses livres représentent une contribution décisive à l’anthropologie, appréciée comme telle par des spécialistes d’horizons très différents ainsi que le prouve l’indignation que suscite son arrestation dans la communauté scientifique internationale.
Les accusations d’espionnage qui seront portées contre elle dans la partie de chantage diplomatique que certains décideurs iraniens ont jugé bon d’engager contre la France auront la crédibilité des réquisitoires des procès de Moscou. Ne doutons pas que seront retenues à charge ses traductions en farsi de poètes français des XVe et XVIe siècles qu’elle publiait sur un site littéraire, signe imparable de sa complicité avec l’impérialisme occidental ou, qui sait, le wahhabisme ! En réalité, Fariba Adelkhah est la victime collatérale de la stratégie de la tension de Donald Trump et des méthodes bolcheviques d’une partie de l’establishment révolutionnaire de la République islamique qui reste fidèle à son habitus de la clandestinité et de l’action violente des années 1970. Tel est le triste sort des chercheurs intègres. Ils sont la part du feu, et un butin aisé pour les extrémistes de tous bords.
Si on comprend sans peine le peu de cas que Donald Trump fait de la porcelaine universitaire quand il se déplace dans la pièce internationale, on a plus de mal à admettre l’intérêt, pour la sécurité nationale et la diplomatie de la République islamique, de jeter en prison la meilleure anthropologue de l’Iran, même si cette dernière a finalement choisi de devenir citoyenne française dès lors qu’elle vivait en France depuis 1977. Un fait résume à lui seul le prix que vaut une chercheuse dans ce « monde de brutes » : détenue à Evin par, dit-on, les Gardiens de la Révolution, soupçonnée par une partie de l’opposition iranienne en exil d’être une suppôte de la République islamique et par certains laïcards français d’entretenir une complaisance coupable à l’égard de l’islam, Fariba Adelkhah s’est vue régulièrement refuser un visa par les États-Unis où elle devait se rendre à l’invitation d’universités pour y présenter ses travaux, et ce bien qu’elle fût citoyenne française. Ainsi va la science, en cette bonne année 2019.
Jean-François Bayart, Professeur à l’IHEID (Genève), président du Fonds d'analyse des sociétés politiques (FASOPO)
Article initialement publié sur le site du FASOPO en octobre 2019
En savoir plus