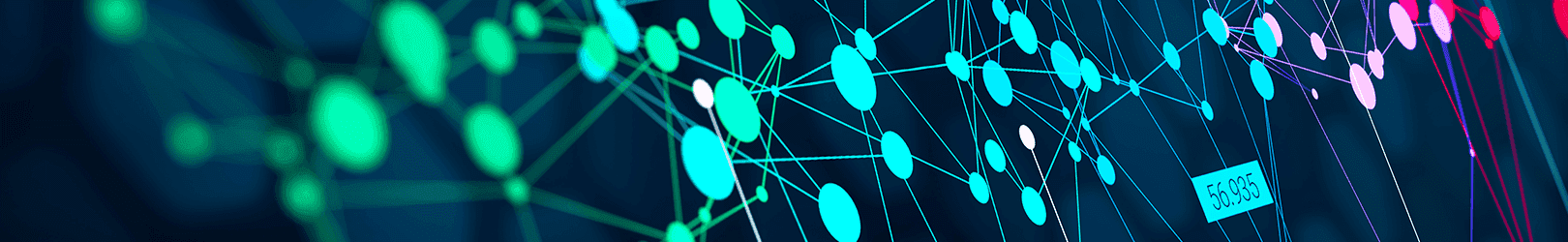
Accueil>Recherche>Projets de recherche
Projets de recherche
Le CERI a une solide expérience de gestion et d’animation des projets collaboratifs soutenus par des organismes nationaux (ANR, AFD, ministères des Affaires étrangères et des Armées, IRSEM…) ou par des dispositifs européens (Horizon 2020, ERC, HERA, bourses et réseaux Marie-Curie…).
Suivez-nous
Nous contacter
Contact Média
Coralie Meyer
Tel: +33 (0)1 58 71 70 85
coralie.meyer@sciencespo.fr
Corinne Deloy
Tel: +33 (0)1 58 71 70 68
corinne.deloy@sciencespo.fr













