Yémen. De l’Arabie heureuse à la guerre
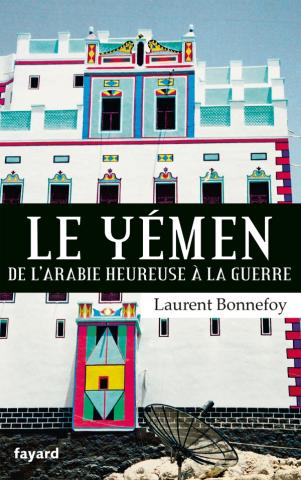
Dernier ouvrage de la collection du CERI Sciences Po chez Fayard, Le Yémen. De l’Arabie heureuse à la guerre de Laurent Bonnefoy, comblera indéniablement un vide sur ce pays resté mystérieux et fruit de fantasmes divers pour de nombreux observateurs.
Entretien avec son auteur.
Le Yémen a acquis au fil du temps l’image d’un pays interdit ou inaccessible. Pouvez-vous nous dire ce qui est à l’origine de ce « mystère » et ce qui éventuellement l’entretient ?
Le Yémen occupe en effet une place à part dans les imaginaires. Son histoire propre marquée par les spécificités de sa trajectoire – il est le territoire supposé de la Reine de Saba biblique, le siège du régime des imams zaydites qui ont régné pendant plus d’un millénaire, l’hinterland de la colonie britannique d’Aden et aussi plus récemment, le lieu où s’est construite l’unique République socialiste du monde arabe – autant que sa géographie escarpée (sa capitale, Sanaa, est perchée à 2 300 mètres) en font une usine à fantasmes. Et le pays, depuis des siècles, le rend bien à ses visiteurs tant il recèle de merveilles archéologiques, architecturales et humaines qui, pour une large part, lui sont propres et restent encore à découvrir.
De façon intéressante, le Yémen n’est pas qu’un fantasme orientaliste, il reste aussi une énigme pour les Arabes et les musulmans qui voient bien souvent en lui leur berceau civilisationnel tout en percevant avec un certain mépris son manque de développement et sa pauvreté actuels.
Parallèlement, il est aussi, pour reprendre la terminologie propre aux dépêches des agences de presse, « le pays d’origine d’Oussama Ben Laden » et a, ainsi, été associé à la menace djihadiste depuis une quinzaine d’années. Son image est ainsi indéniablement ambivalente. C’est là le point de départ de la réflexion que je mène dans mon ouvrage.
Ces images perdurent néanmoins...
Le registre de l’occultation, de l’ombre et du mystère traverse les écrits sur le Yémen rédigés par les grands voyageurs, de Marco Polo et Ibn al-Mujawir, voyageur persan du XIIIe siècle, à Joseph Kessel, en passant par Arthur Rimbaud et André Malraux.
La guerre qui a débuté en 2015 n’a pas bousculé ce rapport fondé sur le mystère. Le conflit est ainsi fréquemment décrit comme « caché » ou « ignoré », mais par qui ? De fait, son traitement médiatique, en dépit d’une crise humanitaire qualifiée par les Nations unies comme étant la plus grave de notre époque, reste minimal. C’est sans doute là un signe supplémentaire du rapport contrarié du monde au Yémen.
Il reste cependant entendu que le soutien apporté par les diplomaties américaine, française et britannique à la coalition militaire emmenée par l’Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen depuis près de trois ans et qui est accusée de crimes de guerre, en plus des juteux contrats d’armement passés avec les armées du Golfe, entretient un malaise et n’encourage guère la mise sur l’agenda de la question yéménite. Dès lors, celle-ci continue d’être largement ignorée.
L’insertion équivoque du Yémen dans les échanges contemporains peut-elle servir à éclairer la crise profonde qui touche le Moyen-Orient ?
Je pense que le Yémen est un symptôme d’un Moyen-Orient en plein bouleversement, en même temps qu’il en est un laboratoire. C’est ce qui rend son étude à la fois passionnante, nécessaire et… sans doute déchirante. Les questions liées à la polarisation confessionnelle, la transformation des équilibres régionaux, avec notamment la place de l’Arabie Saoudite qui autonomise sa politique étrangère ou encore les impasses de la politique des drones menée par les Etats-Unis, s’incarnent au Yémen, avec des effets qui n’invitent guère à l’optimisme. Par ailleurs, émergent dans ce pays des problématiques impérieuses, tout particulièrement liées à l’écologie qui devraient nous inciter à mieux comprendre ce qui s’y joue. Car il est probable que l’épuisement des ressources en eau dans les hautes terres, et notamment autour de Sanaa dans les années à venir, ne soit qu’un avant-goût des processus qui vont affecter d’autres régions du monde dans les prochaines décennies. Or qui peut prédire ce qui se passera quand on devra déménager une capitale de trois millions d’habitants ?
Vous faites référence aux travaux de Romain Bertrand en prônant une « histoire à parts égales ». En quoi une telle approche peut-elle être particulièrement fructueuse dans le cas de l’étude d’un pays comme le Yémen ?
Dans la mesure où le Yémen n’est pas seulement un fantasme pour « homme blanc », il me semblait fondamental de valoriser les sources et les points de vue non-occidentaux dans ma recherche. C’était là une ambition partagée avec les travaux de Romain Bertrand, bien que dans un registre, sur un objet et dans un cadre disciplinaire différents. Par-là, il s’agissait d’analyser dans leur diversité les interactions de la société yéménite avec, par exemple, la Corne de l’Afrique ou l’Asie du Sud-Est. Cela permettait notamment de dépasser l’idée d’une relation uniquement structurée autour d’un rapport de domination ou d’un héritage colonial. Certes, l’occupation britannique d’Aden entre 1839 et 1967 en a fait, au milieu du XXe siècle, le deuxième port le plus actif du monde, ce qui a structuré la place du Yémen dans les échanges et la mondialisation. De même, la lutte contre le terrorisme depuis 2001 et le poids de la diplomatie des Etats-Unis ont signalé une dépendance manifeste et ont reconfiguré les équilibres politiques intérieurs. Mais, et c’est le propos de mon ouvrage, le rapport au monde du Yémen s’inscrit également dans une multitude de flux de personnes, de créations et d’idées qui, par exemple concernent les étudiants indonésiens dans les instituts religieux soufis de la ville de Tarim, les professeurs irakiens coopérant dans les provinces du Yémen ou encore les commerçants de la région du Yafi‘ installés en Chine.
De plus, c’est avec l’Arabie Saoudite, et donc un cadre qui échappe aujourd’hui largement aux manifestations de la domination américaine, que le rapport inégalitaire est le plus marqué, signalant, une fois encore la fécondité d’une approche qui a le souci de chercher ses sources hors des sentiers battus d’une approche stato-centrée et univoque.
De même, vous vous proposez d’analyser le Yémen « avec le monde » : est-ce parce que vous cherchez à analyser spécifiquement les relations que le pays entretient avec ses voisins et d’autres acteurs de la scène internationale, ou cela fait-il partie d’une posture de recherche que vous adoptez (en référence, notamment, aux travaux de Patrick Boucheron) ?
De mon point de vue, appréhender les relations bilatérales du Yémen n’avait qu’un intérêt limité. Ainsi, l’idée d’étudier le Yémen « avec le monde » c'est-à-dire dans la multiplicité de ses interactions, et donc comme une entité fondamentalement ouverte, était en effet un parti pris. Celui-ci s’est initialement fondé sur une contrainte liée à mon accès contrarié au terrain yéménite du fait d’une expulsion alors que j’y travaillais et y vivais en famille, puis à cause de la détérioration des conditions sécuritaires et de la guerre. Mais progressivement cette démarche, qui m’a conduit à changer de perspective en approchant la société yéménite à travers ses interactions avec le monde, est devenue autre chose qu’un pis-aller. Etre contraint ainsi de transformer son regard, de varier son approche et de développer de nouveaux questionnements et de nouvelles méthodes de travail m’est alors apparu comme particulièrement stimulant.
Enfin, le Yémen, comme d’autres (la Syrie, la Libye, pour ne citer qu’elles) est devenu un champ de recherche dans lequel il est très compliqué de faire d'utiliser des outils des sciences sociales les plus communs. Quelles nouvelles sources existent et comment les chercheurs s’adaptent-ils et parviennent-ils à tirer parti de ces impossibilités d’accès au terrain ?
Etre privé d’accès à « son » terrain est une grande frustration, j’oserais même dire une souffrance. En effet, travailler au Yémen a été une source inépuisable d’émerveillement et mes collègues « yéménophiles » en sont témoins. Rien ne peut donc remplacer le bonheur d’y mener une enquête.
J’imagine sans peine que bien des chercheurs pensent cela de la société sur laquelle ils travaillent et où ils ont investi tant d’énergie et tant reçu. Mais il se trouve que l’évolution de la situation sécuritaire dans un nombre croissant de sociétés, tout comme les contraintes exercées par nos administrations de moins en moins promptes à laisser leur personnel prendre des risques, pose aujourd’hui bien des questions méthodologiques et impose de s’adapter.
Dans ce contexte, pour un chercheur, changer de terrain et d’objet est une stratégie admissible qui peut ouvrir de passionnantes pistes comparatives, mais cette option impose un réinvestissement qui peut être colossal. Une fois ce choix opéré, à partir de quand redevient-on « compétitif », c’est-à-dire apte à apporter du savoir, face à des collègues qui ont accumulé des décennies de lectures et d’expériences ? Par ailleurs, est-il juste d’admettre qu’on abandonne « son » objet, le laissant à quelques experts qui souvent n’en connaissent pas grand-chose, quand d’une part les ressources sont limitées et d’autre part la demande de compréhension est réelle ? Devrait-on accepter, en tant que politiste, de laisser des pans entiers du monde hors de notre réflexion au prétexte que nous ne pouvons pas y mener du travail de terrain dans les règles de l’art ?
Il me semble évidemment que non ! Même si elles demeurent insatisfaisantes, des ressources fascinantes s’offrent, à distance, pour mener des recherches dès lors que l’on a au préalable une connaissance intime de la société sur laquelle on travaille, qu’on en parle la langue, qu’on a de solides repères historiques et géographiques développés directement sur le terrain ainsi qu’une appréhension fine des travaux scientifiques qui s’y sont intéressés. En s’appuyant sur les contacts et des amitiés déjà établis, en s’informant via les réseaux sociaux – véritables puits sans fond – de nouveaux questionnements émergent et fondent une approche qui, à mon sens, n’est donc pas seulement régression. C’est cela que je tente de démontrer dans cet ouvrage.
Propos recueillis par Miriam Périer










