L'Armée en embuscade ?
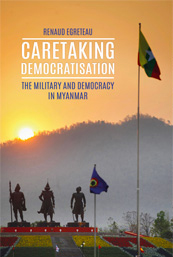
Entretien autour de la parution de
Caretaking Democratization.
The Military and Political Change in Myanmar
Avec Renaud Egreteau
La Birmanie a récemment connu des bouleversements politiques qui ont porté au pouvoir la figure de l’opposition démocratique à la dictature militaire, Aung San Suu Kyi, leader charismatique de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND). Renaud Egreteau publie un ouvrage dans lequel il montre à quel point l’armée, si elle a laissé la voie à une gouvernance démocratique du pays, reste tout de même très proche du pouvoir et prête à revenir à tout moment... Interrogé à la fois sur la situation actuelle, les défis de cette nouvelle gouvernance en Birmanie, mais également sur la façon de conduire des recherches sur un Etat jusqu’alors relativement fermé, l’auteur nous livre des réponses éclairantes.
Vous écrivez dans votre ouvrage, Caretaking Democratization. The Military and Political Change in Myanmar, que le changement de régime que connait la Birmanie depuis quelques années ouvre la porte à autre chose, en quelque sorte une inconnue, qui pourrait autant se rapprocher d’un système démocratique, que remodeler un système autoritaire. Existe-il réellement des risques sérieux d’un retour à une forme de dictature militaire?
Cela dépendra des nouvelles générations de chefs militaires. L’armée birmane considère qu’elle « guide » une transition qui est en cours, selon elle, depuis le coup d’état de 1988. C’est l’armée qui contrôle le processus, et ce jusqu’à présent selon ses propres termes. Elle a aujourd’hui réussi ce tour de force d’obtenir ce que ses chefs avaient planifié dès le début des années 1990 : une position d’arbitre de la scène politique accompagnée de larges garanties immunitaires. Il n’est donc pas du tout sûr que la hiérarchie militaire ait aujourd’hui envie de faire marche arrière, de reformer une junte et de reprendre la totalité du pouvoir en main. L’armée reste persuadée de son essentialité, certes, mais elle semble dorénavant souhaiter laisser le soin aux civils, et particulièrement à ses opposants historiques comme la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND), d’assumer la gestion administrative et politique du pays au quotidien. « L’intendance suivra », disait le général de Gaulle. C’est un peu la conception de l’armée birmane actuellement. Mais d’un autre côté, les militaires birmans ont été formatés à l’intervention depuis l’indépendance du pays en 1948. Dès lors qu’un problème émerge, c’est un militaire qui se charge d’y apporter une réponse. Si le pays se montre de moins en moins gouvernable, que de nouvelles insurrections émergent, que la société s’enfonce dans de nouvelles vagues de tensions communautaires, notamment entre populations musulmanes et bouddhistes, alors oui, il y a de fortes chances que l’armée reprenne la main. Mais si la société birmane, si résiliente depuis les années 1950, poursuit, cahin-caha ses efforts de libéralisation et de démocratisation tout en maintenant un certain niveau de développement économique, l’armée pourrait se contenter de s’asseoir sur ses privilèges, tant qu’ils ne sont pas remis en cause, en laissant les civils gouverner tant bien que mal.
Si oui, paradoxalement pensez-vous que les évolutions démocratiques – les instances mises en place – pourraient jouer un rôle dans ce retour à une forme de régime autoritaire? Si oui, lequel et pourquoi?
Ce que l’on voit poindre dans ce contexte transitionnel, ce sont les réveils de tensions et de conflits longtemps larvés, étouffés même par la dictature militaire. Ce sont des phénomènes propres à toute transition ou révolution qui entraine une redéfinition des équilibres politiques au sein même des élites d’une société, ainsi qu’entre les élites et le reste de la population. Ce mélange de conflits sociaux qui (ré)émergent, d’agitation populaire, de formation de nouvelles élites contestant l’ordre institutionnel établi après la disparition de la dictature, l’apparition de nouvelles idéologies sont autant de défis pour l’administration en charge du régime hybride qui succède au régime autoritaire. La Birmanie n’y échappe pas, et il y a de fortes chances que les bases institutionnelles de ce régime « post-junte » commencent peu à peu à être contestées, alors que l’armée reste en position de force.
Les conflits ethniques et communautaires sont-ils par ailleurs un risque pour la toute jeune démocratie ?
Cette question était déjà posée en 1948, lors de l’Indépendance du pays. Elle est toujours d’actualité parce que les solutions proposées par les gouvernements successifs, démocratiques dans les années 1950, comme militaires ou semi-militaires depuis, n’ont pas permis d’apporter une solution durable aux questions ethniques et religieuses. Des décennies d’impasse politique, de guerre civile et de migrations, forcées ou volontaires, ont aussi fait leur œuvre. Comment gérer désormais une mosaïque ethnique qui s’avère bien plus hétéroclite et complexe aujourd’hui que dans les premières années d’indépendance ? Quelle place accorder à la religion dans un pays majoritairement bouddhiste mais qui n’a jamais véritablement tranché la question de la séparation de l’état et des religions ? Par-delà de nobles intentions, la LND s’est montrée discrète sur ces sujets, préférant annoncer sa volonté d’établir un très long processus de dialogue inter-ethnique, plutôt que de s’engager dans une grande révolution politique et administrative du pays.
Vous écrivez, p. 47 : « (...)if history is any guide in Myanmar, there are serious reasons to be quite pessimistic about the re-emerging multiparty scene’s capacity to move beyond fragmentation, clientelism and the personification of power ». Pourriez-vous commenter cette phrase ? En particulier ce que vous entendez par fragmentation, clientélisme et personnification du pouvoir dans le contexte birman ? La LND semble aujourd’hui unifiée derrière sa dirigeante, Aung San Suu Kyi. C’est bien là le problème. Qu’en sera-t-il après-elle ?
Comment la LND, en tant que machine bureaucratique, pourra-t-elle survivre à son leader charismatique et surmonter ses failles potentielles, échecs ou erreurs politiques à venir? Comment gérer les tensions internes ? Ces questions se sont posées pour tous les partis politiques birmans qui ont émergé depuis l’indépendance et n’ont jamais su s’institutionnaliser, créer des mécanismes internes à même de gérer les rivalités, les voix discordantes, et les idéologies contradictoires en leur sein et continuer d’exister. Trop souvent, les partis politiques n’ont été que de simples instruments servant l’intérêt et les ambitions d’une personne charismatique et de son entourage de fidèles dont la loyauté doit être absolue. Comme dans de nombreuses autres sociétés en voie de développement, le pouvoir est à la fois personnifié et personnalisé en Birmanie. Les partis politiques birmans peinent ainsi à gérer la dissidence en leur sein, comme ils peinent à survivre la disparition de leur leaders. Ceci explique le nombre impressionnant de scissions et autres schismes qu’ont connu tous les partis birmans. Y compris la LND dès 1988 avec le conflit personnel entre U Aung Gyi et U Tin Oo, deux anciens généraux, ou bien lors de la campagne électorale de 2010 qui a vu la création de la Force démocratique nationale (NDF) par des dissidents souhaitant s’opposer au boycott prôné par la direction centrale.
En un mot, étant donné ce contexte, le sort de la transition en cours et la conduite du processus de consolidation démocratique de « l’après-junte » semblent dépendre d’une seule personne, de ses capacités,… et de son espérance de vie.
L’ouvrage montre clairement que l’armée ne s’est pas complètement retirée des instances du pouvoir politique. Est-il un pouvoir en particulier au sein duquel sa présence reste forte ? L’armée peut-elle accepter de ne plus « être » l’Etat ?
L’armée se définit désormais comme le décideur en dernier ressort. Elle laisse le pouvoir civil, désormais incarné par la LND, gérer l’intendance et prendre en charge l’administration quotidienne du pays. Le risque est désormais de voir l’armée passer d’une situation dans laquelle elle « était » l’état, et l’incarnait, comme Louis XIV affirmait en son temps, « l’état c’est moi », à une configuration dans laquelle l’armée devient un « état dans l’état ». A mesure que la LND, désormais forte d’une majorité parlementaire, commence à repousser les limites que l’armée lui a attribuée, notamment à travers la constitution de 2008, il y a de fortes chances que l’institution militaire se retranche autour de ses domaines réservées, de son assise économique et de son immunité, les défendant, et se montrant de moins en moins coopérative avec le pouvoir civil.
Revenons à votre parcours de recherche. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur un régime qui jusqu’à récemment était très fermé. Quelle trajectoire vous a mené à travailler sur cet Etat, et qu’est ce qui vous a particulièrement intéressé dans son étude?
Lorsque j’ai entamé mes études supérieures, j’avais déjà derrière moi une longue association avec l’Asie, par de nombreux voyages en Chine, au Sri Lanka, au Japon ou en Inde, étant enfant. J’ai ainsi cherché à approfondir cette association une fois étudiant et commencé à Paris un cycle d’études en langues et civilisations orientales, à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). Mon premier choix fut l’Asie du Sud, et l’Inde en particulier. Avant de poursuivre mon cursus universitaire en science politique à Sciences Po Paris, une discussion avec Christophe Jaffrelot, qui allait diriger mes recherches doctorales, m’orientait vers l’étude des relations entre deux pays héritiers du « Raj » colonial britannique, l’Inde et la Birmanie. C’était au printemps 2001. Je suis donc venu à la Birmanie par l’Inde et le sous-continent indien auquel la société birmane doit nombre de ses traditions politiques et culturelles, et non par la Thaïlande et l’Asie du Sud-est, a l’instar de beaucoup de mes collègues. Comment est-il possible de mener à bien des recherches en sciences sociales dans un Etat fermé dirigé par des militaires ?
Comment est-il possible malgré tout d’avoir accès à des sources de première main ?
Il est trompeur de penser que le pays s’est « ouvert » au monde au cours de la décennie 2010. La réelle ouverture, celle qui a permis la formation d’une nouvelle génération de chercheurs et de reporters spécialistes de la Birmanie, a eu lieu en 1988 au moment du soulèvement estudiantin de Rangoun, et de l’apparition d’Aung San Suu Kyi sur la scène politique de son pays.
Malgré le coup d’état de septembre 1988 et l’instauration d’une nouvelle dictature, cette dernière n’a pas refermé le pays sur lui-même comme il l’avait été entre 1962 et 1988, du temps du général Ne Win. Dans les années 1970, les visas accordés aux étrangers ne l’étaient que pour trois jours. Dans les années 1990 et 2000, ils sont passés à quatre semaines. Cela a permis à de nombreux anthropologues, linguistes, historiens, politologues, et même grands reporters, de parcourir une grande partie du pays. C’est ainsi que j’ai découvert cette société birmane au cours de la décennie 2000, par des terrains et voyages réguliers, de Rangoun a Myitkyina en passant par Sittwe et Kengtung, sans oublier les frontières accessibles depuis le Yunnan, la Thaïlande, et même le Bangladesh et le Manipur indien. La Birmanie des années 2000 n’était pas la Corée du Nord, et pour qui savait s’y promener, de nombreuses données, observations et même interviews, pouvaient y être glanés, çà et là.
On peut toutefois imaginer que l’ouverture – un terme à prendre avec précaution, donc - et la transition qui s’opère en Birmanie depuis quelques années permettent un accès plus facile au matériau de la recherche... Le régime permet-il l’accès aux archives?
Oui, malgré le fait que conduire des recherches était tout à fait possible avant la transition de 2011, la différence est notoire. Avant 2011, l’accès direct aux élites politiques était réduit. L’accès aux opposants, surtout, était des plus risqués, de même que la distribution et la collecte de questionnaires par exemple - outil très utilisé par les politologues. Depuis 2011, en revanche, un étranger peut rencontrer un ancien prisonnier politique dans un lieu public sans attirer l’œil des services de renseignements, accéder aux institutions étatiques comme le parlement ou les ministères basés à Naypyitaw, et même rencontrer des haut-gradés de l’armée. Concernant les archives, encore une fois, 1988 a marqué la véritable ouverture du pays. Mary Callahan, l’une des rares spécialistes de l’armée birmane, a ainsi été autorisée dès 1991 à consulter les archives de l’armée birmane pour la période pré-1962. Le principal souci n’est pas l’accès aux archives, qui peut certes être souvent bloqué sans véritable raison avancée. C’est surtout l’absence d’organisation et d’efficacité, et de classification ordonnée des fonds d’archives qui pose problème, et ce même si des efforts ont été faits lors du transfèrement, à partir de 2005, d’un grande partie des archives nationales de Rangoun vers la nouvelle capitale, Naypyitaw. Dans bien des cas, les archivistes birmans ne savent tout simplement pas si le fond existe, ou s’il a été classé. Mais il est tout à fait possible de faire des recherches auprès des Archives Nationales.










