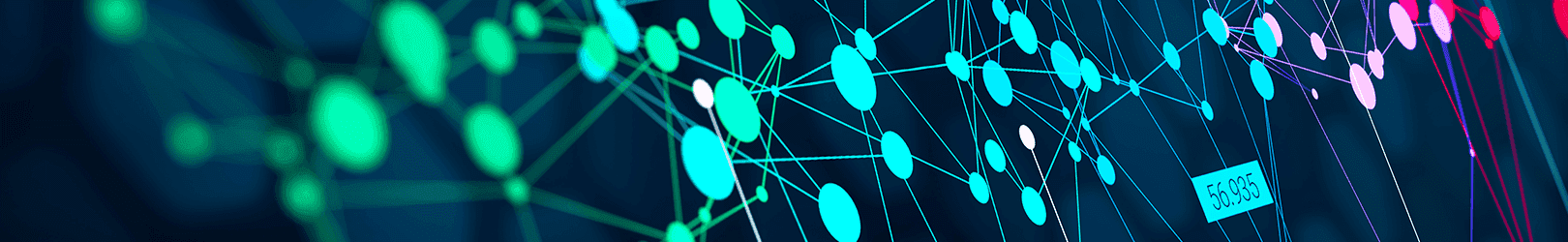
Accueil>Recherche>Projets de recherche>La fabrique de la vérité électorale. Controverses nationales et circulations internationales (Verelect)
La fabrique de la vérité électorale. Controverses nationales et circulations internationales (Verelect)
À propos

Ce projet a pour objectif d’analyser, dans une perspective comparée et transnationale, la construction de « la vérité électorale », comprise comme un accord publiquement exprimé sur les règles de la compétition politique et par conséquent l’acceptation des résultats des élections. En effet, les dénonciations de fraudes sont au cœur de la compétition politique dans de nombreux pays, et les questionnements sur la validité des scrutins au cœur de légitimité démocratique ; malgré le rôle croissant d’experts navigant d’ONG en organisations internationales, et alors même que les élections n’ont jamais été aussi technicisées et contrôlées, elles apparaissent de plus en plus contestées.
Selon des logiques tantôt de coopération, tantôt de concurrence, les multiples acteurs participant à l’organisation et au contrôle des élections – partis, bureaucraties électorales, experts nationaux et internationaux, juges – contribuent souvent à mettre en doute la robustesse des résultats. Ils sont porteurs de visions concurrentes – techniques et morales - de ce qu’est une « bonne élection ».
Dans le même temps, la construction sociale de la « transparence électorale » est au cœur de débats experts et technologiques, portés par des intérêts variés, aux niveaux national mais aussi international. De nombreuses normes et pratiques en matière électorale circulent dans les arènes internationales. Le projet s’attache à retracer la construction d’un milieu d’experts internationaux. Par ailleurs, certaines technologies électorales (identification biométrique, e-vote, machines à voter, transmission électronique des résultats…) sont développées et commercialisées par des entreprises privées et étrangères, et donc soumises à des logiques marchandes et de transaction parfois corruptive. Ces logiques de circulation et de diffusion répondant à divers investissements placent la question de la matérialité électorale au cœur de l’expertise démocratique internationale.
Parallèlement à ces tendances à la technicisation et à l’emprise croissante de l’expertise, on assiste à des formes de « vernacularisation » de l’élection : des groupes affinitaires, mais aussi des groupes porteurs d’intérêts hétérogènes se saisissent des enjeux électoraux, alimentent des controverses, et parfois produisent des vérités alternatives et les diffusent largement, notamment sur les réseaux sociaux. Ces contestations et la production de ces vérités alternatives ne se font pas uniquement selon des logiques partisanes, mais répondent à des logiques souvent plus complexes, qui constitueront l’un des axes d’investigation du projet.
Notre questionnement comparatif sera abordé depuis des terrains à conflictualité de long cours (Mexique, Kenya) et des terrains à conflictualité plus récente (Egypte, Turquie, Ouganda, Brésil). La circulation de normes et de pratiques sera étudiée par le biais de plusieurs terrains transnationaux.
Réseaux
Retrouvez la page Hypothèses du projet
Partenaires
Responsables

- Hélène Combes, responsable scientifique du projet
- Elise Massicard, responsable de l'équipe CERI
- Marie-Emmanuelle Pommerolle, responsable de l'équipe Université Paris 1
Equipe de recherche
- VANNETZEL Marie, CNRS
- PERROT Sandrine
- GUEVARA Erica, Université Paris 8
- DESRUMEAUX Clément Université Lyon 2
- VOILLIOT Christophe, Université Paris Nanterre
- DEBOS Marielle, Université Paris Nanterre et Institute for Advanced Study, Princeton
- BARGEL Lucie, Université Côte d’Azur, membre de l’IUF
- MACHUCA Marina, CERI Sciences Po
Suivez-nous
Nous contacter
Contact Média
Coralie Meyer
Tel: +33 (0)1 58 71 70 85
coralie.meyer@sciencespo.fr
Corinne Deloy
Tel: +33 (0)1 58 71 70 68
corinne.deloy@sciencespo.fr
