La démocratie sud-coréenne ou le paradoxe de la défense du constitutionnalisme
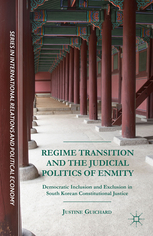
Entretien avec Justine Guichard
Qu’est-ce qui vous a amenée à travailler sur la justice constitutionnelle en Corée du Sud ? Quel est selon vous l’intérêt scientifique de ce sujet ?
La volonté d’enquêter sur le rôle de la Cour constitutionnelle de Corée depuis la transition politique que le pays a connue en 1987 provient d’une inquiétude face à la résilience d’un élément troublant – et pourtant négligé par la littérature – de son « exemplaire » démocratisation : le déploiement continu, au-delà de la période autoritaire, d’instruments répressifs tels que l’emblématique loi de sécurité nationale (National Security Act). Comme lieu où la légitimité de tels instruments n’a cessé d’être remise en question, la justice constitutionnelle s’est imposée au cœur de la (re)définition de l’identité des ennemis et de leur prise en charge après le changement de régime. Si la Cour sud-coréenne est largement reconnue pour avoir accompagné la transition démocratique par son travail de promotion de l’État de droit et de sauvegarde des libertés fondamentales contre les abus historiquement perpétrés au nom de la sécurité nationale, le corpus jurisprudentiel analysé dans cet ouvrage livre une vision plus complexe et ambiguë de la manière dont la justice constitutionnelle a redistribué au fil des trois dernières décennies ce que la démocratie sud-coréenne considère et sanctionne comme « national » ou « antinational ».
La pertinence d’une monographie consacrée à la Cour constitutionnelle de Corée vise non seulement à documenter sur le plan empirique un cas important encore délaissé dans le champ du constitutionnalisme comparé mais aussi à formuler un argument théorique provocateur mettant au jour le double visage que peut revêtir la protection de l’ordre constitutionnel. La manière dont la Cour sud-coréenne s’est acquittée de son rôle de gardienne de la Constitution illustre ainsi l’un des grands problèmes et paradoxes de l’intervention constitutionnelle : le caractère antidémocratique qui est susceptible de l’accompagner lorsque, en vertu de son engagement à définir et à défendre le constitutionnalisme, une cour entérine l’exclusion politique d’acteurs particuliers (en l’occurrence, des individus ne mettant pas tant en danger la sécurité nationale de la Corée du Sud qu’une certaine idée de ce qu’est le « national »).
D’un point de vue pratique, comment avez-vous abordé votre recherche : dépouillement d’archives, entretiens, séjours de longue durée sur place ?
L’ouvrage adopte avant tout une approche interprétative du discours constitutionnel tel qu’il est articulé dans la jurisprudence afin d’examiner la manière dont la Cour constitutionnelle de Corée a contribué à la construction de la notion d’ennemi depuis la fin des années 1980. Cette étude couvre près de 70 décisions rendues par la Cour depuis son entrée en fonction en septembre 1988 et dont plus de la moitié ont été partiellement ou intégralement traduites en anglais par l’institution, les autres n’étant accessibles qu’en coréen. J’ai consacré une année à sélectionner et à analyser ce corpus, notamment au travers d’un travail de terrain mené à l’Institut de recherche de la Cour constitutionnelle en 2012. Ce séjour m’a également permis de conduire des entretiens informels avec des chercheurs de l’Institut et de la Cour, ainsi que de consulter les archives de certaines des principales décisions détaillées dans l’ouvrage. La lecture approfondie de la jurisprudence sur laquelle il repose est par ailleurs soutenue par le recours à des sources secondaires, des articles de journaux, des rapports d’organismes de défense des droits de l’homme, et des publications de la Cour elle-même. Ces matériaux ont été particulièrement utiles pour identifier les requérants anonymes et les avocats désignés dans les affaires retenues, pour reconstituer le déroulement des événements et des débats qui entourent le processus constitutionnel, ainsi que les conséquences des jugements une fois rendus.
Si le total des cas sélectionnés ne représente qu’une part mineure de tous ceux arbitrés par la Cour, le corpus réuni traite de l’une des questions centrales sur lesquelles la Cour a eu à intervenir depuis le changement de régime : retracer les frontières de la notion d’ennemi dans la Corée du Sud post-autoritaire. Cet enjeu parcourt un grand nombre d’affaires examinées par la Cour ces trente dernières années, l’ayant conduit à : apprécier la constitutionnalité des principaux instruments sécuritaires restés en vigueur après la transition (dont la loi de sécurité nationale, la politique de conversion idéologique et le service militaire obligatoire) ; clarifier les garanties de la procédure pénale et leur application ou non au profit d’individus suspectés ou accusés de crimes contre l’État ; délimiter les contours de la communauté nationale par l’évaluation des lois relatives à la citoyenneté et à l’immigration ; enfin, statuer sur des questions de guerre et de paix. Par ailleurs, certains des jugements historiques les plus commentés de la Cour (en particulier ses décisions prononcées à l’endroit des anciens dictateurs Roh Tae-woo et Chun Doo-hwan en 1995, contre la destitution du President Roh Moo-hyun en 2004, ou en faveur de la dissolution du Parti progressiste unifié en 2014) s’inscrivent pleinement dans le litige lié à la détermination des acteurs, actions et discours politiques considérés comme « nationaux » ou « antinationaux » dans la démocratie sud-coréenne.
Quelle est votre approche théorique ?
Depuis 1945, le contrôle de constitutionnalité – ou la mise en place de cours chargées de vérifier la conformité des lois avec les normes constitutionnelles et, dans le cas contraire, de les invalider – est devenu un élément incontournable des transitions démocratiques, en Europe comme ailleurs. Les avancées permises par la Cour constitutionnelle de Corée méritent de ce point de vue d’être saluées. Se concentrer seulement sur son travail de promotion de l’État de droit et de protection des libertés fondamentales revient cependant à ne mettre en lumière qu’une partie du rôle joué par cette institution dans la période post-autoritaire. Le concept de fabrique constitutionnelle de l’ennemi (judicial politics of enmity) proposé dans cet ouvrage permet de saisir la nature et l’ambivalence de l’intervention de la Cour sud-coréenne dans le conflit central ayant opposé l’État à plusieurs segments de la société civile depuis le changement de régime.
Appelée à décider qui a droit de cité dans la communauté des sujets nationaux et qui en est exclu en tant que menace, la justice constitutionnelle s’est acquittée de cette tâche sur un mode produisant à la fois des effets « libéraux » et « illibéraux » : contrôler les instruments sécuritaires hérités de l’ancien régime tout en confirmant leur pertinence ; poser des limites aux pouvoirs de l’État tout en consolidant le caractère non inclusif du nouvel ordre démocratique. La critique de la justice constitutionnelle sud-coréenne portée par l’ouvrage n’implique pas pour autant un jugement normatif quant à ce que la Cour aurait dû faire ou ne pas faire. Une des raisons pour lesquelles l’analyse refuse un tel jugement tient au fait que la Cour n’était peut-être pas en mesure d’agir différemment. Sa jurisprudence apparaît au final contrainte par le paradoxe dans lequel l’institution s’avère prise : définir et défendre l’ordre constitutionnel alors même que ses fondations institutionnalisent un parti pris à l’encontre de certains segments de la polis.
Le passage de la Corée du Sud d’un État autoritaire et pauvre à un État « libre » et prospère, en trente ans, est souvent cité comme un exemple de transition démocratique réussie. Est-ce avoir une vision trop superficielle de la situation que d’énoncer cela ?
En effet, parmi les sociétés autoritaires qui ont connu une transition démocratique dans les années 1980, la Corée du Sud est généralement érigée en modèle de réussite. Reste que le changement de régime n’a pas signifié une rupture fondamentale en termes d’institutions répressives. La plupart des gouvernements qui se sont depuis succédé ont justifié le maintien de ces institutions par la situation de crise dans laquelle demeure la péninsule coréenne. Après 1987, les données relatives à l’application de dispositifs tels que la loi de sécurité nationale indiquent toutefois que les instruments répressifs déployés au nom de la sécurité nationale ont surtout servi à sanctionner une certaine vision de ce que le « national » est. Plutôt que de punir des atteintes à l’existence ou à la sûreté de l’État, les mécanismes sécuritaires ont avant tout visé les revendications discursives de groupes et d’individus contestant les contours de la démocratie sud-coréenne telle qu’institutionnalisée à la fin des années 1980 et cherchant à promouvoir davantage de changements politiques et sociaux.
C’est dans le cadre de ce conflit entre l’État et une partie de la société opposant différentes conceptions du corps politique que le rôle de la Cour constitutionnelle de Corée doit être questionné. Les mécanismes sécuritaires maintenus en vigueur après la transition ayant empêché que le désaccord relatif au périmètre de « l’inclusion » et de « l’exclusion » dans la démocratie sud-coréenne accède à l’espace public, la justice constitutionnelle est devenue l’une des seules arènes de remise en cause possible des contours de la notion d’ennemi telle qu’imposée par l’appareil répressif. Cependant, elle s’est révélée être un lieu ambivalent où le différend de l’ère post-autoritaire autour de l’attribution du statut d’ennemi a été à la fois soulevé régulièrement par divers requérants et résolu de manière ambiguë par la Cour.
Peut-on dire que l’année 1987 est celle d’une révolution dans la continuité ?
Si le changement de régime intervenu cette année là a été précipité par la mobilisation de la société civile sud-coréenne, en particulier celle des mouvements étudiant et ouvrier, le processus d’institutionnalisation de la démocratie a été quant à lui orchestré par les dirigeants du régime autoritaire comme par ceux de l’opposition parlementaire. En dépit du fait que l’amendement du 27 octobre 1987 ayant scellé la transition corresponde à la première des révisions constitutionnelles sud-coréennes issue de négociations entre forces politiques rivales, les discussions qui y ont mené (ou « pourparlers à huit ») ont été très fermées. La Cour constitutionnelle de Corée a été créée dans ce contexte et résulte donc d’une réforme de la Constitution contrôlée par les élites du camp autoritaire (à la tête du Parti de la justice démocratique) et de l’opposition (rassemblée dans le Parti démocratique de l’unification). Un tel processus s’est soldé par l’exclusion des acteurs et des demandes du mouvement démocratique populaire, porté par son imaginaire politique alternatif (anti-impérialiste, anti-capitaliste et pour la réunification de la péninsule sur la base de ces termes).
La transition sud-coréenne s’intègre ainsi dans un ensemble plus large de cas pour lesquels changement politique et réforme constitutionnelle ont été le produit d’un compromis entre les forces au pouvoir et celles de l’opposition. Cela dit, la Corée du Sud appartient également à une sous-catégorie plus rare de cas dans lesquels la démocratisation s’est accomplie alors que la Constitution de l’ancien régime a été maintenue et amendée. La Hongrie, le Chili, le Pérou, l’Indonésie et la République de Chine à Taïwan sont – à ma connaissance – les seuls autres pays qui n’ont pas promulgué de nouveau texte pendant la vague de démocratisation et de constitutionnalisation de la fin des années 1980 et du début des années 1990 mais ont plutôt révisé, à des degrés divers, celui en vigueur. La « transition par amendement » dont la Corée du Sud a pour sa part fait l’expérience en 1987 a contribué à institutionnaliser la démocratie tout en aliénant les forces dont la mobilisation avait mené à la chute de l’autoritarisme.
La relation conflictuelle, pour ainsi dire « l’état de guerre », avec la Corée du Nord, a-t-elle permis le maintien de certaines institutions qui auraient dû disparaître avec la transition démocratique en Corée du Sud ? Ou bien ces institutions sont-elles des séquelles de la dictature militaire dont le pays n’arrive pas à se défaire ?
La plupart des gouvernements sud-coréens ont justifié le maintien des institutions répressives héritées de l’ancien régime par la menace que fait peser la division nationale sur la péninsule, ses deux moitiés étant encore en « état de guerre » du fait qu’aucun traité de paix n’a été signé au lendemain du conflit civil et international qui a opposé le Nord et le Sud entre 1950 et 1953. La survivance d’un tel dispositif sécuritaire est au contraire dénoncée par ses détracteurs comme un vestige du passé. Aucune de ces deux explications ne semble toutefois rendre compte de manière satisfaisante de la réalité des dynamiques répressives et de la construction de la notion d’ennemi qui les sous-tend dans la démocratie sud-coréenne.
Au lieu de cela, la désignation de l’ennemi et les mécanismes qui sont déployés pour la mettre en œuvre méritent qu’on les analyse du point de vue de leur fonctionnalité interne, contemporaine et conflictuelle dans le cadre des rapports entre l’État et la société sud-coréenne. Loin d’être un simple produit de la division des deux Corées ou un résidu de l’ère autoritaire, la résilience d’un fort niveau de répression après le changement de régime paraît être davantage le résultat de l’exclusion institutionnalisée d’acteurs promouvant une vision alternative de la démocratie et sanctionnés pour cette prise de parole non autorisée.
Par conséquent, une lecture interprétative de la jurisprudence constitutionnelle révèle l’impossibilité de réduire la question de savoir qui peut se voir reconnaître une place dans la communauté des sujets nationaux ou qui est considéré comme une menace pour elle à un désaccord autour du passé autoritaire ou autour du statut de la Corée du Nord. Au lieu de se référer à ces altérités dyschroniques et dystopiques, la textualité par laquelle procède la justice constitutionnelle transcrit et régit les dynamiques d’inclusion et d’exclusion qui sont le legs de la transition démocratique sud-coréenne.
Vous abordez le concept d’ennemi. Comment le définiriez-vous ?
Le concept de fabrique de l’ennemi (politics of enmity) proposé dans l’ouvrage renvoie au partage conflictuel entre ce qui est considéré comme national, légitime et autorisé dans une société démocratique comme la Corée du Sud, par opposition à ce qui y est pénalisé comme antinational, déviant et menaçant. Ce conflit se judiciarise lorsque sa résolution est déléguée à des institutions juridiques. L’enjeu de la définition de l’ennemi confronte donc les cours constitutionnelles à un problème politique fondamental : prescrire comment s’articulent l’inclusion et l’exclusion démocratiques, à qui revient une place dans la communauté des sujets nationaux ou à qui ce statut de membre peut être refusé non seulement au nom de la sécurité de l’État mais aussi de la stabilité de l’ordre constitutionnel. <
Ni construire l’ennemi ni lutter contre lui ne sont en contradiction avec la fonction que les cours constitutionnelles ont vocation à remplir. En effet, la sauvegarde de la Constitution n’implique pas seulement que les cours protègent les droits et les libertés consacrés par les normes fondamentales mais aussi qu’elles préservent l’intégrité « constitutionnelle » et « physique » de l’ordre existant ainsi que l’a souligné le politiste américain John E. Finn dans son ouvrage Constitutions in Crisis: Political Violence and the Rule of Law (1991). En affrontant ceux qui mettent en péril cet ordre, certaines cours peuvent avoir à faire face à une responsabilité plus délicate que celle d’équilibrer liberté et sécurité en temps de crise. Il n’est pas moins problématique d’établir de manière permanente les structures et les principes fondamentaux qui définissent l’ordre constitutionnel et qui doivent donc à ce titre être défendus. Le fait pour les cours de spécifier ce que sont ces structures et ces principes peut participer à la consolidation de logiques asymétriques quand le sens et/ou l’utilisation de ces catégories « fondamentales » entretient un désaccord de nature politique au sein de la société, comme c’est le cas en Corée du Sud.
La définition que la Corée du Sud a de l’ennemi est-elle différente ? En quoi la justice constitutionnelle sud-coréenne a-t-elle transformé la définition ?
Contrairement aux apparences, la frontière intercoréenne n’a jamais été le seul marqueur d’inclusion et d’exclusion dans la péninsule. Son apparition a donné naissance à une ligne de séparation plus insidieuse que le 38e parallèle, une division qui n’est pas uniquement à l’œuvre entre mais au sein des deux Corées dès lors que chacune d’elles est devenue obnubilée par la nécessité d’éliminer ses « ennemis intérieurs ». Il est de notoriété publique que l’identification de tels ennemis ne s’est jamais limitée aux groupes ou aux individus menaçant la sécurité de l’État mais a également servi à incriminer diverses catégories d’opposants sous tous les régimes autoritaires qu’a connus la Corée du Sud entre 1948 et 1987. Cette lecture de l’ennemi se révèle cependant trop étroite pour prendre en compte le déplacement des dynamiques répressives après le changement de régime.
Depuis 1987, la justice constitutionnelle sud-coréenne est intervenue de manière centrale dans le conflit qui continue d’opposer l’État et certaines franges de la société civile sur la définition des contours de la notion d’ennemi. Les différents instruments juridiques qui sanctionnent cette définition n’ont cessé d’être remis en question devant la Cour dont les décisions, comme nous l’avons déjà dit, ont produit une dualité d’effets, tant « libéraux » qu’« illibéraux ». Si la jurisprudence constitutionnelle a œuvré à contrôler la légalité des mécanismes répressifs hérités de l’ère pré-transitionnelle, elle a également renforcé leur légitimité au service non seulement de la défense de l’État mais aussi de l’ordre démocratique constitutionnel. En modelant ces dispositifs de manière conforme aux exigences de l’État de droit, et en déplaçant le fondement de leur raison d’être, la Cour a contribué à consolider leur pertinence et leur fonctionnalité post-autoritaires : prescrire une vision non inclusive du « national » au nom de la protection de la nation.
Cette Cour constitutionnelle parvient-elle à remplir son rôle de gardienne de la Constitution ? Et si non, pourquoi ?
La perspective critique adoptée dans cet ouvrage ne vise pas à réfuter le rôle de gardienne de la Constitution dont s’acquitte la Cour constitutionnelle de Corée. L’analyse entend plutôt attirer l’attention sur la dimension excluante dont s’est accompagnée l’intervention de la Cour à mesure qu’elle a entrepris de définir et de défendre l’ordre constitutionnel. L’engagement de l’institution pour le maintien de cet ordre n’a pas seulement impliqué pour sa jurisprudence de promouvoir l’État de droit et de protéger les libertés fondamentales mais aussi de renforcer le défaut d’inclusivité consubstantiel à la démocratie sud-coréenne telle qu’institutionnalisée à la fin des années 1980. Le rôle dont la Cour constitutionnelle s’est saisie ne signifie pas qu’elle ait été créée dans ce but. Peu d’acteurs anticipaient ce que serait et ferait véritablement la nouvelle institution pendant et au lendemain du processus de révision constitutionnelle dont elle est née. Contrairement à ce que les élites responsables de ce processus pouvaient attendre, le contrôle de constitutionnalité a été largement activé par les forces dont la mobilisation avait entraîné la chute de l’autoritarisme à la fin des années 1980 mais que les modalités d’institutionnalisation de la démocratie ont ensuite marginalisées. Sous l’impulsion des avocats spécialisés dans la défense des droits de l’homme, la justice constitutionnelle est ainsi devenue l’un des lieux privilégiés de contestation des dynamiques issues de la transition, notamment caractérisées par la répression du mouvement démocratique populaire tout au long des années 1990.
La trajectoire de la Cour constitutionnelle sud-coréenne illustre la part de contingence et l’absence de prédétermination à l’œuvre dans l’émergence d’institutions nouvelles en général, et dans l’activation des mécanismes constitutionnels en particulier. En d’autres termes, même si des intérêts politiques particuliers et sélectifs ont imprégné le processus par lequel la Cour a été créée, ceux-ci n’ont pas façonné le chemin emprunté par l’institution. À l’inverse, si la Cour a finalement renforcé la capacité à exclure des instruments de sécurité et l’héritage non pluraliste de la transition, ses décisions ont aussi contredit les préférences immédiates des diverses branches du pouvoir et des services de l’État (police, agence de renseignement, administration pénitentiaire) à maints égards. Cette ambivalence met en relief le rôle ambigu de la Cour comme gardienne de l’ordre constitutionnel post-autoritaire, rôle qui ne lui a pas été assigné par ses artisans mais qui s’est déployé à mesure que l’arène constitutionnelle a été investie par les « sans-part » de la démocratie sud-coréenne.
Vous abordez la question de l’inclusion et de l’exclusion démocratiques, de la communauté nationale vs les ennemis de la nation. Est-il envisageable d’opérer des comparaisons à partir du cas sud-coréen ? Est-ce un sujet qui se prête à des comparaisons internationales ?
Si le différend post-autoritaire que la justice constitutionnelle sud-coréenne a eu à résoudre après la transition est propre à ce pays, le paradoxe de la défense du constitutionnalisme que sa Cour illustre est observable dans d’autres contextes. La Cour sud-coréenne n’est pas la seule institution à s’être acquittée de son rôle de gardienne de la Constitution de manière double, contribuant à renforcer des formes existantes de non inclusion par son engagement à définir et à défendre les structures et les principes démocratiques fondamentaux contre ce qui pourrait les mettre en péril. Le cas sud-coréen témoigne toutefois de ce qu’un ordre constitutionnel peut institutionnaliser des dynamiques d’inclusion et d’exclusion distinctes des tensions entre religion et sécularisme, nationalismes séparatiste et fédéraliste, ou clivages ethno-culturels qui tendent à diviser des démocraties constitutionnelles comme Israël, le Canada ou l’Inde. Le conflit lié aux contours du corps politique peut aussi être provoqué et entretenu par les frustrations nées de l’avènement même de la démocratie.










