Famille, maladie, guerre, amour. Les lettres de Max Weber
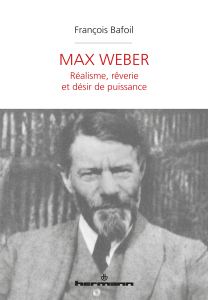
François Bafoil présente une étude sociologique de Max Weber, dont l’œuvre fondatrice continue de marquer et d’inspirer les travaux des sociologues, des politistes, mais aussi plus généralement des chercheurs en sciences sociales qui s’intéressent à l’Etat, à la domination, à la bureaucratie, à la rationalisation, à l’éthique du capitalisme, à la puissance... L’ouvrage, intitulé Max Weber. Réalisme, rêverie et désir de puissance, vient d’être publié aux Editions Hermann.
Entretien avec son auteur.
Vous abordez ce scientifique par une entrée épistolaire, celle de textes qui n’ont été pensés et rédigés que pour leurs destinataires. Pourtant il s’agit là d’une entrée qui vous permet de vous intéresser notamment au rapport complexe et contrarié que Max Weber entretient à la guerre, au nationalisme, à la puissance...
On dispose depuis 2016 de la quasi-totalité de la correspondance de Weber. Celle-ci s’étend sur près de 25 ans, voire davantage si l’on considère les lettres de jeunesse publiées en 1936 par sa femme, Marianne. On pourrait considérer que ces textes – non traduits à ce jour en français – n’étaient pas destinés à être rendus publics et qu’il serait abusif de s’en servir pour éclairer certains aspects de la personnalité du scientifique. C’est l’argument dont se servent justement ceux qui estiment que l’on n’a pas à en rendre compte si cela conduit à s’étendre sur les infortunes privées dont il eut à souffrir toute sa vie. Reste que ceux qui arguent ainsi ne veulent pas davantage entendre parler, ni de ses opinions en faveur de la guerre — donc son bellicisme — ni de ses engagements impérialistes et extrémistes — donc sa polonophobie. Sexualité, engagement militaire, pensée de la domination et volonté éthique sont pourtant étroitement liés.
Que vous montrent les lettres de Max Weber?
En faisant reposer mon travail notamment sur l’examen de cette volumineuse correspondance, j’ai cherché à comprendre la double lutte qu’il a su conduire face à deux catastrophes vécues très douloureusement : catastrophe privée avec la maladie qui l’a affecté dans sa phase aigüe de 1898 à 1902 et qui l’a contraint à quitter l’université, et dont il a eu à souffrir toute sa vie; catastrophe publique avec la défaite allemande en 1918, et avec elle, la prise de conscience que la plus haute valeur à ses yeux, la « nation », ne serait jamais réalisée. C’est ainsi que j’interprète ses travaux scientifiques à compter de 1904 ainsi que ses positions à l’égard des milieux alternatifs munichois et suisses dans la décennies 1910 : une mise à distance à la fois conceptuelle et pratique de sa maladie nerveuse. De même, sa passion vécue avec Else von Richthoffen (1918-1920) peut être comprise comme la mise à distance de la défaite allemande à l’issue de la Première guerre mondiale. Double victoire intérieure donc qui sonne comme la sublimation d’un réel insupportable, celui de la maladie et celui de la faillite de la nation. Voilà pourquoi je traite longuement de sa maladie (partie II) en l’éclairant d’une part par sa vie familiale et son engagement marital (partie I) et de l’autre par son dépassement dans les années 1904-1914 ; et tout autant la nation, à la lumière de ses engagements dans la guerre (partie IV) et dans l’amour (partie V).
Selon vous, l’ambition de cet ouvrage est de « rendre compte de la tension qui a porté son réalisme, et le fantasme, sa rêverie, dans une polarité jamais réconciliée. Lutte dans l’action et, radicalement autre, détente dans une sur-réalité mais tout aussi tendue vers un but absolu que seule la mort serait à même de satisfaire. Comme s’il lui était impossible de jamais vivre autrement que dans le conflit le plus intense parce que sans conflit, et donc sans lutte, il n’y a que la perte ; la mort. »
Exactement. C’est cette polarité que je ne cesse d’analyser en prenant appui sur ce qu’a affirmé Else von Richthofen, quand elle a cherché à préciser les mots qu’avaient prononcés Marianne lors de la crémation de son époux, à propos de la puissance d’amour (Liebeskraft) du sociologue : « Ce que Marianne entendait par ce terme de ‘puissance d’amour’ est fondamentalement exact quoique, ou peut-être justement parce que cet homme n’a pu devenir lui-même le véritable patriarche d’une grande lignée. Là aussi il était renvoyé à ses propres rêves. On ne savait jamais ce qui en lui était le plus fort, du réaliste lucide sans illusion ou du grand rêveur ».
Que recouvre ce réalisme ?
- Réalisme, qui a tenu à sa conception de la vie comme une lutte continue, cette notion de Kampf qui traverse toutes les organisations, de la famille aux revendications de conquête politiques.
- Réalisme, lorsqu’il réclame en 1894 la déportation des Polonais pour maintenir la germanité des territoires de l’Est.
- Réalisme, en matière de conduite de la guerre considérée comme « grande et merveilleuse », et sans cesse perçue comme nécessaire pour l’advenue de la nation, cette valeur ultime.
- Réalisme, qui le conduit à considérer que « tout peuple est responsable des actes de son gouvernement » ou encore que le viol de la Belgique n’est que « formel ».
- Réalisme, toujours, lorsque pour empêcher le démantèlement de l’empire qui se profile à l’horizon du traité de Versailles il appelle à l’irrédentisme.
- Réalisme, enfin, lorsqu’il affirme en 1919 qu’« en vue du redressement de l’Allemagne, en sa pleine splendeur passée, je me lierais certainement avec n’importe quelle puissance terrestre et même avec le diable en personne, si d’aventure je faisais encore de la politique, avec tout sans exception, tout sauf la bêtise ».
A l’échec de son réalisme exacerbé et finalement vain, ne peut correspondre que l’alliance avec les puissances de mort, « le diable ».
La mort semble en effet au cœur des « rêveries » du sociologue, « fantasmée », vous l’écrivez, « comme accomplissement de la vie et fusion dans la totalité ». Que nous dit la correspondance de Max Weber sur ce que serait cette totalité ?
Avant d’être une revendication fantasmatique, la mort est présente chez Weber sous la forme de l’angoisse. Angoisse qu’il identifie lui-même dans son premier souvenir, comme il l’indique à sa mère en 1914 : celui de l’effondrement d’une locomotive lorsqu’il avait trois ans. Il revivra cette angoisse de l’effondrement en 1917 en dénonçant la politique aventureuse de Guillaume II, qui a conduit l’Allemagne à sa perte. Une angoisse que jeune homme il a traduit par une hantise des pertes de temps (au régiment où on ne fait rien ou au bal qu’il exècre car on n’y fait que parader vaniteusement) et qu’il sublimera dans la valorisation du sermon de Benjamin Franklin qui affirme que « le temps, c’est de l’argent ». Angoisse encore lorsque jeune marié il offre à son épouse des gravures de Max Klinger dont l’une s’intitule « La mort comme délivrance ». Angoisse de la maladie dont il pense se délivrer par la castration ! Angoisse, encore, qui le fait fantasmer la mort sur le champ de bataille : elle est le sens même de la vie. Parce qu’elle est don et sacrifice en vue de l’obtention de la valeur suprême qu’est la nation allemande enfin réalisée, la mort est le couronnement de la vie. Les nombreuses lettres de condoléances qu’il adresse durant la guerre aux parents des soldats tombés au front en témoignent.
La question bureaucratique émerge par ailleurs, selon vous, notamment de l’expérience de la guerre. Vous écrivez, p. 29, Son expérience de la guerre (...) mérite d’être considérée en regard de sa conception de la bureaucratie mais aussi de l’engagement éthique. Pourriez-vous nous en dire davantage ?
En raison de son état de santé, Weber n’a pas été mobilisé au front en août 1914 et ce, malgré son statut de lieutenant de réserve et contre sa propre volonté. Affecté à la gestion des hôpitaux de campagne de sa région d’Heidelberg, il va y œuvrer jusqu’en septembre 1915. Les rapports d’activité qu’il rédige sur son travail sont intéressants à deux titres. D’abord, parce qu’ils vont lui permettre d’approfondir un aspect de la notion de bureaucratie qu’il n’avait pas envisagé dans ses travaux antérieurs : celui de la construction d’un appareil d’administration technique dans une période traversée par une incertitude considérable où tout est à construire face à une situation nouvelle et avec des ressources humaines et matérielles inconnues jusque-là. Sa réflexion va s’articuler autour de la notion de transition, que l’on peut qualifier de « systémique » et dans laquelle le concept de « discipline » prend une importance majeure. Par opposition, il critique « le sentimentalisme néfaste des jeunes [infirmières] allemandes » qui ne seraient animées que par une compassion exagérée à l’encontre des soldats blessés, en lieu et place d’une pratique efficace fondée sur un savoir médical.
Que nous disent ces rapports, sur l’homme ?
Ils en disent beaucoup sur ses obsessions : obsession de la discipline, nécessaire à la troupe et qu’un séjour prolongé au Lazaret ne peut qu’amollir ; obsession de la propreté qui se trouve battue en brèche par la fréquentation des bordels par les soldats qui s’y vautrent et y dépensent leur solde ; obsession de la dépense injustifiée de ceux qui sont peut-être des « planqués » et qui passent leur temps à boire et à forniquer ; obsession enfin d’une possible défaite qui ne serait pas subie sur le champ de bataille mais à l’arrière, en raison du défaitisme de la population. Est-ce le signe avant-coureur de la thèse, dite complotiste, du « coup de poignard dans le dos », selon laquelle l’armée allemande aurait été défaite à cause des ennemis de l’intérieur et non sur le champ de bataille ? Une thèse dont il se fera le héraut en 1919...
Enfin, on note avec intérêt que c’est la seule période de sa vie où ses symptômes nerveux disparaissent et au cours de laquelle il ne consomme plus ses drogues.
Vous parlez souvent de la psychanalyse. Quel rapport Weber a-t-il entretenu avec cette jeune science ?
Je trouve fascinant que la longue maladie nerveuse dont il a eu à souffrir entre 1898 et 1902 corresponde très exactement au moment de l’émergence de la psychanalyse dans le paysage médical et scientifique. C’est d’autant plus notable que Weber a lu Freud (à un moment où le monde académique refusait de reconnaître l’importance de cette discipline). S’il a admis son importance possible dans les études sur la culture, il prétend néanmoins la réfuter pour deux raisons : d’une part, selon lui l’inconscient n’est pas incogniscible. Il fait partie d’un continuum à l’opposé duquel se trouve le conscient. D’autre part, aux yeux du sociologue, il n’est pas de souvenir qui ne puisse être remémoré pour peu que l’individu le veuille : Weber considère pouvoir accomplir seul sa psychanalyse et se passer d’un psychanalyste, de l’inconscient, des notions de refoulement et de défense. Bref, il ne l’a pas comprise.
La complexité de la relation de Weber à la psychanalyse tient en réalité beaucoup aux liens ambivalents et contrariés qu’il entretient avec le psychiatre freudo-nietzchéen, Otto Gross. Gourou de la bohème munichoise, Gross a eu une importance considérable dans la mouvance libertaire des années 1900-1914 à laquelle était sensible le couple Weber. Les deux hommes étaient liés, d’une autre manière, par la personne d’Else von Richtoffen, maîtresse tour à tour de Gross et de Weber. Pour le sociologue, Gross représentera à la fois l’archétype haïssable de « l’immoralisme sexuel » et l’exemple-type de l’homme charismatique
Citons les dernières lignes de votre ouvrage, Pour Weber, peu importe les notions socialement admises du juste et de l’injuste ; si le chef indique une ligne à suivre ou un objectif à atteindre, seule la foi en lui justifie qu’on le suive. On sait à quels errements a conduit le fait d’ancrer la conduite éthique dans la seule conviction intime d’être dans le vrai ou le juste, au-delà de toute considération sociale. C’est une des limites de Weber, n’est-ce pas ?
Oui, c’est le reproche qui ne cesse d’être adressé à Weber, celui d’ouvrir sur le relativisme moral en raison de l’impossibilité de fonder de manière ultime le choix moral. Parce qu’il considère que la nation est la valeur la plus élevée et qu’il en va de l’identité même de l’Allemagne, et parce qu’il estime que la validité d’un jugement renvoie à sa nécessaire cohérence interne, il admet que tous les moyens sont légitimes pour parvenir à la fin qu’il s’est fixée au nom même de sa propre conviction. Sauf, comme l’avait déjà souligné Raymond Aron dès 1959 dans sa préface de l’ouvrage Le Savant et le Politique, que « Max Weber n’a pas donné de définition de ce qu’il entendait exactement par valeur ». Dieu ou diable, l’important pour lui était de n’en pas dériver ; et d’ailleurs Weber ne s’affranchit jamais de cette vision religieuse parce qu’absolue du choix moral ou du choix politique. Quitte d’ailleurs à être incohérent. Poussée à son extrême, l’éthique de la conviction conduit à l’irresponsabilité ; l’éthique de la responsabilité, à la violence extrémiste. En ce sens, la très stricte cohérence de ses énoncés scientifiques sur la morale et la politique n’ont aucune application pratique et ne peuvent en avoir.
La vision wébérienne de l’obéissance absolue au chef charismatique en découle. Et c’est la même logique qui lui fait s’abandonner dans sa passion à Else, lui déclarer : « Dans tout délit, dans tout crime, Else von Richthoffen j’irai avec toi, où que tu m’appelles, le veuille (ou le puisse) : ou que ce soit, sans exception ». Voilà aussi l’intérêt de cette correspondance : nous donner à comprendre son désir de puissance, (et non sa volonté), autrement dit comment s’opère dans la sphère privée la compensation fantasmatique de la perte des objectifs de la volonté politique auxquels il a consacré sa vie et qu’il n’a, finalement, jamais réussi à accomplir.
Enfin, cette somme sur Max Weber s’inscrit dans un triptyque, dont le premier volet, L'inlassable désir de meurtre. Guerre et radicalisation aujourd'hui a été publié chez Hermann en 2017. Pouvez-vous nous évoquer ce triptyque, comment-il a été pensé, et comment il se décompose dans ses trois volets ?
Le premier élément de ce triptyque est consacré à l’enseignement de Freud comme penseur du politique. Le deuxième est cet ouvrage, qui porte exclusivement sur Weber. Le troisième auquel je me consacre désormais est la comparaison des systèmes de pensée freudien et wébérien, et plus précisément une comparaison des dimensions du rationalisme et de l’irrationalisme dans la pensée, dans la politique (communisme et pacifisme) et dans la religion (le judaïsme).
Si j’essaie d’isoler les raisons qui m’ont conduit à ce triptyque, je dois d’abord citer la pensée de la violence : la nôtre aujourd’hui qui s’étend des différentes formes d’agressivité qui constituent notre quotidien, jusqu’au terrorisme. Elle résulte selon moi de l’effondrement qu’a représenté la Grande guerre, dont les commémorations du centenaire n’ont cessé de nous rappeler la gravité et l’actualité. Ce suicide collectif, Freud comme Weber l’ont vécu directement et donc ce qu’ils en ont dit mérite d’être lu attentivement aujourd’hui.
Quelles sont les différences entre Freud et Weber à propos de la violence et de la guerre ?
Freud dont les trois fils étaient mobilisés au front a pensé la guerre. Weber ne l’a jamais pensée, jamais condamnée, et n’a jamais accepté la moindre idée d’une culpabilité allemande. A mes yeux, Freud a réalisé un travail sans égal sur la guerre, la mort et l’agressivité dans l’histoire, durant le conflit mondial – notamment avec Considérations sur la guerre et la mort. Reprenant les thèses de Totem et Tabou il a accumulé des matériaux qu’il utilisera après 1920 avec d’un côté Au-delà du principe de plaisir et de l’autre, Psychologie des masses et analyse du moi. Freud est un grand penseur du politique. Un penseur du politique à l’égal de Weber qui, lui, a salué la guerre comme un militariste et un belliciste prussien pour qui le conflit armé devait enfin réaliser l’unification de la nation pour mieux achever le projet bismarckien de construction de l’État allemand et lui assurer sa place dans l’économie mondiale.
Pour résumer, il y a dans ce projet comparatiste une raison immédiate touchant notre actualité ; une raison liée à l’histoire intellectuelle de ces deux pensées rarement comparées ; une interrogation sur le lien, chez Weber, entre son engagement dans la vie politique concrète pendant la guerre et son enseignement de penseur de la domination, une dimension trop peu débattue dans les sciences humaines et sociales.
Pour finir, il y a le plaisir que j’ai cette année d’enseigner un cours au sein du Master Théorie Politique que dirige Astrid von Busekist intitulé « Sociologie et psychanalyse. Max Weber et Sigmund Freud. Approches comparées du rationalisme ». De la recherche à l’enseignement, il y a le plaisir de l’écriture.
Propos recueillis par Miriam Périer.










