Accueil>Retour d'expérience sur le projet clinique "Street Law & Law in School"
21.07.2025
Retour d'expérience sur le projet clinique "Street Law & Law in School"
Beeta Davoudi, Alix De Mauduit, Manon Perrey et Marianne Purru, étudiantes du Master Droit économique et Julie Dugast, étudiante du Master joint Droit et finance partagent leur retour d’expérience sur leur projet clinique dans le cadre du programme clinique Accès au droit de l’École de droit.
Beeta Davoudi, Alix De Mauduit et Julie Dugast partagent leur retour d’expérience
Quel a été le point de départ du projet clinique “Street Law & Law in School” ?
Le point de départ de la clinique Street Law 2024/2025 a été le partage d’expériences et de ressources issues de l’année précédente, à travers des échanges enrichissants avec nos tuteurs. Nous avons réfléchi aux sujets et aux techniques de présentation qui avaient suscité un accueil particulièrement favorable de la part des bénéficiaires. Nous avons également analysé les difficultés rencontrées et les pistes d’amélioration identifiées. Forts de ces retours, nous avons commencé par constituer une liste de thèmes potentiels qui nous paraissaient à la fois pertinents pour nos publics et intéressants à travailler de notre côté. C’est comme ça que sont nés les premiers ateliers de l’année.
Quel est son objectif ?
À court terme, nos interventions visaient à transmettre des informations juridiques claires et accessibles à nos publics sur des sujets qui les concernaient directement, parfois au quotidien. À plus long terme, l’objectif est de susciter un sentiment d’autonomisation chez les bénéficiaires, en leur donnant les outils nécessaires pour mieux comprendre et faire valoir leurs droits. Plus largement, nous espérons contribuer, à notre échelle, à améliorer l’accès au droit pour les populations visées, en levant certains tabous et idées reçues.
Avec qui travaillez-vous ?
Pour atteindre ces objectifs, nous avons travaillé collectivement sur chaque atelier, en amont et sur place. Nos deux tuteurs ont été d’un soutien essentiel dans la structuration de notre propos et dans la coordination des différentes interventions. Enfin, nos ateliers ont reposé sur la demande émanant des publics auxquels nous nous adressions. Cela inclut les bénéficiaires du café associatif le Tilia au Blanc-Mesnil et les lycéens rencontrés lors de nos présentations à Sarcelles (95) et à Doullens (80).
Pourquoi avez-vous choisi la Clinique de l’Ecole de droit ?

Alix De Mauduit : C’est lors d’un semestre d’études à la New York University (NYU) que j’ai découvert la place centrale des cliniques juridiques dans l’enseignement du droit aux États-Unis. Là-bas, les écoles de droit ne se contentent pas de former des techniciens du droit : elles se considèrent aussi comme des acteurs engagés dans l’amélioration de l’accès à la justice. Cette idée – que l’université a une responsabilité sociale, voire une obligation, de contribuer concrètement à la réduction des inégalités d’accès au droit – m’a profondément marquée.
À mon retour en France, il m’a semblé évident que cette démarche devait être encouragée ici aussi. Intégrer la Clinique de l’École de droit s’est donc imposé comme une évidence : c’était pour moi l’occasion d’agir, de mettre mes compétences au service de celles et ceux qui en ont le plus besoin, mais aussi de participer à une réflexion critique sur notre formation, nos institutions et notre rôle futur en tant que juristes. En tant qu’étudiants de Sciences Po, nous avons les outils – et donc la responsabilité – de contribuer à cette dynamique de justice sociale.
Beeta Davoudi : La question des inégalités est au cœur de mes expériences et de mes préoccupations personnelles. J’ai toujours cherché, à mon niveau, à lutter contre ces inégalités, notamment en partageant mes privilèges, qu’ils soient matériels ou intellectuels. Je crois que plus je possède de privilèges, plus j’ai le devoir de les partager. Pour ces raisons, dès mon inscription en Master de Droit économique, intégrer la Clinique de l’École de droit a été un de mes objectifs. Je voyais en elle une opportunité concrète de transmettre les savoirs que j’aurais le privilège d’acquérir pendant ces années de formation et d’expérience professionnelle. La Clinique Street Law offre l’opportunité d’entrer en contact direct avec les bénéficiaires, ce qui représente pour moi un impact particulièrement concret et tangible.
Julie Dugast : Après cinq années à Sciences Po dont deux au sein de l’École de Droit, la Clinique m’a semblé être la meilleure des manières de mettre les connaissances acquises au service de celles et ceux en ayant le plus besoin. Ayant toujours lutté pour l’égalité des chances en milieu rural, j’ai aussi perçu la Clinique comme la continuité de cet engagement, me permettant d’agir au plus proche d’un nouveau public. L’accès au droit est pour moi un pilier de notre société, qui doit contribuer à faire bouger les lignes, et à lutter contre les inégalités. J’ai pensé que nous, étudiants de Sciences Po, avions notre rôle à jouer dans cette démarche.
En quoi participer à ce projet clinique vous aide dans la construction de vos projets professionnels et personnels ?
Alix De Mauduit : La participation à la Clinique de l’École de droit m’a permis de développer une écoute plus attentive, en partant des besoins exprimés, des expériences vécues et des solutions que les personnes avaient parfois déjà commencé à formuler elles-mêmes. Il ne s’agissait pas simplement de « transmettre » du droit, mais d’entrer dans un véritable dialogue avec les bénéficiaires, en reconnaissant leur agentivité et leur capacité à faire valoir leurs droits. Cette approche m’a permis de sortir d’une posture académique parfois trop désincarnée, pour apprendre à transmettre des savoirs utiles, clairs, et directement mobilisables.
Sur le plan professionnel, la clinique m’a offert un double apprentissage : d’un côté, un travail de terrain, exigeant, face à un public souvent éloigné du droit ; de l’autre, un cadre théorique et critique, nourri par des enseignants cliniciens et intervenants, qui m’a permis de réfléchir aux limites structurelles du système juridique. Ce n’est pas simplement apprendre à traiter un cas de manière isolée, mais comprendre comment et pourquoi le droit fonctionne – ou échoue – dans certaines situations, en particulier face aux injustices sociales.
En ce sens, la Clinique a joué un rôle clé dans la construction de mon projet professionnel : elle m’a donné des outils pour devenir une avocate compétente, mais aussi lucide, engagée, et attentive aux réalités humaines que le droit prétend réguler.

Beeta Davoudi : Afin de devenir avocate, je m'efforce continuellement de renforcer mes compétences juridiques et mes capacités de communication. Enseigner me permet de mieux comprendre et de mieux communiquer, et cette activité constituera l’un des aspects essentiels de ma future profession : expliquer les faits du dossier à mon équipe, le cadre juridique à mes clients, et nos arguments au juge.
Ma participation à la Clinique m’a offert un cadre idéal pour développer ces compétences. Pour préparer nos interventions, notamment sur des sujets tels que l’aide juridictionnelle ou le surendettement, j’ai mené des recherches dans des domaines juridiques variés, que j’ai ensuite traduits dans un langage clair et accessible à des publics très divers. La Clinique m’a ainsi permis d’approfondir mes connaissances juridiques tout en affinant mes capacités d’analyse, de synthèse et de communication. Autant de qualités essentielles que je mobiliserai dans ma future pratique d’avocate, mais aussi dans mon engagement citoyen auprès de mes proches et de la société.

Julie Dugast : D’une part, la Clinique a conforté mon souhait de devenir avocate, puisque j’ai compris comment le droit peut changer la vie des citoyens en profondeur en leur redonnant le pouvoir. De l’autre, elle m’a fait saisir l’importance de savoir transmettre. Il ne suffit pas d’avoir des connaissances, il faut qu’elles puissent être comprises. Le droit peut être perçu comme barbare et inaccessible et ce sera notre rôle d’avocats que de le rendre plus intelligible. En cela, la Clinique m’a ouvert les yeux sur l’avocate que je souhaite devenir. Enfin, la rencontre des lycéens et des habitants du Blanc-Mesnil m’a fait gagner en humilité. Les questions posées, loin de la théorie et de la technique d’une salle de cours, m’ont rappelé que notre droit s’inscrit dans des réalités multiples et que les codes ne détiennent pas une “vérité” universelle.
Deidre Jones et le rôle de tutrice
Que pouvez-vous nous dire de plus sur le projet « street law & law in school » ?

Le projet relève tout d’abord d’un défi, concrétisé sous la bannière du programme de la Clinique, c’est-à-dire de réaliser l’accès au droit. Je constate que les étudiantes démontrent leur force de foi et de leur conviction à traduire des thématiques, et à amener le droit là où la personne concernée se trouve, que ce soit dans un café-associatif avant que les habitants fassent leur passage au marché, dans un foyer après l’heure du repas, dans les salles des lycées avant que les jeunes ne rentrent à la maison, parce que la question d’accès est un aspect pratique tantôt qu’il n’est davantage un concept…
Tandis que le projet Street Law, établi par la clinique juridique de l’Université de Georgetown aux États-Unis (voici un petit clin d’œil à mes racines américaines) réalise ses interventions parmi les jeunes de la banlieue de Washington D.C., notamment dans le contexte des violences policières accrues, le Street Law de Sciences Po, comme il a été conçu grâce à la vision et à la réflexion de Professeure Marie Mercat-Bruns, intervient sur divers terrains, parmi des jeunes, des personnes à la retraite, des femmes et des hommes, etc. Le projet s’ancre sur différents terrains grâce à nos partenariats, tout en intervenant pour des publics très variés sur ces divers terrains. Cette année avec l’arrivée de Razin, le projet s’est étendu pour la première fois à des interventions dans des lycées, par le biais du volet Law in School du projet, amenant d’autres perspectives dans nos échanges durant l’atelier, étant donné que chaque individu apporte leur expérience de vie, leur récit et leur voix.
Quel est votre parcours académique et professionnel ?
Diplômée du Master Droit économique et du LL.M Transnational Arbitration and Dispute Resolution de l’École de droit de Sciences Po, j’ai suivi le cursus de droit français en première année de mes études, avant de me spécialiser dans le règlement de différends et le droit international public. À présent, je suis juriste au sein du cabinet Clay Arbitration, fondé par le Professeur Thomas Clay, ancien Président de la Sorbonne. Je suis amenée à travailler sur des dossiers d’arbitrage international commercial et d’investissement, comportant de véritables enjeux géopolitiques et étatiques, et ce qui me plaît particulièrement est le processus de réflexion et d’interprétation lié à l’interpellation du droit et son application sur le terrain dans un tel contexte ; ce qui me donne des idées à explorer potentiellement un jour sur des sujets pointus de la doctrine… d’ailleurs, j’ai l’immense privilège d’être entourée par des collègues qui sont à la fois des avocats en conseil et d’arbitre, ainsi qu’en étant des académiciens.
Quel est votre rôle en tant que tutrice ?
Notre rôle avec mon cotuteur, Razin, est d’encadrer à la fois la préparation du projet d’atelier des étudiants ainsi que l’intervention-même, et d’entamer une bonne communication avec nos partenariats, je pense notamment à Jalalle, Abdenour, et Emmanuel, des personnes avec lesquelles nous cultivons une véritable collaboration afin d’intervenir au café-associatif Tilia, dans un lycée professionnel à Sarcelles, dans des foyers, parmi d’autres… alors notre rôle, c’est de permettre des conditions dans lesquelles ces personnes peuvent se concerter avec nous et avec les étudiants ; et à l’inverse pour nous avec eux et avec leurs publics !
Il faudrait donc veiller à une dynamique permettant un échange constant, pendant et entre les interventions : c’est le vent derrière nos voiles, par lequel Street Law-Law in School navigue comme projet de la Clinique.
Mohamed Razin Chekroud et son rôle dans le projet
Quel est votre parcours académique et professionnel ?
Après un Master Droit Public Économique à Sciences Po Paris, j'ai obtenu l'examen du Barreau et suis actuellement élève-avocat à l'École de Formation des Barreaux de Paris (EFB). En parallèle de ces études, j'ai réalisé diverses expériences au sein de directions juridiques d'entreprise et de cabinets d'avocats, et notamment A&O Shearman, qui a soutenu financièrement, accompagné et permis la mise en œuvre du projet Street Law / Law in School.
Quel est votre rôle dans le projet ?

Avec la cotutrice du projet Deirdre, nous sommes chargés de l'organisation d'ateliers d'éducation au droit dans les lycées, notamment professionnels, tels que le lycée Maryse Condé de Sarcelles, ainsi que les autres théâtres d'intervention du projet, principalement le café associatif Tilia et des foyers. Dans ce cadre, nous assurons la coordination avec les équipes pédagogiques pour ce qui est des lycées, et les associations actives en faveur de l'égalité des chances qui sont partenaires du projet, à l'instar d'Une voie pour tous. Nous encadrons également les étudiants et les orientons dans la préparation des ateliers. Enfin, j'assure également le contact avec le cabinet d'avocats A&O Shearman et l'École de droit de Sciences Po, soutiens du projet depuis ses débuts.
Sessions d’information : Masters
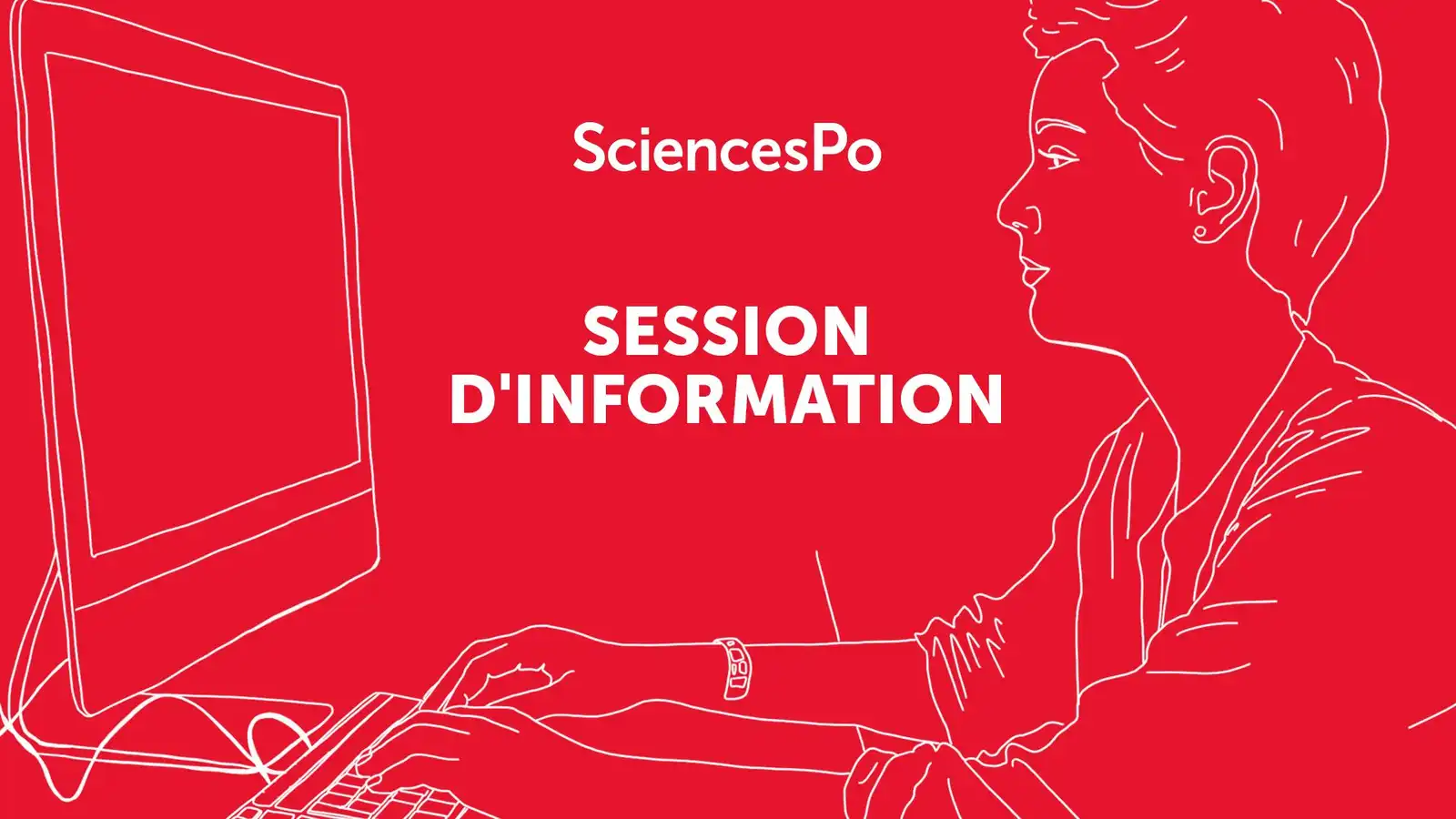
Découvrez les Masters et le large choix de spécialisations des 8 Écoles professionnelles de Sciences Po lors de nos webinaires dédiés aux candidats.