Accueil>PFAS et Vallée de la Chimie : l’expérience clinique des étudiants

11.09.2025
PFAS et Vallée de la Chimie : l’expérience clinique des étudiants
En 2023-2024, Aimée Boukandja-Beaudeux et Connor Milton, étudiants en Master in Environmental Policy (2e année), ont mené le projet clinique « Vallée de la chimie : Soutenir une meilleure réglementation sur les PFAS », en partenariat avec l’association Notre Affaire à Tous – Lyon, dans le cadre du programme clinique Justice Environnementale et Transition Écologique (JETE).
Dans la continuité de cette réflexion sur les pollutions qui affectent le bassin lyonnais mais aussi l’ensemble du territoire, leur travail a porté sur l’encadrement réglementaire des substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) à l’échelle nationale. Il a abouti à la publication d’un rapport proposant trois recommandations.
Découvrez le rapport rédigé sous la tutelle de Philippine Garrigue, ainsi que l’article PFAS : illustration de la réglementation à l’échelle mondiale, publié sur le site de Notre Affaire à Tous – Lyon (29 mai 2024).
Avec le recul, Aimée Boukandja-Beaudeux et Connor Milton partagent également leur retour d’expérience sur ce projet clinique et leur participation à la Clinique de l’École de droit.
Pouvez-vous nous présenter votre projet clinique sur la Vallée de la chimie et les PFAS, et nous expliquer comment il est né ?

Le projet Notre Affaire à Tous (NAAT) a débuté par une recherche-action dans la Vallée de la Chimie, territoire marqué par la présence de nombreuses installations classées. Avec la diffusion du documentaire Vert de rage - Pesticides, poisons éternels ?, qui a mis en lumière l’ampleur de la contamination, nous avons progressivement recentré notre travail sur la question des PFAS, à partir de 2022.
Face à une pollution devenue une véritable crise nationale, largement relayée par les médias, nous avons voulu mieux comprendre le problème : pourquoi ces substances sont-elles produites, où sont-elles fabriquées, quelles alternatives existent, et quelles lacunes persistent dans la régulation ?
Après avoir exploré une approche pénale dans les premières années, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur la nécessité d’un encadrement réglementaire plus strict, afin de limiter la production de PFAS et, par conséquent, leur dissémination dans l’environnement.
Cette orientation nous a conduits à participer aux auditions de la mission parlementaire sur les PFAS, menée en 2023 par le député Cyrille Isaac-Sibille à la demande du gouvernement. Nous avons cherché à montrer l’ampleur de la pollution, ses conséquences sanitaires et environnementales à long terme, et l’urgence d’agir. Pour cela, nous avons mené des recherches pour identifier les entreprises et sites industriels responsables, ainsi que les acteurs politiques impliqués dans la régulation, en nous appuyant sur l’expertise de NAAT et son travail auprès des communautés touchées dans la Vallée de la Chimie. Cette confrontation directe avec les grands acteurs industriels de la chimie fut particulièrement enrichissante.
Une fois ce diagnostic �établi à l’échelle nationale, nous avons élargi notre regard à l’international. L’objectif : analyser les politiques mises en place ailleurs en Europe et dans le monde, évaluer leur efficacité et tirer des enseignements utiles pour la France. Nous nous sommes ainsi interrogés :
- Quelles mesures ont été adoptées pour encadrer l’utilisation des PFAS ?
- Ont-elles permis de réduire la pollution ?
- Existe-t-il des alternatives plus sûres, notamment pour les produits essentiels comme les mousses anti-incendie ?
Quels étaient les objectifs que vous vous étiez fixés ?
En comparant différentes approches réglementaires, nous avons cherché à identifier les meilleures pratiques pouvant inspirer la France et à explorer des moyens d’encadrer plus efficacement les PFAS, afin de mieux protéger la population et l’environnement.
Cette analyse a révélé le retard français en matière de réglementation et renforcé notre conviction qu’il est urgent et possible d’agir.
Dans ce contexte, et après avoir échangé avec des acteurs politiques impliqués dans l’élaboration d’une proposition de loi visant à interdire les PFAS, nous avons décidé de compiler et d’analyser les réglementations en vigueur dans plusieurs pays. Ce travail a abouti à un rapport détaillé, destiné au Parlement, visant à offrir une meilleure compréhension des cadres existants et à soutenir le renforcement de la législation en France. Ce rapport constitue également une base de données utile pour les décideurs, en particulier dans le cadre des débats autour de la proposition de loi PFAS au printemps 2024.
Nous avons ensuite eu l’opportunité d’organiser un événement transpartisan à l’Assemblée nationale, avec le soutien du rapporteur de la proposition de loi, le député Nicolas Thierry, et du rapporteur de la mission parlementaire, Cyrille Isaac-Sibille. Cet échange a permis de diffuser notre étude, de partager les expériences étrangères et de montrer aux parlementaires les pistes concrètes qu’il est possible d’adopter en France.
Quels résultats avez-vous obtenus et quelle suite a été donnée au projet ?
Une première victoire a été le vote de la loi PFAS le 4 avril 2024 à l’Assemblée nationale.
Restait à convaincre le Sénat, chargé de l’adopter en seconde lecture. Pour cela, nous avons transmis notre étude comparative à tous les sénateurs, et Emma Feyeux, notre partenaire de NAAT, a été auditionnée dans le cadre des commissions parlementaires. L’adoption au Sénat, loin d’être acquise, constituait une étape cruciale.
La dissolution a ralenti le processus, mais en février 2025, le gouvernement a choisi de s’emparer du sujet et de soutenir la loi, marquant une troisième victoire. Enfin, la loi a été définitivement adoptée le 26 février 2025 avec une écrasante majorité.
Ces résultats concrets, obtenus en si peu de temps, montrent que nos efforts ont porté leurs fruits. Après s’être concentré sur l’échelle nationale, le projet va désormais s’orienter vers l’échelle internationale.
En quoi cette expérience a-t-elle contribué à la construction de vos projets, tant professionnels que personnels ? Qu’avez-vous appris ?
Sur le plan professionnel, la Clinique de l’École de droit nous a permis d’acquérir des compétences essentielles en recherche et analyse institutionnelle. Bien que nous soyons issus d’un Master à la Paris School of International Affairs (PSIA) sans formation juridique formelle, cette expérience nous a offert une approche concrète du droit, nous apprenant à conceptualiser, exécuter et mener à bien un projet juridique.
Nous avons également développé des compétences en gestion de projet, communication et travail d’équipe, désormais centrales dans notre activité professionnelle. En participant à une commission parlementaire sur les PFAS et en organisant un événement à l’Assemblée nationale sur la nécessité de légiférer, nous avons pu observer de près les rouages de l’élaboration des lois et acquérir une perspective unique sur le fonctionnement du gouvernement.
Nous avons par ailleurs rédigé une étude comparative internationale des législations sur les PFAS, diffusée à l’ensemble des députés et sénateurs afin de les informer sur la future loi PFAS. L’adoption de cette loi représente une victoire concrète et directe, illustrant l’impact tangible de notre travail. Cette expérience a enfin approfondi notre compréhension du rôle du droit dans les enjeux environnementaux et éveillé notre intérêt pour le plaidoyer juridique dans ce domaine.
Sur le plan personnel, cette expérience nous a montré à quel point le plaidoyer juridique et le travail collaboratif peuvent être des moteurs puissants de changement. Lorsque nous avons lancé le projet en 2023, les PFAS étaient un sujet marginal en France et l’idée d’une interdiction semblait presque irréaliste.
Nous avons appris la patience et la persévérance, et compris que les grands changements naissent souvent d’initiatives modestes. Cette expérience nous a enseigné que l’impact d’un projet ne se mesure pas seulement à ses résultats immédiats, mais aussi à l’élan qu’il génère sur le long terme.
Philippine Garrigue, avocate, nous parle de son rôle de tutrice dans le projet.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel ?

J’ai intégré Sciences Po en master dans le cadre du double diplôme avec la Freie Universität de Berlin, en affaires européennes et administration publique. C’est au cours de cette formation que j’ai découvert un véritable intérêt pour le droit, ce qui m’a amenée à me réorienter vers cette discipline. J’ai alors candidaté à la passerelle entre l’École d’Affaires Publiques et l’École de droit, que j’ai intégrée par la suite.
Au sein de la spécialité Droit Public Économique du master Droit économique, j’ai souhaité allier théorie et pratique juridique. J’ai rejoint la Clinique de l’École de droit en tant qu'étudiante dans le programme Human rights, Economic Development and Globalization (HEDG), et participé à un projet avec l’association Notre Affaire à Tous sur la Vallée de la Chimie. Cette expérience a été une véritable révélation : elle m’a montré concrètement comment le droit pouvait servir la protection de l’environnement et combien les initiatives associatives étaient essentielles dans ce domaine.
Cette expérience a également renforcé ma volonté de devenir avocate. Après l’obtention du barreau et du CAPA, j’ai d’abord intégré un cabinet spécialisé en contentieux de la commande publique. J’ai ensuite rejoint une structure engagée sur les enjeux environnementaux, notamment en droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, un aspect crucial de la lutte contre le changement climatique.
Quel est votre rôle en tant que tutrice ?
Parallèlement à mon parcours professionnel, j’ai poursuivi mon engagement au sein de la Clinique juridique, cette fois en tant que tutrice, rôle que j’assume depuis maintenant quatre ans.
Ma mission consiste à accompagner les étudiants dans la réalisation de leur projet, en leur transmettant les connaissances juridiques nécessaires pour comprendre les enjeux et les mettre en œuvre de manière pertinente.
L’un des aspects les plus stimulants de cet engagement est la diversité des profils au sein de la Clinique : tous les étudiants ne sont pas juristes. J’ai donc dû adapter mes explications, vulgariser certaines notions complexes et rendre le droit accessible à tous, sans perdre en rigueur.
Mon engagement dépasse le cadre des cours. Aujourd’hui, nous construisons le projet et les enseignements théoriques en binôme avec la partenaire de Notre Affaire à Tous, ce qui renforce la collaboration et l’efficacité pédagogique.
EN SAVOIR PLUS
- Découvrir les activités de la Clinique de l’École de droit
- Découvrir le programme clinique Justice environnementale et transition écologique (JETE)
- Pour en savoir plus sur les travaux et publications de la Clinique de l’�École de droit
Légende de l'image de couverture : Raffinerie de Feyzin (Lyon, France, 14 mars 2025) (crédits : Novikov Aleksey / Shutterstock)
Sessions d’information : Masters
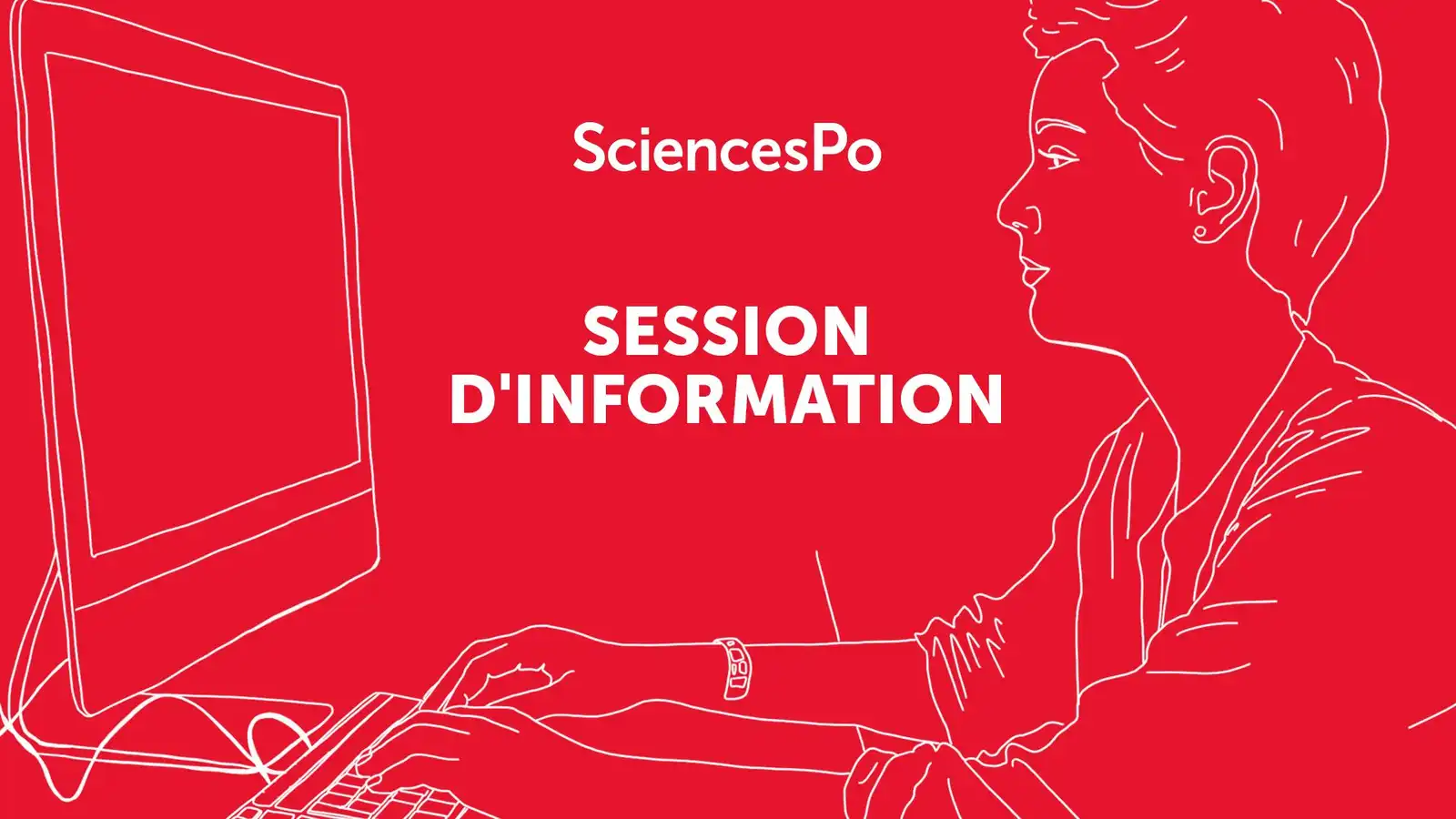
Découvrez les Masters et le large choix de spécialisations des 8 Écoles professionnelles de Sciences Po lors de nos webinaires dédiés aux candidats.