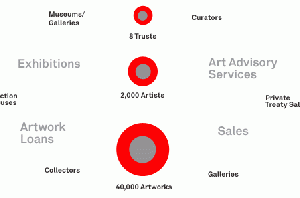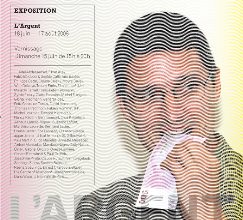Faire se rencontrer un acteur du monde de l’art et un économiste spécialisé répond aux règles fixées pour notre séminaire cette année. Simon Njami est bien connu pour ses textes et ses expositions — nous lui devons notamment la définition d’un sens de la contemporanéité en Afrique par les Africains eux-mêmes et affranchie des critères occidentaux. Il fait ici une lecture deleuzienne des règles intransigeantes du marché de l’art international.
L’économiste Philippe Petit lui répond qu’il en va de l’art comme du reste, à cette réserve près que le monde économique — même s’il le voulait — ne peut tout domestiquer. Il rappelle que la communauté des économistes a bien du mal à définir ce qu’est un marché et comment s’y forment les valeurs : l’objet d’art lui semble y tenir une place singulière, ne serait-ce que parce que la valeur qui lui est assignée dépasse de loin sa simple financiarisation. L’œuvre d’art serait alors, selon lui, une sorte de rempart symbolique fondé sur une dimension empathique et ouverte aux problèmes d’autrui qui la rendrait propice à une appropriation citoyenne.
Laurence Bertrand Dorléac
Séminaire du 1er octobre 2009
Sur la valeur de l'œuvre d'art...
et de l'artiste :
de la fébrilité des marchés et au-delà
Pascal Petit
Qui dit valeur de l’œuvre d’art pense avant tout en 2009 à sa valeur marchande. Signe des temps mais qui ne simplifie guère les choses car, curieusement, la communauté des économistes a les plus grandes difficultés à définir avec toute la généralité qu’elle souhaiterait ce qu’est un marché et comment s’y forment les valeurs. La raison en est simple, les marchés sont des constructions sociales avec leur histoire et leurs forces de changement. Et le marché de l’art est à cet égard des plus spécifiques, peut être précisément parce que ses objets sont plus que d’autres chargés de valeurs non marchandes, au sens plein du terme de ce qui existe en dehors et au-delà de rapports marchands. C’est une spécificité forte de l’objet dit d’art que l’on saisit mieux, si un instant, on pense au statut de l’objet d’art dans des sociétés sans marché…ni histoire.
Cette simplification, malgré ce qu’elle a d’abusif, nous aide à faire ressortir la dimension totémique qu’acquiert nombre d’objets dans des sociétés où les rapports sociaux de production et d’échange se reproduisent de façon immuable. La distinction de statut dont sont investis certains objets fait partie de la tradition et les jeunes y sont initiés. Si maintenant, poursuivant notre expérience de pensée, nous imaginons des sociétés qui se construisent une histoire au fil des ruptures qui s’opèrent en leur sein ou dans leur environnement, remarquons que les objets d’art peuvent aussi s’inscrire de façon active dans cette émergence de valeurs nouvelles, de ruptures de codes anciens. La consécration de l’objet d’art sera intrinsèquement aussi celle de modes et de révolutions.
Ce sont là deux dimensions d’identification et de rupture, inhérentes à ce qui acquiert le statut d’objet d’art, qui lui confère une sorte de valeur transcendantale que les rapports marchands ne domestiqueront jamais totalement, quelles que soient les formes qu’ils pourront revêtir au cours de l’histoire. Ce postulat peut nous aider à suivre les grandeurs et vicissitudes des rapports marchands qui vont se créer autour des objets d’art, disons de l’ère des lumières à nos jours.
De l’ère des lumières, car avec elle s’opère une claire distinction entre ce qui est d’ordre divin ou profane, laissant la valeur de l’objet d’art s’établir dans un rapport direct avec les hommes, ceux qui vont la créer, ceux qui vont la posséder et tous ceux qui vont la reconnaître ou la nier. C’est aussi une période à partir de laquelle l’artiste est parfaitement reconnu. Cette distinction du créateur est une caractéristique forte du marché de l’art. La reconnaissance de l’artiste va de pair avec celle de l’objet d’art, alors que pour tout autre objet le rapport marchand a en premier lieu un rôle d’écran. Il est transfert de propriété sans mémoire : possession vaut titre alors que l’objet d’art tient une grande part de sa valeur de ce que le cordon n’est jamais rompu.
Mais revenons à l’histoire « moderne » de ces rapports marchands particuliers. Le fait important est alors l’émergence de l’artiste qui dans son atelier cherche à rendre compte du monde de façon « réaliste » , à sa manière, dans ses œuvres, peintures ou sculptures. La renaissance avait déjà redonné figure à l’artiste, écho des statuts divers que ces derniers avaient pu avoir dans l’antiquité. Le siècle des lumières consacre son environnement de travail, domestiquant la valeur de ses productions. Le travail bien fait comme le temps passé donne sa valeur aux productions de l’artisan qu’est l’artiste, son atelier est un lieu d’exposition et de vente. Le marché de l’art est au plus proche de celui des produits de l’ère pré industrielle. Ce classicisme ne réduit pas pour autant toutes les singularités de l’œuvre d’art. Quelque chose échappe au réalisme des portraits du monde, ce que traduit l’énoncé du philosophe du 17ème siècle Francis Bacon : « la nature des choses se livre davantage à travers les vexations de l’art que dans sa liberté propre »[ref]Enoncé qui inspira le titre de l’ouvrage de Svetlana Alpers (2005).[/ref]. La valeur des grandes œuvres se nourrira de l’étrangeté des regards que sauront poser sur le monde des grands maîtres de Vélasquez ou du Gréco aux peintres français de la fin du 19ème comme Courbet ou Renoir.
Mais l’ère industrielle, où la manufacture va définitivement consacrer la séparation entre producteur et produit, s’accompagnera d’une réelle rupture, accentuant les singularités des marchés de l’art. C’est dans les temps longs de cette évolution industrielle que l’on voit la figure de l’artiste acquérir une autonomie radicalement nouvelle. La figure emblématique de cette émancipation apparaîtra dans l’entre deux guerres avec les surréalistes, leur manifeste et les ready made de Marcel Duchamp, pied de nez volontaire aux autres marchés que gagne la standardisation. Mais cela n’est possible que dans la mesure où une fraction de la clientèle des marchés de l’art se reconnaît elle-même dans cette « vexation » de l’art poussée à une puissance nouvelle. La volonté de distinction des nouvelles classes bourgeoises que souligne Thorstein Veblen au tournant du 20ème siècle se prête bien à cette « révolution ».
Le marché de l’art acquiert ainsi ses caractéristiques modernes, le singularisant fortement des structures de marché de produits, en particulier par le statut donné à l’artiste, comme par les postures différenciées de sa clientèle. Ce marché de l’art semble ainsi renouer avec les dimensions qui furent les siennes dans ces arts dits premiers.
C’est sans doute ce que l’on a pu croire au sortir d’une seconde guerre mondiale où les régimes totalitaires avaient réintroduit un temps des formes archaïques d’un art d’Etat, mêlant cyniquement rapport marchand et pillage des œuvres. En fait, les deux dernières décennies du vingtième siècle, marquées par une certaine généralisation des rapports marchands à l’échelle du monde, ont fait apparaitre la complexité des liens qui pouvaient être tissés entre ce monde de l’art, devenu indissociable de celui des artistes comme de celui des amateurs et des promoteurs, et celui des affaires.
Cela se voit tout d’abord à l’importance des intermédiations. L’art de la distinction des amateurs, que soulignait après Veblen Pierre Bourdieu, passe maintenant par tout un appareillage de musées, médias, autres institutions publiques et mouvements associatifs sans parler du rôle plus classique des galeristes et autres intermédiaires directement intéressés à la commercialisation des produits. Cette intermédiation à multiples relais fait du marché de l’art (prenant un singulier pour cet ensemble très pluriel pour souligner l’imbrication de ces différents marchés) celui où la fonction de prescription est des plus sophistiquée. Elle peut prendre comme objet aussi bien le produit que l’artiste ou un groupe d’amateurs spécifiques.
Un des produits de cette forte mobilisation d’intermédiaires et de la triple dimensionnalité de ce qui se vend, tout à la fois les œuvres, les artistes et les amateurs ou experts éclairés, est une affluence extrême de « mouvements artistiques » vendus comme autant de différenciations de produits.
Cette imbrication singulière des relations marchandes dans un domaine artistique d’une envergure nouvelle par la place qu’il s’est acquis dans la cité, jouant sur les différentes dimensions qu’il a pu déployer dans la première moitié (autonomie de l’artiste) puis la seconde moitié (autonomie de l’intermédiation) du vingtième siècle, n’en suit pas moins les évolutions générales qui peuvent affecter les rapports marchands de par le monde (cf Benhamou 2008).
Les deux dernières décennies ont vu les rapports marchands largement transformés par les développements d’une finance globalisée. Cette vague de financiarisation a eu ses répercussions sur le marché de l’art (singulier et pluriel). La dimension spéculative, déjà inhérente à des marchés qui par essence prennent parti sur l’avenir d’œuvres, d’artistes et d’amateurs s’en est trouvée fortement accrue. Les facilités de crédit ont conduit à la constitution de bulles spéculatives, forçant certaines côtes dans l’espoir de revendre à moyen terme des produits rapidement surévalués.
Malgré l’échelle internationale de ces pratiques, qui peut toucher plus particulièrement les formes d’art très contemporain (cf Moreau et Sagot-Duvauroux, 2006), l’importance de la socialisation qui s’est créée autour des domaines artistiques devrait permettre de limiter les dérives que peuvent provoquer quelques très riches opérateurs dont les préoccupations fiscales sont souvent claires. Ceci passe sans doute par un apprentissage collectif et des actions de réglementations publiques diligentes. L’interdiction faite aux grandes officines de ventes aux enchères de prêter de l’argent aux enchérisseurs, comme une plus grande vigilance sur la valeur réelle des dons d’œuvres d’art, contreparties d’avantages fiscaux vont dans le bon sens.
Une façon de hâter un jugement de l’histoire sur la valeur des œuvres d’art que l’on pressent plus juste, même si le temps passé ne fait pas disparaître coteries et spéculations.
Mais cette vigilance dans le domaine devrait surtout tenir à ce qui perdure largement dans ces marchés d’art des dimensions initiales, fondamentalement non marchandes, dans la valeur assignée aux œuvres d’art. Dans un univers asséché par la généralisation de rapports marchands, dans des aspects toujours plus nombreux de la vie sociale, le domaine artistique conserve une dimension empathique, d’ouverture et d’écoute aux problèmes et vues d’autrui qui reste relativement unique, spécifique. On en perçoit l’importance à la place prise par l’art à tous les niveaux de la cité, dans ses formes les plus magnifiées comme les plus modestes. Cette empathie est d’ordre émotionnel, largement portée par un rapport aux artistes, elle est aussi d’ordre cognitif, portée par tous les signes de reconnaissance qu’inscrivent les nombreuses instances d’intermédiation. Tous ces arts modernes ont par là conservé ou plutôt reconstruit des dimensions fondamentales que l’on reconnait aux arts premiers. En ce sens, la meilleure façon de pallier les nombreuses dérives que provoque inéluctablement l’imbrication partielle de ces rapports avec des relations marchandes est de favoriser confrontations et réappropriations citoyennes de la création artistique dans toutes ses dimensions. Une façon d’y parvenir serait de multiplier les formes collectives non marchandes d’interventions, en particulier au sein du vaste espace d’intermédiation qui s’est constitué dans la seconde moitié du 20ème siècle. Il y a là un potentiel pour une appropriation citoyenne qui contribuerait à pallier les dérives induites par une financiarisation qui s’est exercée de façon excessive et à une échelle internationale.
Bibliographie
ALPERS, S., Les vexations de l’art : Velasquez et les autres, Paris, Gallimard, 2005.
BENHAMOU, F., L’économie de la culture, Paris, La Découverte, Collection Repères, 2008.
BOURDIEU, P., La distinction :critique sociale du jugement, Paris Editions de Minuit, 1979.
MOUREAU, N., SAGOT-DUVAUROUX, D., La marché de l’art contemporain, Paris, La Découverte, Collection Repères, 2006.
VEBLEN, T., The theory of the leisure class, Penguin Books, 1899, 1994.
Pascal Petit est économiste, Directeur de recherche au CNRS, attaché (et ex- directeur) au CEPN (Centre d’Economie de Paris Nord), associé au CEPREMAP (Centre pour la Recherche Economique et ses Applications, Paris). Il est l’auteur de nombreux textes dont : Technology and the Future of European Employment, edited with L.Soete, Edward Elgar Publishers, Aldershot, UK, 1999; Economics and Information, editor, Kluwer, 2001; « Croissance et richesse des nations », collection Repères, La Découverte, Paris, Novembre, 2005; « The hardship of nations: exploring the paths of modern capitalism », edited by B Coriat, G Schmeder, Edward Elgar. Publishers, Aldershot, UK, 2006.