


Pour un droit constitutionnel de l’énergie
19 septembre 2024
Un droit sans conditions pour le vivant
8 octobre 2024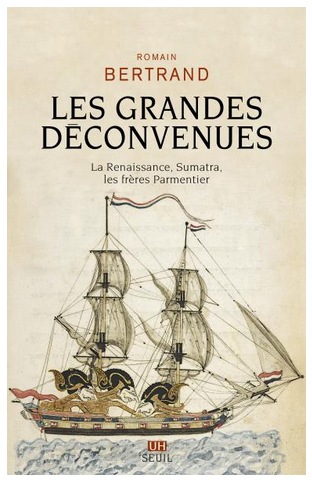 C’est l’histoire vraie d’une expédition normande vers l’île Sumatra au XVIᵉ siècle. Celle de son quotidien, de ses coûts, de ses rencontres et de ses désastres. L’histoire des hommes qui l’ont faite, de leurs compétences, de leurs façons d’être au monde. L’histoire de son motif premier : la recherche de profit.
C’est l’histoire vraie d’une expédition normande vers l’île Sumatra au XVIᵉ siècle. Celle de son quotidien, de ses coûts, de ses rencontres et de ses désastres. L’histoire des hommes qui l’ont faite, de leurs compétences, de leurs façons d’être au monde. L’histoire de son motif premier : la recherche de profit.
Mais c’est aussi l’histoire de sa légende, lorsqu’au XIXe siècle, l’expédition des frères Parmentier devient – comme tant d’autres “grandes découvertes” — une épopée héroïque conduite par des humanistes curieux de nouvelles sociétés.
Pourquoi le XIXe siècle a-t-il façonné cette légende ? Qu’en avons-nous hérité ? Quelles leçons en tirer ? C’est ce que questionne Romain Bertrand, historien de l’Asie du Sud-Est au CERI, dans son ouvrage Les Grandes Déconvenues, la Renaissance, Sumatra et les Frères Parmentier (Seuil, 2024). Entretien.
Pourquoi avoir étudié l’expédition des frères Parmentier ?
Romain Bertrand : Depuis plus de vingt ans, j’étudie les situations de contact, de premières rencontres entre les sociétés européennes et les sociétés de l’Asie du Sud-Est. Je m’attache à porter un regard pluriel : les légendes, les réalités, l’historiographie, ce que cela nous dit de nos propres sociétés.
Jusqu’à présent, je m’étais abstenu de travailler sur la France, j’estimais qu’il était plus facile, lorsque l’on touche à l’histoire coloniale, de ne pas travailler sur le pays dont l’on est issu. De plus, au début des années 2000, le champ de l’histoire coloniale en France était politiquement surinvesti. J’ai préféré travailler sur l’Indonésie à partir de sources néerlandaises et ibériques. Mais, en 2020, alors que la pandémie empêchait de voyager et que je ne pouvais accéder aux archives pour l’ouvrage sur lequel je travaillais, un éditeur m’a proposé de rééditer le récit de voyage de deux capitaines français, les frères Jean et Raoul Parmentier, à Sumatra. Le manuscrit, rédigé par Pierre Crignon au XVI siècle, n’avait pas fait l’objet d’une édition critique depuis le XIXe siècle.
Je me suis penché sur le sujet et les archives que j’ai trouvées à Rouen, à Dieppe et au Havre m’ont convaincu qu’il y avait matière à rouvrir le dossier : le périple des frères Parmentier jusqu’à Sumatra en 1529 a joué un rôle extrêmement important au XIXe siècle, dans une histoire qui nous concerne tous.
On parle donc d’une histoire du XVIe siècle réécrite au XIXe siècle ?
Romain Bertrand : Oui, au XIXe, les pays européens se font concurrence pour savoir qui a pris la plus grande part aux premières Grandes découvertes. Or, pour quantité de raisons, la France n’avait pas investi autant que le Portugal et l’Espagne dans les expéditions maritimes au XVIe siècle. Ainsi, quand elle redéveloppe ses ambitions impériales dans l’océan Indien et en Asie du Sud-Est, au XIXe siècle, l’histoire des frères Parmentier lui sert à montrer qu’elle était là, au commencement des présences européennes en Asie. Et donc qu’elle a, de droit, un rôle à jouer dans cette partie du monde. L’expédition des frères Parmentier, aujourd’hui un peu oubliée, sauf en Normandie, a été une légende extrêmement puissante, au même titre que toute l’histoire des Grandes découvertes…

Jehan Ango, sa femme et sa fille, miniature du Maître des Heures Ango tirée de son livre d’heures, vers 1514-1515. Source gallica.bnf.fr / BnF
L’un de ses personnages clés est un dénommé Jean Ango, son armateur. Il affrète et avitaille les navires, le Sacre et la Pensée, dont Jean et Raoul Parmentier vont prendre le commandement. Dans l’historiographie du XIXe siècle, et jusqu’à nos jours, on le présente comme un humaniste, un esprit éclairé, un amateur de belles choses et de belles idées. Issu du petit peuple, il se serait forgé une destinée à la seule force de sa volonté. Il aurait été l’ami intime du roi François Iᵉʳ, ainsi qu’un passeur de savoirs conversant avec les grands savants de la Renaissance. Mais les archives montrent un personnage tout autre ! Il vient d’une famille de grands notables rouennais, n’est pas l’ami du roi, mais l’un de ses obligés, il n’a de rapports que très superficiels avec la culture humaniste. Il est très riche, certes, mais pas seulement grâce au commerce légal, à la pêche harenguière ou à ses activités de percepteur de droits seigneuriaux : l’essentiel de sa fortune lui vient de la « guerre de course », une forme de brigandage maritime qui se distingue mal, alors, de la piraterie. Son image d’érudit raffiné ou d’esprit humaniste est aussi mise à mal au vu de la violence qui entache l’expédition des frères Parmentier.
Jean Ango est présenté comme un être exceptionnel parce que toute légende commence par singulariser un personnage pour en faire un héros. Mais ce qui nous intéresse, en histoire comme dans d’autres sciences sociales, c’est de rappeler la réalité et pour cela de comprendre comment un moment, un monde, des institutions rendent possible ce genre de personnage. Chemin faisant, on s’aperçoit qu’à l’époque, les Jean Ango sont nombreux sur la façade atlantique. À travers l’enquête sur Jean Ango, on peut dévoiler le monde social et politique qui a rendu possible ce type de personnage et sa trajectoire.
Quid des frères Parmentier ? Qui sont-ils ?
Romain Bertrand : Il faut d’abord préciser que ce voyage à Sumatra en 1529 a été un échec à tous points de vue : humain, commercial et diplomatique. Un tiers des équipages y a perdu la vie ; l’expédition n’a pas rapporté suffisamment d’or et d’épices pour couvrir ne serait-ce que les frais d’avitaillement des navires ; les relations brièvement nouées avec les sociétés de l’océan Indien se sont achevées dans la défiance et l’affrontement.
Nous ne savons presque rien du cadet, Raoul. En revanche, Jean est un personnage connu, et ce, sous deux visages très différents. Il est d’une part l’homme qui mène l’expédition, et dont on présuppose souvent qu’il a mené d’autres expéditions vers le Brésil ou la Guinée. Il est capitaine, marin professionnel, féru d’astronomie nautique. Mais il est aussi connu en histoire littéraire grâce aux nombreux poèmes consacrés à exalter les vertus et la gloire de la Vierge Marie qu’il a écrits pour les prononcer lors de concours organisés par des confréries de laïcs à vocation religieuse.

Poème de Jean Parmentier illustré : « Au parfaict port de salut et de joie » (1501-1600), Source gallica.bnf.fr / BnF
Jean Parmentier s’y était distingué par sa langue et par l’emploi de l’imaginaire et du lexique de son métier de navigateur. Sous sa plume, le pilote guidant son navire sur une mer tempétueuse devient l’incarnation du bon croyant guidé par sa foi en Dieu et en la mansuétude de la Vierge Marie vers le havre du Salut.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, c’est un personnage extraordinairement intéressant et attachant.
Comment avez-vous abordé l’histoire de cette expédition ?
Romain Bertrand : Pour approcher la réalité, je me pose souvent des questions simples, de scénariste : comment ferais-je si je devais transformer en film le récit établi par Pierre Crignon ? Comme beaucoup de récits de voyage européens de cette époque, celui de Crignon offre exclusivement la vision des Européens. Il nous parle de l’océan Indien et du monde malais vus depuis le pont du bateau, de l’île de Sumatra vue depuis le quartier du port. Cette vision est très partielle, alors que dans un film, j’aurais besoin de dresser des paysages autour des acteurs, de voir plus loin que le bastingage de la nef ou les palissades de la cité portuaire.
Ce dont nous parlent les récits dont on dispose, c’est essentiellement de ce qu’était être Normand, « Français », ou chrétien à l’époque, très peu des sociétés asiatiques. Personne ne s’est vraiment demandé ce qu’était Sumatra à l’époque. Et dès qu’on se pose la question et qu’on entreprend d’y répondre en s’aidant des études et des matériaux à disposition, on se rend compte que l’île ne se réduit pas à ce que les Normands en ont vu et pensé. C’est une société très protocolaire et ritualiste, composée de cités-États épousant le modèle des sultanats malais. Elle est aussi très fluide et cosmopolite, étant le produit d’influences extérieures anciennes. De longue date, elle accueille des marchands chinois, indiens et arabes et est, à l’époque, en voie d’islamisation. Elle est ouverte sur l’océan Indien et faite de cultures politiques, littéraires, religieuses extrêmement sophistiquées.
Pour comprendre les frères Parmentier, je me suis interrogé sur ce qu’est devenir, puis être, navigateur à Dieppe à cette époque. C’est ce genre d’enquête qui permet de comprendre comment se façonnent les compétences, les dispositions, les rapports sensibles au monde. Puis, je me suis posé des questions concrètes sur l’expédition: comment les Normands ont-ils fait pour nouer un échange avec les insulaires de Sumatra ? Qui est leur interprète et quelles langues parle-t-il ? Comment les Dieppois se procurent-ils à manger ? Comment pèsent-ils les produits qu’ils achètent ? Les Européens ont toujours l’impression d’être roulés dans la farine lorsqu’ils font des échanges, des achats ou du troc. Mais c’est tout simplement qu’ils ne connaissent pas les monnaies locales et les taux de change et de conversion en vigueur. À leur arrivée, l’univers commercial de l’océan Indien, avec son lot de normes et de rituels, leur est parfaitement inconnu : ils multiplient les gaffes, les impairs. C’est en se posant de toutes petites questions que l’on commence à tisser un récit.
Votre ouvrage s’inscrit aussi dans la construction d’un autre récit, celui de la modernité et des Grandes découvertes…

Détail – Chantier de construction navale, Pascal de La Rose, 1708, Musée de la Marine de Toulon
Romain Bertrand : Si les Grandes découvertes traitent de faits survenus aux XVe et XVIe siècles, elles sont la grande affaire du XIXe siècle. La notion même de Grandes découvertes n’apparaît pas avant les années 1810, on la voit surgir dans l’œuvre du naturaliste Alexandre de Humboldt (1769-1859). C’est un pur construit, comme la plupart des chrononymes dont nous usons aujourd’hui – Renaissance, Temps modernes, etc. -, lesquels datent pour la plupart du XIXe siècle. On a alors concocté un grand récit en sélectionnant les explorations ou les conquêtes qui ont été des réussites. Mais lorsqu’on se plonge dans les sources, on constate que pour une expédition réussie, il en existe des dizaines, des centaines qui ont échoué. Pour un bateau qui arrive à Sumatra, dix font naufrage ou se perdent en chemin.
On nous raconte une success story, mais la réalité, ne serait-ce que statistique, est que les Grandes découvertes sont des « grandes déconvenues », c’est-à-dire des centaines, peut-être des milliers d’échecs militaires, de désastres commerciaux, de mésaventures humaines. Par ailleurs, les étudier de près permet de comprendre qu’une expédition n’est pas une entreprise individuelle, géniale et visionnaire, mais qu’elle mobilise des moyens conséquents, de grandes quantités d’hommes, de savoirs et de savoir-faire, de ressources matérielles. Il faut savoir fabriquer un certain type de bateau, pouvoir recruter des marins et des artisans spécialisés, trouver des liquidités et dégager un surplus de capital ou contracter un prêt « à la grosse aventure » pour gréer et avitailler les nefs, rémunérer les équipages, acheter un stock de marchandises de troc, etc. Il faut beaucoup de temps, des années et en vérité des décennies, pour accumuler autant de compétences, de capital, d’expérience, pour rendre possibles ces expéditions qui s’avèreront être de grandes déconvenues.
Pourquoi le XIXe siècle a-t-il inventé ces success stories ?
Romain Bertrand : Les grandes catégories à partir desquelles nous pensons notre passé et qui guident notre interprétation intuitive de l’histoire européenne — les Grandes découvertes, la Renaissance, la Modernité — datent du XIXe siècle. Cette façon de penser l’histoire européenne comme orientée par une flèche du temps est aussi son invention. Et les voyages d’exploration et de conquête du XVe et du XVIe siècle sont la seule manière de faire fonctionner cette flèche, d’articuler chronologiquement, à travers la notion de Grandes découvertes, la Renaissance et l’entrée en « modernité ».
On a fait des voyages de « découverte » le symptôme d’un moment-charnière où l’Europe manifeste un besoin de curiosité, de connaissance désintéressée des mondes lointains. Pour cela, il faut donner une dimension extraordinaire à ces voyages, alors que la réalité est tout autre. Il ne s’agit pas de découvrir les humanités du bout du monde, mais de satisfaire des intérêts commerciaux et politiques. Si Jean Ango envoie deux nefs et plus d’une centaine d’hommes à Sumatra, c’est pour aller chercher du poivre noir, de la noix muscade et, surtout, de l’or, puisqu’à l’époque il existe un déficit de métaux précieux sur le marché européen. On pense qu’à Sumatra se trouvent des mines qui produisent un or d’une très grande pureté.  Et puis, l’expédition des frères Parmentier est montée par des représentants d’une bourgeoisie provinciale en pleine ascension, sociale aussi bien qu’économique, ce qui est aussi le cas de l’expédition de Magellan, entre 1519 et 1522, comme je l’avais rappelé dans un autre petit livre (Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire Magellan, Verdier, 2019).
Et puis, l’expédition des frères Parmentier est montée par des représentants d’une bourgeoisie provinciale en pleine ascension, sociale aussi bien qu’économique, ce qui est aussi le cas de l’expédition de Magellan, entre 1519 et 1522, comme je l’avais rappelé dans un autre petit livre (Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire Magellan, Verdier, 2019).
Au XIXe siècle, la légende a transformé ces opérations politico-commerciales en témoignages d’une espèce de prédisposition exclusivement européenne à un intérêt humaniste pour les mondes lointains, en occultant d’autres exemples – japonais, chinois ou ottoman – d’une semblable curiosité.
En quoi cela remet-il en cause la notion de modernité ?
Romain Bertrand : Parce que l’on se rend compte que ce qui fait que de simples marins européens sont capables de comprendre des habitants de ces îles lointaines, c’est un rapport sensible au monde qu’ils partagent avec eux, ce qui déjoue la notion officielle de modernité inventée par le XIXe siècle. On pense la modernité à l’aune des écrits des savants, des lettrés, on la voit comme l’émergence d’une pensée rationaliste qui s’arrache à des modes d’entendement plus primitifs ou intuitifs. Il y aurait un moment de césure entre un avant, fait de mythes et de magies, et un après placé sous le signe de la Raison, et cette bascule est toujours plus ou moins assignée ou imputée au XVIe siècle.
Mais lorsqu’on va y voir de près, on se rend compte que ces voyages n’ont rien à voir avec l’esprit rationaliste du XVIIe siècle tel qu’on le définit souvent de façon paresseuse. Dès lors, doit-on maintenir inchangée cette notion totalisante de modernité ? Quand on lit la poésie de Jean Parmentier et qu’on entrevoit les savoirs sensibles des gens de mer, quand on prend en compte la manière dont ils raisonnent tout autant par causalités que par analogies, on ne s’y reconnaît pas complètement.
La poésie de Jean Parmentier, totalement déroutante, n’entre dans aucune des cases que nous avons à notre disposition pour la domestiquer : est-elle médiévale ? moderne ? contemporaine ? anachronique ? Offrir aux lecteurs la possibilité de l’entendre permet de se rendre compte qu’elle n’a rien à voir avec le XVIe siècle qu’on nous a enseigné à l’école. Il y a Ronsard et Du Bellay, certes, mais avant eux il y a tout ce que l’école ne nous a pas appris : les Grands rhétoriqueurs, les compositions foutraques de Jean Molinet, les formidables Épîtres de l’amant vert de Lemaire de Belges, les cabrioles langagières de Clément Marot, les sotties de Pierre Gringore – quelque chose comme l’OULIPO en 1500 !
D’une façon générale, la modernité, tout du moins dans sa définition conventionnelle, est une idée vieillotte et qui nous coûte très cher. Sa notion telle qu’elle a été pensée et représentée à la fin du XIXe siècle par des gens qui trouvaient absolument magnifiques la fumée des trains arrivant en gare, le métal qui envahissait les villes, etc. est totalement dépassée. Alors que nous sommes en situation de cataclysme environnemental, alors que nous touchons au point limite avant l’extinction de l’espèce, l’éloge immodéré de la course à la maîtrise et à la prédation techniques du monde n’est plus de mise. On ne peut plus embrasser cette notion avec le même enthousiasme qu’il y a ne serait-ce que trente ans. Même chose pour les Grandes découvertes. Celles que le XIXe siècle nous a léguées sont des histoires dont les héros sont invariablement des hommes blancs et chrétiens, partis à la découverte d’un monde d’entrée de jeu jugé barbare ou primitif, affrontés à une humanité inachevée.
Ces légendes nous masqueraient les enjeux fondamentaux auxquels nous faisons face aujourd’hui…
Oui. Qui peut encore croire à ce conte dans une société comme la nôtre, c’est-à-dire profondément, irrémédiablement métissée ? Ne faut-il pas plutôt avoir une histoire qui laisse de la place à d’autres personnages dans une société qui a besoin d’inclure dans son récit national des jeunes issus d’horizons postcoloniaux très différents ? On ne peut plus, dans une classe de collège, raconter l’histoire du voyage de Magellan comme on le faisait il y a trente ans : beaucoup des élèves ne se reconnaîtront pas dans ce héros. Mais lorsqu’on leur dit qu’il y avait aussi à bord des nefs de Magellan un esclave africain, Juan Negro, des morisques (musulmans espagnols convertis de force au catholicisme au XVIe siècle), un jeune métis hispano-indien, etc., cela oblige à penser des siècles d’histoire musulmane de l’Espagne et de l’Europe, toute l’histoire fascinante et tragique des premiers contacts avec l’Afrique atlantique, des mobilités surprenantes à l’époque moderne, etc. L’Afrique, l’islam font partie de l’histoire, de notre histoire. Lorsqu’on ouvre plus grand les portes du récit, en ne s’intéressant pas seulement au personnage central, mais aussi aux plus petits personnages qui évoluent à ses côtés, on peut proposer une narration en phase avec nos questionnements contemporains. Et cette narration n’est pas une abrasion, une opération perverse de je ne sais quelle cancel culture. Non seulement elle n’efface rien, mais elle ajoute à ce que nous connaissons. C’est une histoire augmentée : il y a plus de données, plus de personnages, plus de scènes d’action, plus de temporalités.

Pêcheurs au lamparo de l’Empire byzantin, du Codex Skylitzès Matritensis, 13th century, Bibliothèque nationale de Madrid
Tout cela va bien au-delà du rapport à l’histoire coloniale, il s’agit du rapport à notre propre histoire, de notre croyance aveugle dans le caractère infini des ressources naturelles, dans le progrès scientifique, dans la résolution purement technologique de tous les problèmes. Jean Ango gagne beaucoup d’argent avec la pêche au hareng, laquelle, nous a-t-on longtemps dit, était la manne de l’Europe du Nord, une richesse qui a permis que de puissantes, belles et complexes cités émergent de la mer Baltique jusqu’aux côtes atlantiques françaises. Or, on sait aujourd’hui qu’il s’agissait de surpêche dès le XVIe siècle, que l’on était déjà engagé dans la course à la dépopulation des mers. Nous ne pouvons plus considérer cette époque seulement comme l’âge d’or de l’exercice de notre puissance sur le monde. Il nous faut aussi apprendre à le regarder comme le moment où le drame a débuté.
Le XVIe siècle, l’expansion du monde et la quête des ressources, les premiers moments du capitalisme, seraient les premiers pas vers notre système, ravageur de nature ?
Romain Bertrand : Il a fallu beaucoup de choses pour rendre possible le déchaînement prédateur de l’expansion européenne au XVIe siècle. Il a fallu des siècles de pensée et d’arrière-pensées pour préparer l’entrée en scène de la pensée dite « capitaliste », pour rendre possible le surgissement d’un rapport instrumental de l’homme à un monde qui ne serait que ressources quantifiables, monnayables, extractibles. D’une certaine manière, les racines du problème ne se trouvent pas au XVIe siècle, qui n’est que le moment où tout ce qui se préparait à bas bruit depuis des siècles trouve à s’exprimer de façon extrêmement bruyante et dévastatrice. Car c’est quand même le siècle de la conquête dévastatrice des Amériques, de la naissance des circuits de la traite esclavagiste atlantique, des premières implantations sanguinaires des Européens sur les côtes africaines, brésiliennes, indiennes, etc.
Si le XVIe siècle est assurément coupable, il n’est pas totalement responsable. Les siècles qui le précèdent ont leur part dans le drame. Et il y a déjà, au XVIe siècle, des opposants à cette dévastation. Tout le monde connaît Bartolomé de las Casas, le grand défenseur des Indiens. Il n’était pas seul, d’autres personnes, à l’époque même de la conquête, ont exprimé des doutes, des critiques, des condamnations.

Bartolomé de Las Casas (1484-1566). Domaine public
L’Europe du XVIe siècle n’est probablement pas plus violente que les sociétés des siècles précédents, mais elle a certainement davantage mauvaise conscience. Il n’est pas vrai que nous ne savions pas. Le fait que les Indiens n’aient pas d’âme n’était pas une opinion partagée par tous. Ce n’est pas vrai, et c’est d’autant plus terrible. Beaucoup de religieux, comme Martin de Rada aux Philippines, se sont levés et ont littéralement hurlé à la face du roi d’Espagne et des conquistadors : « Ce que nous faisons n’est pas admissible, nous marchons sur le chemin de la damnation ». La conquête a secrété, au moment même où elle s’exerçait sur le mode de l’extrême violence, sa propre critique. C’est ce que j’essaie de montrer, à partir du cas philippin, dans Le Long remords de la Conquête (2015).
Cela ne mène-t-il pas à juger le passé avec les critères du présent ?
Romain Bertrand : Le problème, c’est que l’on ne sait pas très bien quels sont les critères de jugement dominants d’aujourd’hui, non plus que ceux du passé. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a jamais de consensus moral parfait… C’est ce que je vous disais pour le XVIe siècle. Quels sont les critères moraux d’alors ? Certains jugeaient parfaitement légitime la violence infligée aux Indiens, mais d’autres la considéraient comme totalement illégitime. De nos jours aussi, les valeurs ne sont pas totalement partagées, comme le prouve la question de l’accueil des migrants. La France ne peut pas se définir de façon unanime par un esprit de progressisme et d’ouverture. Une société ou une époque parlent toujours aussi contre elles-mêmes. De ce point de vue, la question de l’anachronisme du jugement est absurde.
Il faut prendre acte de la polyphonie morale d’un monde et d’une époque. Enregistrer toutes les voix, ne pas s’arrêter à celles qui portent le plus, les plus intimidantes, mais écouter aussi les voix plus faibles, qui disent, qui murmurent autre chose. Au XVIe siècle, certains hurlent en faveur de la conquête du monde, de la destruction des Indiens, de la réduction en servitude et en esclavage des Africains. Ce sont ces voix, celles des conquistadors, des princes, des grands financiers de l’expansion, que l’on entend. Elles portent loin parce qu’elles dominent les documentations écrites. Mais il existe également de petites voix qui s’opposent, qui disent : « Non, nous ne pouvons pas faire cela. Cela, ce n’est pas nous. » Le rôle de l’historien est d’être à l’écoute de toutes les voix.
Pour conclure, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez aujourd’hui ?
Romain Bertrand : Je reprends le projet que j’ai dû suspendre au moment de la pandémie. L’histoire se déroule sur la côte nord-est de Bornéo, à la fin du XIXe siècle. Ce sera aussi une petite histoire, celle d’un officier colonial britannique qui va devoir, seul, au beau milieu d’une jungle et d’un monde particulièrement hostiles et complexes, bâtir à partir de rien quelque chose comme une souveraineté coloniale. Une histoire à la Conrad, mais une histoire vraie.
Propos recueillis par Josefina Gubbins, 10 juillet 2024, et publiés sur le site du CERI



