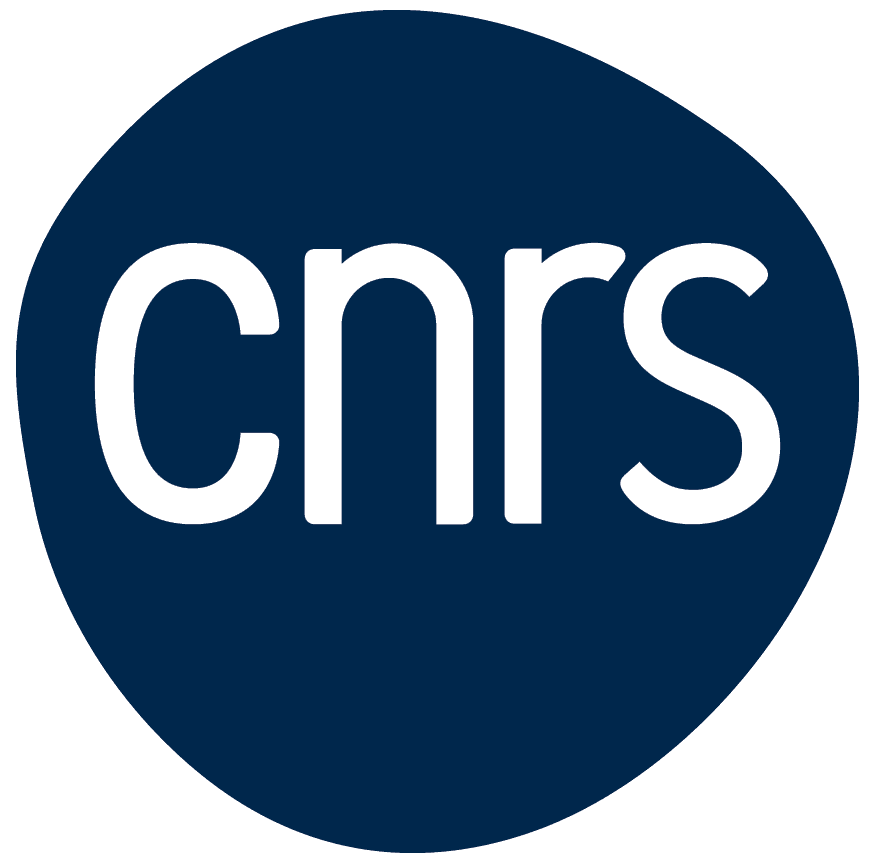Accueil>Tom Chevalier : Les politiques sociales face aux jeunes et au changement climatique en Europe
17.10.2025
Tom Chevalier : Les politiques sociales face aux jeunes et au changement climatique en Europe
Le mois dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir Tom Chevalier, chargé de recherche CNRS en science politique, qui rejoint le Centre d'études européennes et de politique comparée (CEE) après y avoir soutenu sa thèse il y a 10 ans. Les recherches de Tom portent sur les politiques publiques en direction des jeunes en Europe, qu’il s’agisse des politiques sociales, éducatives ou de l’emploi, ainsi que sur les questions de pauvreté et de rapport au politique des jeunes. Il étudie par ailleurs les transformations de l’État-providence dues aux transitions environnementales.
Dans cette vidéo, il nous parle de son parcours, de ses projets de recherche récents et actuels, et des raisons qui l'ont amené à revenir au CEE et à Sciences Po, 6 ans après son recrutement par le CNRS.
Je m'appelle Tom Chevalier, je suis chargé de recherche au CNRS, désormais ici au Centre d'études européennes et de politique comparée (CEE) de Sciences Po.
J'ai soutenu ma thèse il y a 10 ans, en 2015, ici au CEE à Sciences Po. J'ai poursuivi avec des post-docs à l'étranger, à Harvard, à Oxford, et j'ai ensuite été recruté au CNRS en 2019, au laboratoire Arènes, en Bretagne, où j’ai été en poste pendant 6 ans. Et je viens donc de changer de laboratoire.
Mes recherches portent sur les politiques publiques, les politiques sociales, et surtout les enjeux de jeunesse.
Je fais de la comparaison, c’est-à-dire que je regarde ce qui se passe en matière d'action publique entre les différents pays européens. J'ai plus spécifiquement étudié toutes les politiques publiques destinées à promouvoir l'autonomie des jeunes en Europe.
La façon dont les jeunes accèdent aux droits sociaux dépend de l'image que l'on a de ces jeunes. Si les jeunes sont vus comme des enfants, on va familialiser l'accès aux droits sociaux, c’est-à-dire que l’on va plutôt aider les parents à s'occuper de leurs enfants. Par exemple, il va y avoir des limites d'âge plus élevées pour l’accès au revenu minimum, comme en France, où on n’accède au RSA qu’à partir de 25 ans. Dans d'autres pays au contraire, les jeunes, à partir de 18 ans le plus souvent, sont considérés comme des adultes comme les autres et peuvent accéder en leur nom propre aux prestations sociales. C'est par exemple le cas des pays nordiques.
Plus récemment, j'ai commencé à travailler sur les effets de l'action publique sur les jeunes, notamment en matière de pauvreté des jeunes d’une part, et de rapport au politique des jeunes d’autre part. J’ai pu montrer que plus on reconnaît le statut d'adulte des jeunes, en individualisant leur accès aux droits sociaux, en défamilialisant les prestations, moins il y a de pauvreté des jeunes et plus il y a de confiance des jeunes dans l'État, dans le politique.
Afin de diffuser ces résultats de recherche auprès des pouvoirs publics, j'ai aussi des missions d'expertise. Je suis notamment membre du comité scientifique du CNLE, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et je suis aussi responsable pour la France auprès de la Commission européenne de la production de rapports annuels sur l'état de la protection sociale dans le cadre d'un réseau nommé ESPAN.
Plusieurs raisons font que cela a du sens pour moi de revenir au CEE et à Sciences Po.
D’un côté, travaillant sur les politiques publiques et leurs effets en matière de pauvreté ou de rapports au politique, cela me permet d'être plus proche du LIEPP, le Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, au sein duquel j'ai déjà développé plusieurs projets.
Et de l'autre côté, j'ai pu développer ces dernières années avec plusieurs collègues du LIEPP, du CEE, du CSO, ici à Sciences Po (Anne-Laure Beaussier, Matteo Mandelli, Bruno Palier), des projets de recherche sur l'environnement, plus précisément sur les transitions environnementales et les transformations de l'État-providence.
Dans ce cadre, nous nous posons plusieurs types de questions. La première concerne les risques sociaux attachés aux transitions environnementales et l’identification des personnes touchées plus spécifiquement par ces risques sociaux. Dans ce travail, on distingue les risques directs, directement liés au changement climatique – par exemple tout ce qui a trait aux canicules, aux inondations, etc. De l'autre côté, on a les risques indirects, c'est-à-dire les effets sociaux, qui peuvent être régressifs, des politiques environnementales. Par exemple, lorsque vous mettez en place une taxe carbone qui touche disproportionnellement les plus bas revenus. C'est un autre type de risque que l'on a identifié. Et la question qu'on se pose est : qui est touché par ces risques ?
Nous avons un autre champ de recherche qui concerne plutôt les politiques de protection des populations face aux catastrophes naturelles. Et là, les questions sont : est-ce que cela reflète les régimes d'État-providence ? Quels types de politiques publiques sont à prendre en compte ? Il y a une focalisation de la littérature sur les politiques de réparation, de compensation, les politiques d'assurance notamment. Vous perdez votre maison : quels sont les types d'assurance qui permettent de vous rembourser ? Mais en fait, il faut prendre en compte l'interaction de ces politiques publiques avec les politiques de prévention (par exemple, la construction d’une digue qui protège votre maison d'une inondation) et les politiques de gestion d'urgence : au moment même de l’inondation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'État fait pour vous accompagner ?
Interview et vidéo : Véronique Etienne. Photo de couverture : Sébastien Wony.