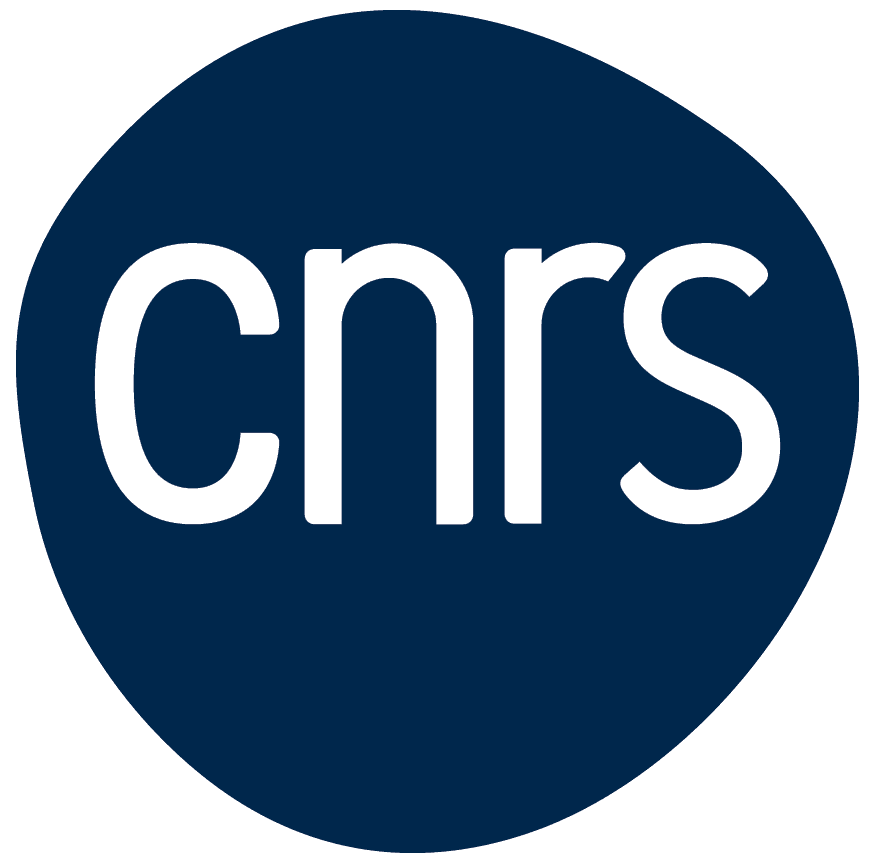Accueil>"Toutes les politiques ont une dimension symbolique". Entretien avec Laurie Boussaguet et Florence Faucher
17.07.2025
"Toutes les politiques ont une dimension symbolique". Entretien avec Laurie Boussaguet et Florence Faucher
Les symboles sont omniprésents en politique. Pourtant, ils ont souvent été négligés dans l'étude des politiques publiques. Quel est le rôle des symboles dans la fabrique des politiques publiques ? Pourquoi est-il important de les prendre en compte ? Et comment les étudier ? Réponses en vidéo avec Laurie Boussaguet et Florence Faucher, qui ont récemment publié un ouvrage intitulé Symbolic Policy (Cambridge University Press, 2025).
Vidéo : Véronique Etienne, chargée de médiation scientifique au CEE.
Crédits images supplémentaires : Shonagon/Wikimedia Commons, Paolo Bona/Shutterstock, BreizhAtao/Shutterstock, Spech/Shutterstock, Joshua Sukoff/Shutterstock, Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock
Laurie Boussaguet : Les symboles peuvent être de toutes sortes : un mot, un objet, un bâtiment, une chanson, une métaphore, etc. Le symbolique est un moyen de communiquer très facilement et directement avec les citoyens.
Florence Faucher : Ceci parce que les symboles sont associés à diverses significations, à une culture dont les citoyens et leurs élites font partie. Et c'est le contexte qui va déterminer le sens approprié aux circonstances.
Même quelque chose d'aussi simple qu'un morceau de tissu tricolore, si nous parlons du drapeau français, est associé à une diversité de dimensions cognitives et émotionnelles. Et selon le contexte, il a des significations différentes. Le drapeau tricolore peut être perçu comme représentant la France., il peut représenter la Révolution française, l'État. S'il recouvre les cercueils des soldats, il symbolise la nation qui rend hommage à ceux qui l'ont défendue. Mais il peut aussi être utilisé dans un tout autre contexte, par exemple lors de compétitions sportives. Et là, les émotions qui y sont attachées seront très différentes : la plupart des gens ne penseront pas à l'armée et à la guerre, mais à l'excitation de voir la France battre l'Angleterre lors d'un match de rugby.
Lorsque nous parlons de politique symbolique, cela ne signifie pas que certaines politiques sont symboliques et d'autres non. En fait, le terme s'applique à toutes les politiques, parce qu'elles ont toutes une dimension symbolique.
L.B. : Parfois, les décideurs utilisent le symbolique à dessein, dans un but spécifique.
Lorsque nous avons étudié l'utilisation du symbolique dans la gestion de crise, cette dimension était essentielle car elle permettait de remplir des missions importantes, comme légitimer les décideurs et leurs décisions, mais aussi rassurer la population et créer ou maintenir l'unité.
Par exemple, nous avons étudié les réponses du gouvernement français aux attaques terroristes à Paris. L'une des réponses a consisté à renforcer la présence de l'armée dans les rues. Il s'agissait bien sûr d'une politique sécuritaire. Mais en même temps, elle transmettait un message très important à la population : vous pouvez être rassurés parce que l'État est présent, l'État sait ce qu'il faut faire. L'armée est devenue le symbole de l'État présent dans la rue pour rassurer la population. C'était un message symbolique important.
F.F. : A l'époque du Covid, les métaphores et les exemples qui ont été utilisés par le Président Macron étaient clairement destinés à évoquer auprès des Français des moments de solidarité, la guerre, le fait de tenir bon ensemble.
C'est aussi l'un des rares exemples où l'on peut mesurer les effets d'une politique symbolique. Par chance, nos collègues du CEVIPOF disposaient d'une enquête par panel dont l'un des questionnaires a été administré le jour où Macron a prononcé son deuxième discours. En comparant les réponses des personnes interrogées avant et après, on constate que leurs intentions de se tenir plus à l'écart des autres, de se laver les mains, leur appréhension de la gravité de la situation, ont clairement changé.
Le symbolique est toujours présent dans les politiques mais, dans certains cas, les décideurs ont négligé de réfléchir au sens qui serait décodé par la population. Lorsque Macron a décidé d'introduire une taxe carbone, un certain nombre de personnes ont réagi parce qu'elles se sentaient ciblées en tant que personnes possédant une voiture, dépendantes de leur voiture, alors que la décision avait été prise par des élites parisiennes qui n'ont pas de voiture, qui peuvent utiliser les transports publics, etc. [Les premiers] se sont donc sentis directement visés et victimes d'une politique, ce qui n'était pas l'intention des décideurs.
L.B. : Cette dimension symbolique est vraiment cruciale, bien que souvent négligée par l'analyse politique, parce que c'est un dialogue entre les décideurs et les représentations des citoyens. Si nous passons à côté de cette conception du symbolique, nous ne pouvons pas comprendre certaines réactions du public à une politique particulière.
Pour étudier cette dimension symbolique, nous devons tout d'abord avoir une conception plus large de ce qu'est une politique publique. Il ne s'agit pas uniquement d'un texte juridique et de discours officiels, les éléments habituellement analysés dans l'étude des politiques publiques. Il faut aussi inclure toute la mise en scène, les performances des décideurs. En termes de collecte de données, cela signifie étudier les agendas des décideurs, la mise en scène des discours, les visites sur le terrain même si aucun mot n'est prononcé, tous les gestes, le langage corporel... Tous ces éléments véhiculent des messages aux citoyens.
Par exemple, pendant la pandémie, le Premier ministre [italien] Conte a prononcé ses discours dans la cour du Palazzo Chigi [à Rome] en portant un masque. Ce n'était pas nécessaire du point de vue strictement sanitaire, parce qu'il était seul, à l'extérieur, loin des journalistes. Le port du masque n'était donc pas indispensable mais il était néanmoins important parce qu'il permettait d'étayer le contenu de ses discours sur la nécessité de porter le masque.
Deuxièmement, si l'on veut comprendre le travail symbolique des décideurs, il faut essayer de saisir leurs intentions. Pour cela, l'idéal serait de pouvoir s'entretenir avec eux et avec leur entourage, afin de comprendre leur conception de l'utilisation du symbolique et les messages qu'ils veulent faire passer.
F.F. : Nous avons commencé cette recherche en étudiant la manière dont le gouvernement français a réagi aux attentats terroristes de 2015 et nous avons pu interviewer le premier ministre de l'époque, le ministre de la justice, différents collaborateurs. Ces entretiens nous ont permis de comprendre comment ils avaient l'intention d'utiliser le symbolique. Certaines utilisations du symbolique étaient routinières, comme lors des cérémonies d'hommage au personnel policier victime des terroristes. Mais certaines ont dû être inventées et adaptées à la situation, à l'image de la grande marche républicaine.
L.B. : S'il n'est pas possible de mener des entretiens, il faut recouper les données afin de pouvoir remonter à ces intentions d'une autre manière. Par exemple, si nous voulons étudier une récente politique de Trump, il est évident que nous ne pourrons pas le rencontrer pour un entretien. Mais l'on peut utiliser tous les discours qu'il a prononcés, on peut analyser son premier mandat, sa campagne électorale, toutes ses déclarations dans la presse, ses visites, ses gestes, son langage corporel, pour comprendre quelles sont ses intentions. Tous ces éléments doivent être étudiés pour réellement prendre en compte la dimension symbolique.
À propos de l'ouvrage
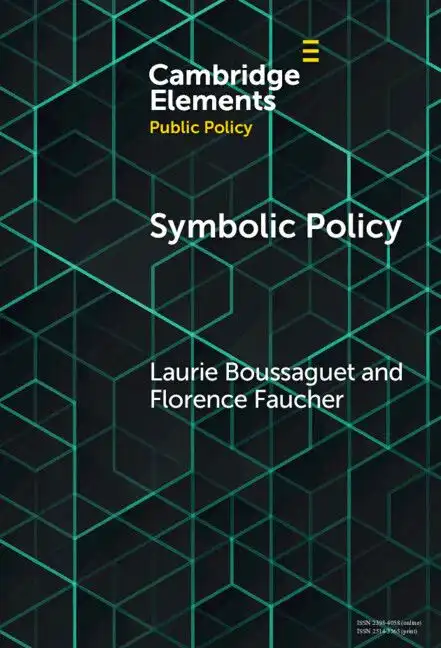
Symbolic Policy, de Laurie Boussaguet et Florence Faucher, Cambridge University Press (collection Cambridge Elements - Public Policy).
Publié en ligne le 30 novembre 2024. Disponible au format imprimé en janvier 2025.
DOI: 10.1017/9781009290975
Dans cet ouvrage, Laurie Boussaguet et Florence Faucher montrent comment les symboles façonnent les représentations des citoyens grâce à leur capacité à combiner des significations et à susciter des réactions émotionnelles. En utilisant la gestion de crise comme prisme analytique, elles se concentrent sur deux études de cas : les réponses gouvernementales à la crise du Covid-19 en Europe en 2020 et aux attentats terroristes en France en 2015. Elles montrent comment le symbolique permet aux dirigeants d'assoir leur légitimité et celle de leurs décisions, tout en favorisant des sentiments de sécurité, de solidarité et d'appartenance parmi la population. Tous les politiciens utilisent le symbolique, consciemment ou non, mais leurs choix varient et sont influencés par les circonstances, par l'existence de répertoires nationaux d'actions symboliques et par leur propre personnalité.
À propos des autrices

Florence Faucher est professeure de science politique à Sciences Po et directrice du Centre d'études européennes et de politique comparée. Elle est Associate Fellow au Nuffield College et au Département de politique et de relations internationales de l'Université d'Oxford. Ses recherches se sont développées selon plusieurs directions, reliées par un intérêt pour la compréhension des transformations des modes d'exercice de la politique dans l'Europe contemporaine. Elle a beaucoup travaillé sur les partis politiques en France et au Royaume-Uni (partis verts, de centre-droit et de centre-gauche). Elle soutient qu'une « imagination anthropologique » peut renouveler et stimuler les analyses des institutions et des pratiques politiques contemporaines.

Laurie Boussaguet est professeure de science politique à l'université de Rouen (actuellement en disponibilité) et professeure à temps partiel au Robert Schuman Centre for Advanced Studies de l'Institut universitaire européen (EUI) à Florence. Ses recherches portent sur la mise à l'agenda, la politique comparée, la gouvernance européenne, la participation citoyenne et le genre. Dans toutes ses recherches, elle aborde systématiquement le lien entre la politique et les politiques, en explorant la dynamique entre les personnes au pouvoir et les citoyens qu'ils servent.
Pour aller plus loin
Florence Faucher on Symbolic Policy (interview)