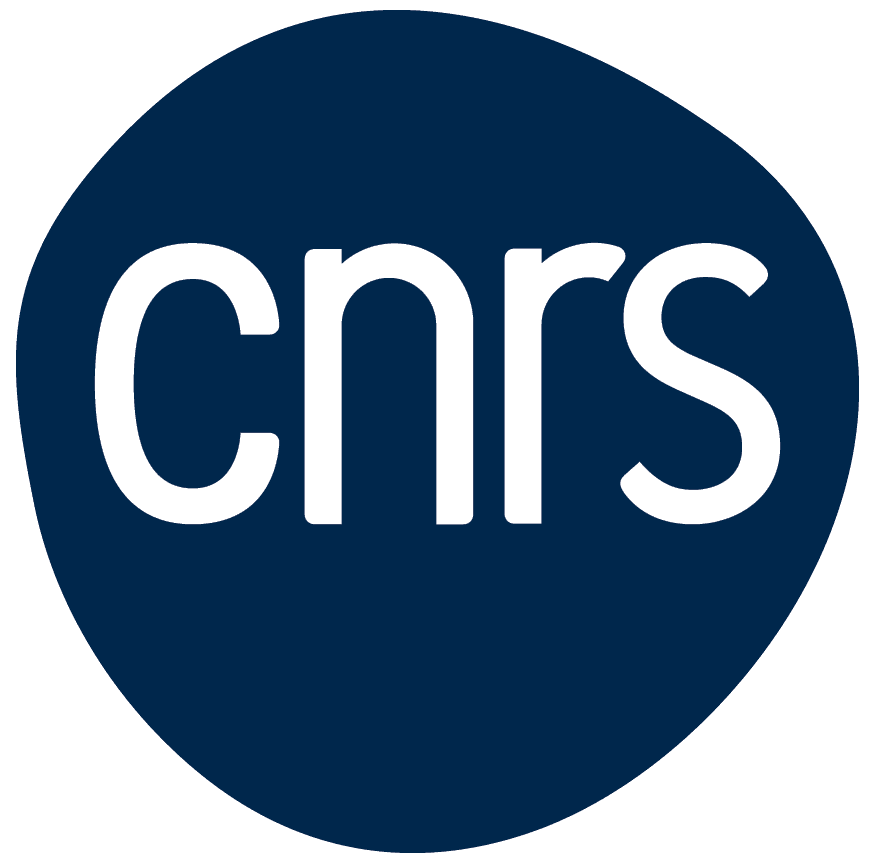Accueil>La protection sociale par la dépense fiscale : “perçu comme neutre ou technique, le crédit d’impôt traduit en réalité des choix politiques profonds”

11.09.2025
La protection sociale par la dépense fiscale : “perçu comme neutre ou technique, le crédit d’impôt traduit en réalité des choix politiques profonds”
En France, une grande diversité de services à la personne (garde d’enfants, accompagnement de personnes dépendantes, ménage, jardinage, aide aux devoirs…) donnent lieu à un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées (dans la limite de 12 000 € par an et par foyer, hors cas de dépendance). Un dispositif que notre pays partage entre autres avec la Suède, et dont les effets avaient jusqu’à présent peu été étudiés par les universitaires spécialistes de l’État-providence. Dans l’ouvrage The Politics of Fiscal Welfare. Towards a Social Division of Welfare and Labour (Policy Press, 2025), Nathalie Morel retrace les raisons qui ont mené à l’adoption de cet instrument dans les deux pays, et décrit les conséquences de cette politique. Entretien avec l’autrice, Associate Professor au Centre d’études européennes et de politique comparée (CEE), et co-directrice de l’axe “Politiques socio-fiscales” du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP).
Dans cet ouvrage, vous vous intéressez au concept de “fiscal welfare” : de quoi s'agit-il, pourquoi est-ce important, et pourquoi avoir choisi la France et la Suède comme cas d’étude ?
Le concept de fiscal welfare désigne l’usage d’instruments fiscaux — comme les réductions ou crédits d’impôt — à des fins de protection sociale. Il s’agit donc de transferts sociaux opérés non pas par des prestations directes (telles que des allocations), mais via des dépenses fiscales, souvent de manière peu visible. Ce type d’intervention est très courant dans les États-providence lib�éraux (comme les États-Unis ou le Royaume-Uni), mais il a largement essaimé dans d’autres contextes. Pourtant, il reste peu analysé, que ce soit en tant qu’instrument de politique publique ou en termes de conséquences sur la protection sociale.
Ce que je montre dans cet ouvrage, c’est que cet instrument a des effets puissants en termes de redistribution des richesses, de structuration de l’offre de protection sociale, mais aussi de structuration du marché du travail, tout en échappant souvent à l’analyse critique parce que l’instrument fiscal est perçu comme neutre ou technique. En réalité, l’usage de cet instrument traduit des choix politiques profonds : sur qui mérite d’être soutenu, sous quelles conditions, et par quels moyens.
J’ai choisi de comparer la France et la Suède parce que ces deux pays incarnent deux modèles de protection sociale très différents selon les typologies établies dans la littérature (1) — conservateur (basé sur un système assurantiel et des principes familialistes) en France, et social-démocrate (modèle universaliste et “dé-familialisant” dans lequel l’État joue un rôle central) en Suède, dans lesquels le recours aux dépenses fiscales est en augmentation, depuis le début des années 1990 en France et depuis 2007 en Suède. Cette comparaison permet non seulement d'aborder la question de ce qui arrive à ces deux types d'États-providence lorsqu'un instrument issu du répertoire de politique publique des États-providence libéraux est introduit, mais aussi de mettre en évidence les propriétés spécifiques de cet instrument. En effet, mon analyse fait ressortir des mécanismes et des résultats similaires dans ces deux États-providence par ailleurs très contrastés, soulignant ainsi les propriétés spécifiques de l'instrument et ses effets en termes de policy feedback.
Quand et avec quels objectifs ces mesures de soutien aux services à la personne ont-elles été introduites en France et en Suède ?
En France, le crédit d’impôt (initialement introduit sous forme de réduction d’impôt) pour les services à la personne a été introduit en 1991 via la « loi Aubry » (2). Cette initiative s’inscrivait dans un triple objectif : lutter contre un chômage élevé, réduire le travail non déclaré, et répondre aux besoins croissants de garde d’enfants et d’aide aux personnes âgées. Le dispositif a été étendu à plusieurs reprises en relevant le plafond de dépenses éligibles (qui se situe aujourd’hui à 12 000 €, majoré de 1 500€ par enfant à charge et/ou par personne de plus de 65 ans dans le foyer), et en élargissant le type de services couverts par le dispositif.
En Suède, bien que les débats aient commencé dans les années 1990, le dispositif fiscal équivalent — la réduction RUT—, avec un plafond de dépenses similaire à la France, n’a été mis en place qu’en 2007. Les objectifs poursuivis étaient similaires à ceux assignés en France : créer de l’emploi, lutter contre le travail au noir, répondre à la demande croissante de services pour les personnes âgées, mais aussi améliorer l’équilibre travail-vie privée des familles, et promouvoir l’égalité de genre en allégeant la charge domestique, souvent portée par les femmes.
Quelles motivations politiques ont guidé la mise en place de ces dispositifs, et quelles controverses ont-ils suscité ?
En France, l’adoption de la réduction d’impôt repose à l’origine sur un consensus politique. La droite comme la gauche y ont vu un outil pour stimuler l’emploi et répondre à des besoins croissants en matière de garde d’enfants et d’aide à domicile. À partir de la fin des années 1990, c’est la droite qui porte ce dispositif, avec pour objectifs à la fois de remettre en activité les personnes éloignées de l’emploi et de soutenir la demande de services des ménages, notamment les plus aisés. Les entreprises privées de services à la personne sont rapidement devenues un puissant lobby contribuant à l’expansion de cette politique. Malgré quelques critiques de la gauche, notamment à la fin des années 1990, cette politique n’a pas suscité beaucoup de débats.
En Suède, en revanche, l’introduction du crédit d’impôt en 2007 par un gouvernement de droite a été beaucoup plus clivante idéologiquement. Elle visait explicitement à créer un secteur privé dans un pays historiquement attaché à la fourniture publique et universelle des services sociaux. Comme en France, les arguments du libre choix pour les personnes âgées et l’activation des femmes peu qualifiées ont été mis en avant. Toutefois, cette réforme a été vivement contestée par la gauche, les syndicats et les milieux féministes. Ces opposants dénoncent la reproduction d’un modèle domestique hiérarchisé, où des femmes précaires (souvent migrantes) libèrent du temps pour d’autres femmes plus favorisées. Le dispositif est vu comme renforçant les inégalités sociales, genrées et raciales, en introduisant des logiques de domesticité au sein de l’État social. Ainsi, les dispositifs ont cristallisé des débats sur la place de l’État, l’universalité des services sociaux, et les nouvelles formes de segmentation sociale.
Quel a été l'impact sur la prise en charge de la dépendance, qui était l’un des objectifs poursuivis ?
L’introduction de ces dispositifs fiscaux a eu un impact profond sur la prise en charge de la dépendance, tant en France qu’en Suède. Si ces politiques prétendaient vouloir améliorer la réponse aux besoins croissants liés au vieillissement, leur effet réel a été plus ambigu et structurellement inégalitaire.
En France, en orientant le soutien public vers la demande de services plutôt que vers l’offre, le dispositif a contribué à la transformation du secteur : montée en puissance des prestataires privés lucratifs, marchandisation croissante des services, et fragmentation du pilotage public. Par ailleurs, les données montrent un usage très inégal du crédit d’impôt : en 2022, plus de 40 % de la dépense fiscale a profité aux 10 % les plus riches, et chez les plus de 80 ans, seules 15 % des personnes les moins riches (celles du 1er décile de revenu) y ont recours, contre 63 % dans le dernier décile. Le dispositif bénéficie donc prioritairement à ceux qui n’ont pas nécessairement les besoins les plus importants, mais qui ont les moyens d’acheter ces services. Parallèlement, la coexistence de ce crédit d’impôt avec l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), conditionnée par les ressources et le niveau de dépendance, a créé un système dual. Les plus modestes relèvent de l’APA, les plus aisés bénéficient du crédit d’impôt. Cette répartition engendre une courbe en U dans la distribution des aides, générant un phénomène de non-recours pour les personnes aux revenus intermédiaires. Ces deux dispositifs diffèrent aussi par l’évolution de leur coût, celui du crédit d’impôt, élevé, connaissant une croissance plus rapide (et incontrôlée) que celui de l’APA, tout en ne répondant que faiblement à des besoins relevant effectivement de la prise en charge de la dépendance. Ceci interroge donc sur l’efficacité de ce dispositif fiscal au regard de l’objectif affiché de répondre à un besoin social, ainsi que sur son coût d’opportunité (“que pourrait-on faire de mieux au même prix ?”).
En Suède, la rupture introduite par le dispositif fiscal a été encore plus marquante. Traditionnellement, l’aide à la dépendance faisait partie d’un modèle universel reposant sur les municipalités, avec des services publics fournis selon les besoins, sans condition de ressources. Le crédit d’impôt a introduit une logique de marché et de choix individuel. Cela a encouragé les ménages les plus aisés à s’orienter vers le secteur privé, ce qui peut à terme diminuer leur soutien envers le secteur public et à son financement solidaire. Il en résulte une forme de privatisation partielle de la dépendance, où les personnes âgées aisées externalisent plus facilement les tâches de soin à des acteurs privés, tandis que les moins favorisées restent tributaires de services publics parfois en tension, voire réduits en raison de coupes budgétaires.
Dans les deux cas, le soutien public par crédit d’impôt modifie les modalités d’accès et la gouvernance du soin : il favorise un système fondé sur la solvabilité plutôt que sur la solidarité. Enfin, il invisibilise les conditions de travail précaires des salariées de l’aide à domicile, en déplaçant le regard sur les besoins du consommateur plutôt que sur la qualité et la continuité du soin.
Et quel a été l’impact de cette mesure fiscale sur l’emploi ?
L’introduction du crédit d’impôt pour les services à la personne a eu un impact significatif mais contrasté sur le marché du travail, tant en France qu’en Suède. Ces dispositifs ont effectivement contribué à la création d’emplois, mais essentiellement dans un segment de travail peu qualifié, précaire et fortement genré.
En France, près de 1,4 million de personnes occupaient un emploi dans ce secteur en 2022, dont une majorité de femmes. Cependant, la majorité des emplois sont à temps partiel, faiblement rémunérés, sans perspectives de carrière. Beaucoup de travailleuses cumulent plusieurs employeurs ou interviennent dans des conditions de travail détériorées. Les dispositifs fiscaux n’ont pas permis d’améliorer structurellement la qualité de ces emplois ; ils ont plutôt institutionnalisé un segment "bas de gamme" du marché du travail, destiné à répondre aux besoins domestiques des classes supérieures.
En Suède, pays historiquement attaché à un modèle d’emploi public, qualifié et stable dans les services aux personnes âgées, la mise en place du crédit d’impôt a marqué une rupture, caractérisée par la création rapide d’un nouveau sous-secteur privé, souvent organisé en très petites entreprises ou auto-entrepreneurs. Le profil des employés de ce secteur est similaire à celui observé en France : des femmes, souvent issues de l’immigration, occupant des postes faiblement protégés, hors des conventions collectives publiques. Le modèle suédois a ainsi vu naître une stratification du marché du travail dans les services à la personne, entre un secteur public encadré et un secteur privé dérégulé.
Dans les deux pays, la mesure fiscale a donc favorisé l’essor d’emplois atypiques et peu rémunérateurs. Elle a aussi renforcé les inégalités sociales et genrées dans le travail, en promouvant des modèles d’"externalisation domestique" où des femmes précaires prennent en charge les tâches que d’autres, plus aisées, délèguent.
Les évaluations existantes de ces dispositifs sont essentiellement négatives. Dès lors, comment expliquer que ceux-ci ne soient pas remis en question ?
En effet, de nombreuses critiques ont été formulées de façon récurrente par la Cour des comptes dans les deux pays, mais aussi par des commissions parlementaires ou par d’autres institutions publiques d’évaluation des politiques publiques. Les différents rapports soulignent le coût élevé de ces dispositifs au regard de leurs résultats : faible efficacité en termes de créations d’emplois, dépense qui bénéficie essentiellement aux plus riches, inadéquation avec les besoins réels en matière de dépendance et fragmentation du financement et du pilotage public de la politique d’autonomie des personnes âgées. Pour autant, dans les deux pays, cette politique non seulement perdure mais a été plusieurs fois étendue. Cela tient essentiellement à la spécificité de cet instrument : d’une part, le coût pour les finances publiques est moins visible que celui des dépenses directes (telles que les allocations ou l’emploi public). D’autre part, cet avantage fiscal a contribué à structurer un marché priv�é de services soutenu par des acteurs économiques et confédérations patronales qui sont devenus des défenseurs actifs du dispositif, jouant un rôle de lobbying efficace auprès des pouvoirs publics.
Propos recueillis par Véronique Etienne, chargée de médiation scientifique au Centre d'études européennes et de politique comparée.