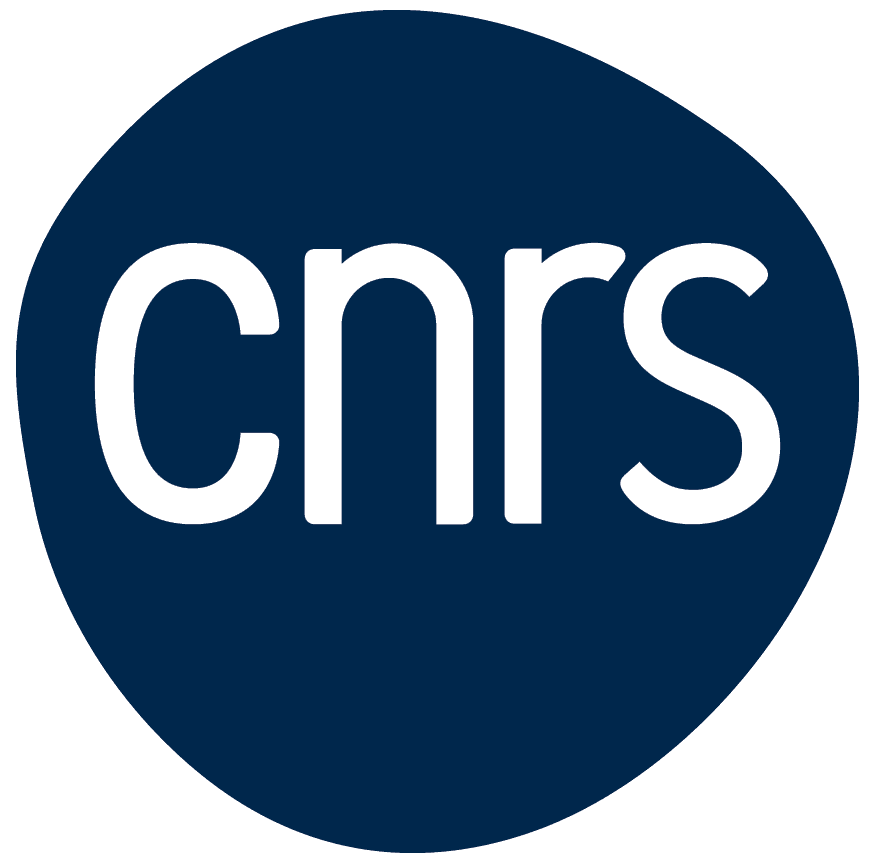Accueil>L'UE et les leçons de la crise grecque avec Marylou Hamm, postdoctorante CIVICA au CEE

25.11.2025
L'UE et les leçons de la crise grecque avec Marylou Hamm, postdoctorante CIVICA au CEE
Marylou Hamm, Max Weber Fellow à l’EUI, est accueillie au Centre d’études européennes et de politique comparée pour l’année académique 2025-2026 grâce au programme de bourses post-doctorales de l’alliance universitaire européenne CIVICA. Ses recherches portent sur la gestion de la crise grecque par l’Union européenne et sur l’héritage de cette gestion de crise. Elle nous a fait part de son parcours et de son projet actuel.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Je suis docteure en sciences politiques et sociales de l’Université libre de Bruxelles et de l’Université de Strasbourg. Ma thèse de doctorat en sociologie politique portait sur la gestion européenne de la crise grecque. Plus précisément, je me suis intéressée aux personnels envoyés en Grèce par la Commission pour des missions d’assistance technique, c’est-à-dire pour superviser la mise en place des réformes demandées à l’État grec en contrepartie des aides financières européennes (suivant un principe de « conditionnalité »). Il s’agissait essentiellement de fonctionnaires européens et d’experts nationaux détachés, qui parfois faisaient appel à d’autres acteurs — consultants, membres d’organisations internationales.
Ensuite, en tant que Max Weber Fellow à l’Institut universitaire européen (EUI), je me suis intéressée à la manière dont des dispositifs d’assistance technique ont été étendus à tous les États membres, au-delà de la Grèce, de Chypre et du Portugal. En cela, les crises des années 2010 ont constitué un moment de bascule. Dans ce projet post-doctoral, je me suis penchée sur la création d’un nouveau service au sein de la Commission européenne, aujourd’hui appelé SG REFORM.
Qu'est-ce qui a justifié l’extension de ces aides aux réformes à l'ensemble des États membres ?
Les professionnels de l’assistance technique, que j’ai étudiés dans ma thèse, ont su faire usage de la crise grecque comme d’un argument clé : à leurs yeux, la Grèce n'était pas un cas si particulier que cela. Pour eux, les « pathologies » observées dans ce cas précis se retrouvaient aussi ailleurs, en Italie, en France ou en Belgique. Ces positions tranchaient alors avec des discours moralisateurs et des caricatures essentialistes sur la culture grecque (“buveurs d’ouzo”) ou méditerranéenne (le farniente), très en vogue dans les discours politiques et médiatiques des années 2010.
L’observation de manquements « ordinaires » dans les réformes menées par les États membres s’est accompagnée d’un autre argument, portant cette fois sur les limites des procédures d’accession. Une fois un pays entré dans l’Union, l’accompagnement européen aux réformes prenait fin. Or, selon les réformateurs européens, l’entrée dans le club ne devrait pas signer cet arrêt. Dans cette perspective, le statut d’État membre n’apparaît plus comme un simple label qui, une fois obtenu, n’était plus questionné, mais comme un statut à re-conquérir régulièrement.
Au-delà des réseaux d’experts, certains États membres eux-mêmes soutenaient cette approche. Une alliance s’est ainsi formée entre des acteurs au sein de la Commission européenne et des représentants de plusieurs États membres, notamment en Europe de l’Est, comme la Roumanie ou la Croatie.
Ces débats ont aussi animé la Commission : comment l’institution a-t-elle tiré les leçons de la crise grecque ?
La crise grecque a révélé les limites d’une gestion de crise orchestrée au niveau européen : les interventions ont été vivement critiquées pour leur caractère vertical voire coercitif, souvent sans grand égard pour leur adaptation au contexte national car adoptant le « one-size-fits-all », parfois même sans souci de leur constitutionnalité. Dans sa gestion de la crise, l’Union européenne a été sévèrement critiquée pour avoir mis de côté certains de ses principes fondamentaux, comme l’égalité entre les États membres, la supériorité du politique sur l’administratif, mais aussi le respect de la charte des droits fondamentaux…
Ces jugements, d’abord portés par des acteurs critiques extérieurs — typiquement, des ONG — puis repris par des eurodéputés, ont été internalisés au sein même de la Commission, comme je l’ai découvert en étudiant la création du Service d’appui aux réformes structurelles, désormais connu sous le nom de SG REFORM. Les textes (notes, mémos…) ayant présidé à la création de ce service portent en eux ces débats. On les retrouve aussi dans certains grands principes qui régissent aujourd’hui l’assistance technique aux États membres : la contrainte semble avoir laissé place au sur-demande et à la co-construction avec l'État réformé.
En même temps, et on note ici un compromis typique de l’eurocratie, c’est une figure emblématique de la gestion de la crise qui été placée à la tête de ce service : l’ancien chef de mission « troika »(1) à Chypre. Et il a amené avec lui un certain nombre de ses collègues de la DG ECFIN, la direction générale de la Commission chargée des affaires économiques et financières, qui avait été au cœur de la gestion de crise. Alors même que ce nouveau service n'est pas formellement rattaché à la DG ECFIN, il perpétue néanmoins un lien étroit entre réformes structurelles et objectifs économiques.
Dans un article récemment publié (accompagné d’un post de blog), je retrace et explique les débats qui ont animé la Commission autour de deux logiques concurrentes avant d’aboutir à ce compromis.
Dans quelles directions poursuivez-vous ces recherches ?
Après avoir étudié les acteurs de la gestion de la crise grecque puis les changements qu’elle a provoqués à la Commission, je m’intéresse maintenant à la manière dont l’UE, à travers les dispositifs du SG REFORM, intervient dans les réformes des États membres. Et mon attention se porte tout particulièrement sur un domaine d’action publique : les réformes des administrations publiques centrales.
Dans l’UE, ce domaine très symbolique et lié aux histoires politiques des États est régi par le principe d'autonomie. Il n’est donc réputé ni possible ni souhaitable d'imposer un modèle unique, que ce soit en matière de coordination interministérielle, de gestion des carrières des fonctionnaires, de recrutement des hauts fonctionnaires, et ainsi de suite.
Cependant, ce secteur s’est européanisé depuis quelques années. Cela a été le cas en Grèce, de manière verticale. La conditionnalité était stricte, dans le sens où les réformes à accomplir en échange des aides financières étaient très détaillées et non négociables. Aujourd’hui, si l’assistance technique concerne l’ensemble des États membres, elle prend différentes formes, notamment plus souples : il peut s’agir de recommandations, d’échanges de « bonnes pratiques » dans le cadre de conditionnalités aux objectifs élargis et flexibles, négociées entre la Commission et les États. C’est ce que certains appellent la conditionnalité coordinative — notamment dans le cas des plans de relance post-Covid. Au-delà de leur forme, ces interventions ont en partage le développement de tout un monde d’expertise pour les accompagner, depuis la formulation des mesures d’action publique à mener, jusqu’à leur mise en œuvre.
Dans mon nouveau projet, je reprends ma casquette de sociologue du politique pour, dans un premier temps, cartographier les acteurs de ce monde de l’expertise. Consultants, agences de développement, fonctionnaires nationaux, fonctionnaires européens, organisations internationales, universitaires sont impliqués à des degrés divers dans l’assistance aux réformes administratives. La question est de savoir dans quelles proportions. Par exemple, y a-t-il une mainmise des grands cabinets de conseil ? Ou encore, le marché est-il dominé par certains États, qui vont intervenir, par le biais de leurs fonctionnaires et agences de développement, dans d’autres États membres ? Pour répondre à ces questions, j’exploite actuellement les données de la transparence financière européenne, afin de recenser les acteurs qui remportent les contrats d’assistance technique depuis 2016.
Dans un second volet du projet, je poursuivrai l’enquête à partir d’un type d’acteurs particulier : les agences nationales de développement. Étant à Paris, c’est le cas français qui sera privilégié, pour renseigner les raisons, formes et étapes de l’investissement du champ européen par Expertise France. Car au-delà de l’aspect lucratif, les enjeux sont aussi politiques et symboliques : dans ce domaine, gagner des contrats, c’est se promouvoir comme « modèle » d'action publique à l’étranger, et nourrir des réseaux transnationaux d’expertise.
Qu’apporte ce poste de CIVICA Fellow à votre projet ?
La double affiliation à EUI et à Sciences Po que m’offre ce statut est précieuse pour mon projet. La School of Transnational Governance, à laquelle je suis rattachée à EUI, non seulement offre un environnement de recherches stimulant sur l’expertise transnationale et les réformes administratives, mais donne aussi l’occasion d’échanger régulièrement avec des professionnels, dont certains sont impliqués dans les projets d’assistance technique que j’étudie. Quant à Sciences Po et au CEE, leurs membres ont la particularité d’être ancrés dans la recherche française tout en pratiquant une ouverture internationale forte. C’est cet équilibre que je recherchais, après une carrière à l’étranger, afin de renouer avec le champ de la sociologie politique. Par ailleurs, je me retrouve tout à fait dans le croisement entre l’approche par l'État et les politiques publiques, et celle par l’économie politique, deux des axes du CEE.
J’avais déjà passé quelques semaines à Sciences Po comme visiting researcher dans le cadre du programme AxPo au printemps 2024, et j'avais alors pu présenter mon projet dans un séminaire d’axe du CEE. Cet échange a compté parmi les plus stimulants de ma carrière — que ce soit le temps de questions-réponses lors du séminaire ou les discussions ensuite avec nombre de ses membres. J’avais envie de retrouver cette stimulation intellectuelle et cette joie de la recherche.
Propos recueillis par Véronique Etienne.
Pour aller plus loin :
- Dernière publication : How Eurocrats Negotiate the Path From Crisis to Routine: Tracing the Micro-Foundations of Routinisation After the Greek Crisis, JCMS, 27 octobre 2025. (Post de blog associé),
- Séminaire le 4 décembre : Qui réforme, qui est réformé ? Cartographie des mondes de l’assistance technique aux États membres (2016-2024).
À propos du programme de bourses postdoctorales CIVICA
Le programme de bourses postdoctorales CIVICA est une opportunité unique pour les chercheurs et chercheuses postdoctoraux en sciences humaines et sociales des institutions membres de CIVICA de passer une année académique dans l'une des autres institutions partenaires de l'alliance.
Notes
- 1.La troïka désigne un organe ad hoc chargé de superviser les plans de sauvetage et les réformes associées, formé par une alliance entre la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international.