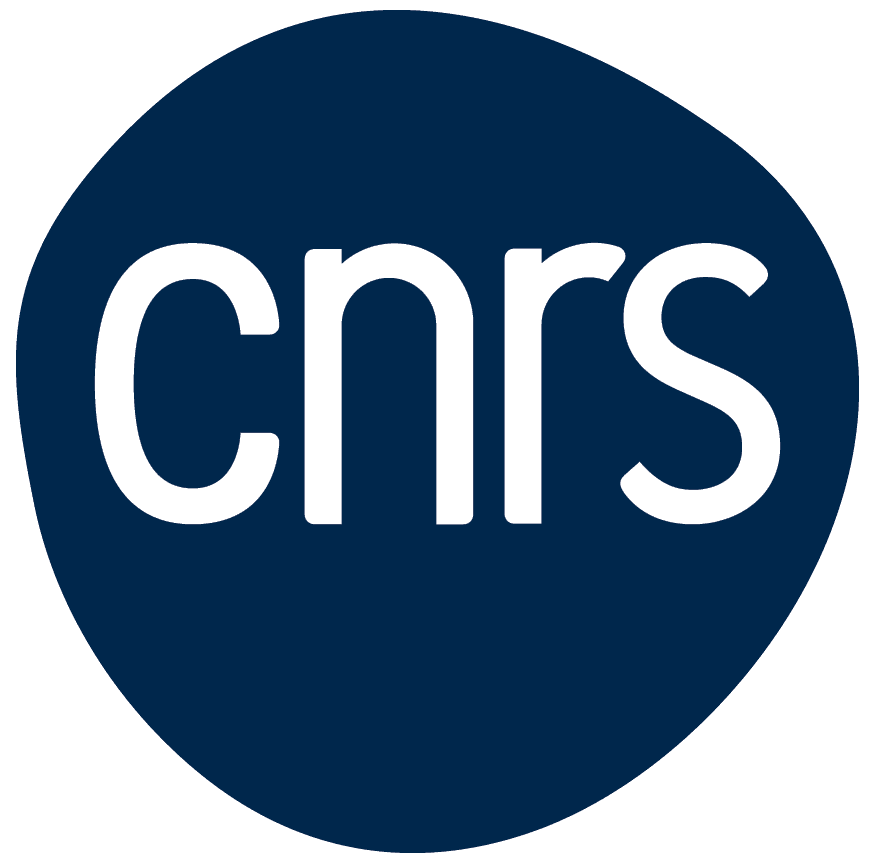Accueil>Recherche>Thèses portées par la Chaire
Thèses portées par la Chaire
Équipe de direction : Paul Tixier (IRD, MARBEC Sète) et Camille Mazé-Lambrechts (CEVIPOF, CNRS Sc Po.)
Lire
Après avoir obtenu un master en gestion de l’environnement et écologie littorale (Master GEEL, Université de La Rochelle) en 2021, Margaux Mollier a débuté sa carrière professionnelle avec un service civique au Parc naturel marin des Estuaires picards et de la mer d’Opale, durant lequel elle a travaillé sur la conciliation entre les activités humaines et la préservation de la faune sauvage (phoques et oiseaux limicoles).
En février 2023, elle a commencé sa thèse en écologie et en sciences de la durabilité à l’UMR Marbec à Sète, rattachée à l’école doctorale EUCLIDE, sous la direction de Paul Tixier (IRD – UMR MARBEC) pour la partie écologie et de Camille Mazé (Sciences Po CEVIPOF) pour la partie socio-anthropologie et gouvernance environnementale.
Sa thèse porte sur les conflits entre les pêcheries et les prédateurs marins (requins et cétacés) et plus particulièrement sur la compréhension des facteurs écologiques et humains de ces interactions, en se focalisant sur deux cas d’étude : la pêcherie palangrière à la légine des ZEE de Crozet et Kerguelen (TAAF) et la pêcherie palangrière thonière en Nouvelle-Calédonie. À partir des connaissances produites au cours de cette thèse, Margaux Mollier utilise une approche transdisciplinaire pour identifier des moyens écologiquement et socio-économiquement durables de réduction de ces conflits en modifiant les comportements de pêche notamment.

Diagnostic croisé en écologie et Science Politique pour une transformation des modes de gestion environnementaux à La Réunion.
Équipe de direction : Benjamin Bergerot (ECOBIO, Univ. Rennes CNRS) et Camille Mazé-Lambrechts (CEVIPOF, CNRS Sc Po). Association ARBRE (La Réunion)
Lire
Suite à l’obtention d’un master en écologie marine et insulaire (Master BEST-ALI, Université de La Réunion), Léo Broudic débute sa carrière professionnelle en initiant le projet UTOPIAN. Projet qui vise à cartographier l’état écologique des récifs coralliens de La Réunion. Suite à 3 ans de recherche et développement, il commence sa thèse en socio-écologie en octobre 2023 à l’Agence de Recherche pour la Biodiversité de La Réunion (ARBRE), rattaché à l’école doctorale EGAAL, sous la direction de Benjamin Bergerot (Université de Rennes – Ecobio) pour la partie écologie et de Camille Mazé-Lambrechts (Sciences Po CEVIPOF) pour la partie Science Politique.

Équipe de direction : Camille Mazé-Lambrechts (CEVIPOF, CNRS ScPo), Alexander Mawyer (Univ. Hawaii at Manoa), Tarik Dahou (PALOC, IRD) –
Lire
Après l’obtention d’un master d’anthropologie de l’environnement au Muséum National d’Histoire Naturelle, Valentin Raymond est actuellement inscrit en doctorat d’anthropologie et de science politique à La Rochelle Université (LIENSs, UMR 7266).
Auparavant, Valentin a rejoint le ministère de l’Environnement à l’occasion d’un stage sur les aides d’État portuaires ainsi que la Commission européenne sur la gestion des pêches en Méditerranée. Il a ensuite travaillé au sein de l’ONG ClientEarth sur la conservation des océans dans le cadre de la Politique Commune de la Pêche (CFP) européenne, notamment en matière de révision du régime européen de contrôle des pêches et du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP).
Cette thèse propose d’étudier la manière dont les communautés polynésiennes sont associées à l’élaboration et la mise en œuvre du gouvernement de la mer, entendu aussi bien comme la gestion que la conservation de la biodiversité marine. Cela implique de comprendre non seulement les raisons politiques et écologiques qui poussent les pouvoirs publics à impliquer les communautés locales dans des politiques environnementales, mais aussi les effets que cette intégration produit. En effet, la rencontre entre des dispositifs politiques – porteurs de certaines valeurs et des communautés locales ayant des représentations différentes de l’environnement – n’est pas sans conséquence sur les communautés, la biodiversité comme les pratiques de gouvernement. Replacer l’association des populations locales dans les politiques environnementales en Polynésie française entraîne nécessairement un questionnement sur la nature ultramarine de ce territoire, à la fois dans une histoire coloniale, participant à une méfiance vis-à-vis de la métropole et une affirmation autonomiste bien présente dans la région Pacifique, ainsi qu’en raison d’inégalités socio-économiques et environnementales importantes.

Équipe de direction : Philippe Durance (LIRSA / HT2S, Cnam), Camille Mazé-Lambrechts (CEVIPOF, Sciences Po, CNRS) et co-encadrement d'Isabelle Delannoy (L'Entreprise symbiotique)
Financement : Ceebios (Centre d’études et d’expertises dédié au déploiement du biomimétisme - s'inspirer du vivant pour innover)
Doctorant : Jordan Hairabedian est enseignant en climat-biodiversité-sociétés à Sciences Po Paris (EAP), Sciences Po Aix et Mines Paris PSL. Il réalise sa thèse sur la régénération socio-écologique de Mayotte et de La Réunion, dans une perspective systémique et interdisciplinaire. Son projet vise à s'inspirer de la nature pour innover via le biomimétisme et l'approche régénérative afin de produire un outil d'aide à la décision en matière d'action socio-écologique territoriale.
Jordan Hairabedian est diplômé de Sciences Po Aix en Relations et Affaires internationales. Il a été consultant chercheur senior en politiques européennes environnementales pendant cinq ans chez EcoAct. Il est auteur Environnement dans la revue de culture générale l'éléphant. Jordan est également relecteur expert de rapports internationaux (GIEC, UNEP). Il a co-écrit plusieurs rapports sur les solutions fondées sur la nature et l’économie bio-inspirée pour l’ADEME, la Commission européenne et le WWF.
Nous joindre ou nous rejoindre
Coordination :
- Camille Mazé-Lambrechts : Email
- Adresse : Sciences Po, 27 rue St Guillaume, 75007 Paris