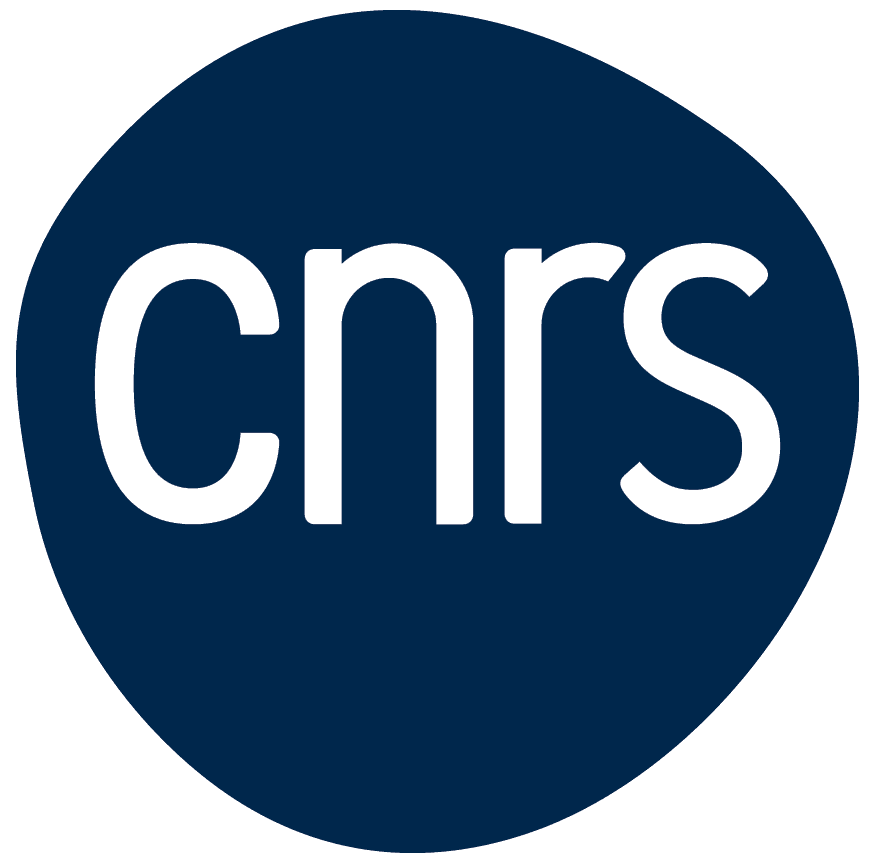Accueil>Publications>Articles de blog
Articles de blog
Autrices : Anaïta David, Karine Aurélia, Myriam Dubois Monkachi, Camille Mazé-Lambrechts,
Date : 20 novembre 2025

Du 10 au 15 novembre, la Chaire Outre-mer & Changements globaux a été associée au déplacement du Pôle Égalité des chances de Sciences Po à La Réunion. Une semaine dense, marquée par des rencontres inspirantes, des projets structurants et un engagement partagé en faveur de l’accès à l’excellence sur l’ensemble du territoire.
Ce déplacement a bénéficié du soutien essentiel de la Région Réunion, que nous remercions chaleureusement pour son accompagnement et pour la qualité du dialogue engagé avec la Chaire.
Égalité des chances : une mobilisation collective pour accompagner les lycéennes et lycéens réunionnais

L’équipe du Pôle Égalité des chances qui pilote depuis 2001 le dispositif des Conventions Education Prioritaire dans les lycées partenaires et la Chaire OMEGA ont rencontré plus d’une centaine d’élèves, d’enseignants et de personnels de direction au sein des sept lycées partenaires parmi près de 200 lycées conventionnés sur l’ensemble du territoire hexagonal:
- Lycée Antoine Roussin - Saint-Louis
- Lycée Paule Pignolet de Fresne Rivière - Trois-Bassins
- Lycée Jean Hinglo - Le Port
- Lycée Pierre Poivre - Saint-Joseph
- Lycée Lislet Geoffroy - Saint-Denis
- Lycée Georges Brassens - Sainte-Clotilde
- Lycée Sarda Garriga - Saint-André
Partout, un même constat : ambition, curiosité et énergie. Les élèves se sont saisis de ces moments d’échange pour questionner les parcours possibles, mieux comprendre les voies d’accès à Sciences Po et envisager leurs propres trajectoires d’excellence. Ces rencontres concrétisent l’esprit des CEP : faire tomber les barrières géographiques, sociales, économiques et symboliques, et permettre à chaque jeune d’oser, de croire en ses capacités et de réussir.
Cette ambition s’inscrit pleinement dans le cadre de l’article 51 de la loi Égalité réelle outre-mer (2017) qui encourage la création et le renforcement de chaires d’excellence dédiées à l’outre-mer dans les grandes écoles. La Chaire OMEGA avance dans cette voie, aux côtés des acteurs éducatifs, des collectivités et des équipes de terrain.
Ancrer la recherche et la formation dans le territoire réunionnais

La mission a également permis à la Chaire de consolider les liens avec :
- les enseignants-chercheurs partenaires,
- les équipes du Rectorat de La Réunion,
- et les acteurs institutionnels investis dans la transformation écologique et sociale du territoire.
Des échanges approfondis ont posé les bases d’une feuille de route scientifique renforcée sur les enjeux climat, biodiversité, océan, et sécurité dans les espaces ultra-marins. Une conférence publique a permis de partager ces travaux et d’engager le dialogue avec les étudiants, enseignants et citoyens présents.
Le séjour a également été l’occasion de travailler sur les projets en cours avec le CEVIPOF – Sciences Po / CNRS, de faire un point d’étape avec notre doctorant sur place, Léo Broudic, et de définir les prochaines orientations en lien avec les besoins des populations locales et des partenaires de terrain.
Célébrer les parcours réunionnais : le pouvoir de l’exemple
Une très belle réception à l’hôtel de Région a rassemblé élèves, équipes éducatives et alumni de Sciences Po originaires de La Réunion, venus témoigner de leurs parcours et rappeler que oui, ces trajectoires sont possibles.
Nous remercions chaleureusement les anciennes et anciens présents, ainsi que les étudiantes réunionnaises actuellement à Sciences Po, qui se sont mobilisés pour dialoguer avec les lycéens et transmettre leurs expériences.
Un coup de chapeau tout particulier à Layna Gabrielle Lebreton, diplômée de la promotion 2025, chargée de communication à la mairie de Salazie, dont l’énergie, la générosité et la disponibilité ont profondément marqué cette semaine d’action.
Remerciements
Cette mission n’aurait pu se dérouler sans le soutien déterminant et l’engagement de nombreuses personnes et institutions. La Chaire OMEGA adresse ses remerciements à : La Région Réunion, pour son appui constant en faveur de l’égalité des chances et pour la qualité des échanges ouverts pour la suite ; L’Académie de La Réunion et les équipes pédagogiques des sept lycées CEP ; Le Pôle Égalité des chances de Sciences Po, en particulier Myriam Dubois-Monkachi, Karine Aurélia et l’ensemble des collègues mobilisés ; L’Université de La Réunion et les chercheurs impliqués dans la structuration de la Chaire sur le territoire ; Les alumni et étudiantes réunionnaises de Sciences Po pour leur témoignage inspirant ; L’ensemble des élèves rencontrés, pour leur enthousiasme et leur confiance.
Cette mission a rappelé avec force que l’excellence doit être accessible à toutes et tous dans les outre-mer. Ouvrir les possibles, accompagner les ambitions, et renforcer les coopérations scientifiques pour répondre aux défis contemporains : telle est la voie que nous continuons de tracer ensemble.
Auteurs : Camille Mazé-Lambrechts, Jordan Hairabedian
Date : 21 mai 2025

Dans la perspective de la prochaine Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC3) qui se tiendra en juin à Nice, replacer les problématiques environnementales marines dans les enjeux socio-politiques et stratégiques est plus que jamais urgent et nécessaire, compte-tenu de l’évolution des changements globaux et des évolutions géopolitiques associées. Une lecture systémique doit être adoptée, au-delà des clivages et des polarisations. Les transformations du champ politique et les dynamiques institutionnelles, les relations de pouvoir et les émergences de nouveaux acteurs influents doivent être au cœur des observations et analyses.
Dans ce cadre, la soirée du 21 mars 2025 élaborée au théâtre du Châtelet par l’organisation non gouvernementale (ONG) BLOOM, “dévouée à l’océan et à ceux qui en vivent”, a mis en lumière l'axe environnemental interdisciplinaire et transdisciplinaire, sous le signe des arts et des sciences. À l’avant-poste de l’engagement, les ONG qui militent pour la protection de l’océan deviennent de véritables acteurs politiques qui s’emparent d’enjeux d’intérêt général en les portant auprès des décideurs politiques, économiques et de la société civile, tout en se basant sur la science et sur leurs propres analyses de données.
Le temps d’un soir, scientifiques, danseurs, musiciens, chanteurs, lecteurs et témoignages se sont fait écho, sous le thème rassembleur du Vivant(s). Tout commence dans les océans avec l’apparition de la vie, il y a 3,8 milliards d’années. Les cyanobactéries ont transformé la Terre et son atmosphère. Responsables de la “Grande Oxygénation”, grâce à la photosynthèse, elles ont permis le développement de la vie dans les mers et en-dehors. En miroir de ces organismes, l'Homo sapiens est une autre espèce qui a profondément modifié le monde, mais au détriment du vivant.
Si la France affiche un taux de 33% de protection des eaux par une aire marine protégée (AMP), dépassant ainsi le seuil défini par l’Accord de Kunming-Montréal en 2022 sur la biodiversité pour 2030, ce serait moins de 0,1% qui le serait réellement. La situation mondiale n’est pas moins alarmante. 800 chalutiers détruiraient chaque année la surface marine de la France, de la Belgique et de la Suisse.
Ces tendances ne sont pas nouvellement connues, comme le rappellent les travaux d’éminents scientifiques : le rapport Meadows The Limits to growth de 1972 introduisant la prospective en matière de ressources limitées, l’article “Fishing down marine food webs” de Daniel Pauly de 1998, le rapport de Nicholas Stern The Economics of Climate Change de 2006 traitant des coûts de l’inaction face au changement climatique ou encore le livre Les Marchands de doute de Naomi Oreskes de 2010 sous-titré “comment une poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le tabagisme et le réchauffement climatique”, en connivence avec des industriels.
Face à ces constats, Christophe Cassou, chercheur CNRS au laboratoire “Climat, Environnement, Couplages et Incertitudes”, témoigne : “Nous avons sous-estimé les risques. L’indignation et l’engagement ne sont pas des crimes. La résistance à l’ignorance doit s’organiser. Résister à l’obscurantisme est un devoir moral éthique et humaniste des scientifiques.” Le scientifique n’est pas limité à son laboratoire, il peut porter sa voix pour faire face aux changements globaux et aux impacts anthropiques.
Et ces bouleversements vont bien au-delà du climat, de la biodiversité et des enjeux de protection de l’environnement. Le triptyque d’action climat-biodiversité-sociétés est à rétablir afin de répondre aux contraintes systémiques posées par les défis contemporains. En effet, préserver l’océan, en faire “un commun” en renforçant la gouvernance internationale, la protection dans les zones économiques exclusives comme en haute mer, implique d’augmenter les moyens des armées et en particulier des marines nationales, en charge de la surveillance, du contrôle, de la dissuasion, de l’action humanitaire et de la défense. Au-delà des déclarations de création chiffrées d’aires marines protégées ou de signature et ratification de traités, il faut se donner les moyens de pouvoir garantir les régimes de protection déclarés et répartir les charges et responsabilités.
En effet, en France, c’est bien le rôle de la Marine nationale de surveiller et de protéger le domaine maritime, comme de lutter contre les trafics et les activités illicites (comme la pêche dite INN pour illégale, non déclarée et non réglementée), dont souffrent en particulier les communautés locales. Il revient également à la Marine d’avoir une action humanitaire, notamment en restaurant l'ordre et la sécurité afin de permettre aux acteurs du secteur d'effectuer des actions humanitaires et d'aide au développement.
Ainsi, les acteurs de la protection de l’environnement, les scientifiques, les militaires et les acteurs de gestion et d’intervention en situation de crise, ont donc tout intérêt à davantage collaborer pour renforcer l’efficacité de leurs prises de position et de leurs actions, au bénéfice de l'environnement, des espèces vivantes non humaines et des sociétés humaines qui en dépendent de manière intrinsèque. C’est la raison d’être de la Chaire Outre-mer et Changements globaux qui déploie ses activités dans les territoires ultramarins, en étroite interaction avec les acteurs sur place. Ensemble, en croisant les regards et les pratiques, en collaborant avec des artistes comme dans le cadre du Bateau-atelier de Titouan Lamazou, véritable laboratoire et atelier itinérant, les chercheurs, les décideurs, les gestionnaires d'environnement et de ressources, les acteurs privés, entrepreneurs et industriels, embarquent ici ensemble afin de tracer des pistes de transformation socio-écologique concrètes, de contribuer à la régénération des écosystèmes, au maintien des conditions d'habitabilité territoriale dans le contexte de dépassement des limites planétaires où la cohésion est plus que jamais nécessaire, face à la multiplication des fractures et à l'augmentation de la compétition entre États et groupes communautaires organisés.
Nous joindre ou nous rejoindre
Coordination :
- Camille Mazé-Lambrechts : Email
- Adresse : Sciences Po, 27 rue St Guillaume, 75007 Paris