
Accueil>Publications>Regards sur nos publications - Année 2024
Regards sur nos publications - Année 2024

Cette page présente par ordre de parution les débats et les analyses suscités par les publications scientifiques des chercheur-e-s du CERI au cours du trimestre.
Vous y trouverez, entre autres, des entretiens, vidéos, podcasts et comptes rendus qui contribuent à prolonger et à enrichir la réflexion développée dans ces travaux.
Toutes ces ressources sont librement accessibles en ligne, sauf certaines recensions parues dans des revues à comité de lecture.
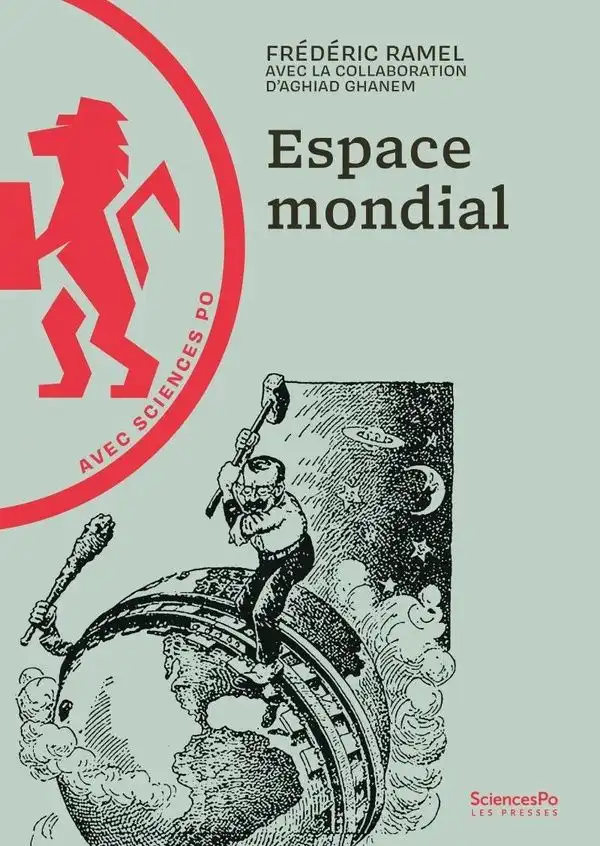
Frédéric Ramel, avec la collaboration d'Aghiad Ghanem
Espace mondial
Paris, Presses de Sciences Po, 2024, 476 p.
Nos vies sont plus que jamais liées les unes aux autres. Un virus circulant à travers les frontières entraîne des mesures de confinement dans la majorité des pays. Une guerre interétatique expose à des ruptures d'approvisionnement en gaz et en céréales bien au-delà des États belligérants. Le succès d’un objet du quotidien rend les économies dépendantes de terres rares dont l’exploitation se révèle particulièrement polluante sur l’ensemble des continents. Si cette tendance à nous voir exposés à des enjeux qui débordent le cadre national n’est pas forcément nouvelle, elle prend de plus en plus d’ampleur. La coupure entre affaires intérieures et extérieures des sociétés ne tient plus : nous évoluons dans un espace mondial, la plupart du temps sans que nous nous en rendions pleinement compte. Liant Relations internationales et condition planétaire, ce manuel invite à cultiver un nouveau regard sur des enjeux mondiaux omniprésents, mais souvent négligés ou simplifiés. Riche d’une centaine de cartes et documents, il donne à comprendre l’interdépendance profonde des faits sociaux, environnementaux, économiques et sécuritaires.
Autour de la publication - 05/02/2025
Les Entretiens du CERI
06 décembre 2024
L’espace mondial, ou nos vies entrelacées
Entretien avec Frédéric Ramel, par Miriam Périer
12 décembre 2024
The World Space, or our Intertwined Lives
Entretien avec Frédéric Ramel, par Miriam Périer
Médias
05 février 2O25
Planisphère. Quelle géopolitique de l’espace mondial ? Avec F. Ramel
Podcast, vidéo et synthèse rédigée par E. Bourgoin, F. Ramel, et P. Verluise, Diploweb
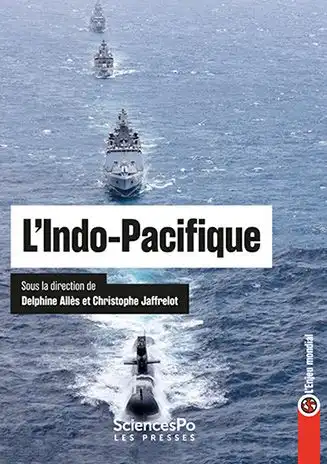
Delphine Allès, Christophe Jaffrelot (dir.)
L'indo-Pacifique
Paris, Presses de Sciences Po (L'Enjeu mondial), 2024, 190 p.
Formulée pour la première fois en 2007 pour souligner la convergence des intérêts indiens et japonais en matière de sécurité maritime, la notion d'Indo-Pacifique s'est imposée en une petite décennie à l’agenda international. Elle structure les discours politiques et stratégiques de la plupart des États interagissant dans cette zone et, au-delà, fait l’objet de définitions concurrentes, de réinventions et de contestations. Elle agit comme un révélateur géopolitique : chaque acteur semble projeter à travers elle sa conception du monde. Cartes et données à l’appui, cet ouvrage propose, au fil des contributions, une synthèse inédite d’analyses sur une zone devenue un enjeu mondial. Coréalisée par le CERI et les Presses de Sciences Po, la collection « L’Enjeu mondial » propose les analyses de spécialistes illustrées de façon claire et pédagogique par des cartes et des graphiques en couleurs, et enrichies des données les plus récentes.
Autour de la publication - 15/01/2025
Vidéos
10 décembre 2024
Trois entretiens sur l'Indo-Pacifique
Entretiens avec trois auteurs de l'ouvrage, par Christophe Jaffrelot
Médias
22 janvier 2025
Quelle place pour la France et l'Europe en indo-pacifique à l'heure de la nouvelle politique internationale américaine ?
Débat avec Delphine Allès, par Quentin Lafay, France Culture
Recensions
8 février 2025
L’Indo-Pacifique : naissance d’un concept
Séverine Bardon, En attendant Nadeau
Janvier 2025
Recension de l'ouvrage L'Indo-Pacifique
Renaud Lambert, Le Monde diplomatique
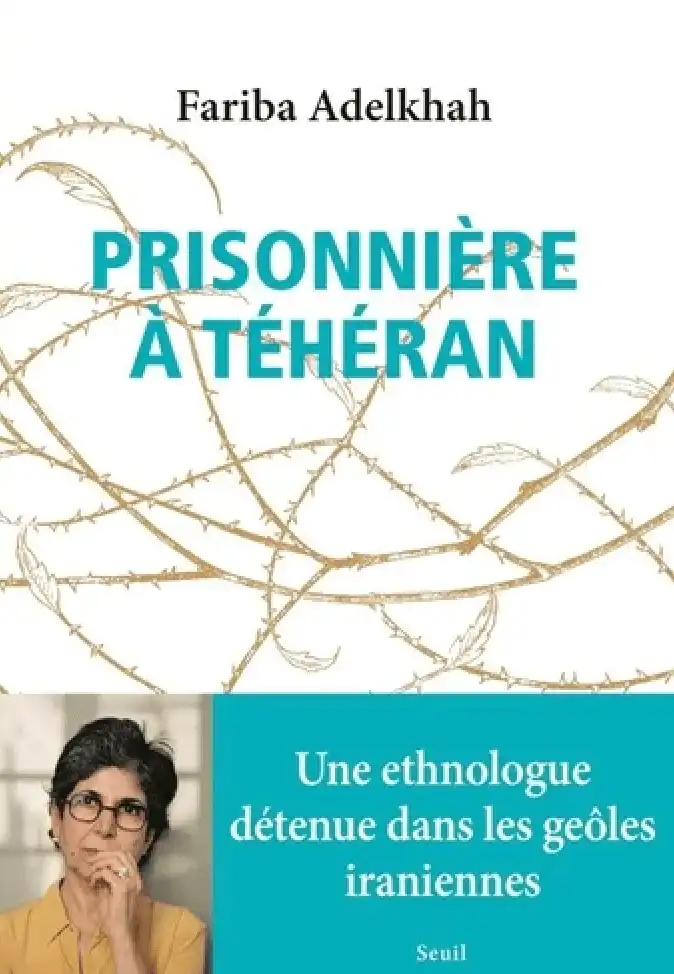
Fariba Adelkhah
Prisonnière à Téhéran
Paris, Seuil, 2024, 256 p.
Par définition un anthropologue est un intrus. Sa présence et son regard dérangent. Fariba Adelkhah en a fait l’expérience. Arrêtée en 2019, elle a été condamnée en 2020 à cinq ans de prison en Iran pour atteinte à la sécurité nationale. Elle a finalement été libérée en 2023, après avoir été graciée et non acquittée comme elle l’aurait souhaité. Privée de son terrain d’étude, elle s’en est inventé un autre, inattendu. Dans une suite de courts récits, Fariba Adelkhah raconte sans complaisance, à rebours des clichés, sa vie de prisonnière « politico-sécuritaire » en République islamique. Par là même, elle renouvelle notre compréhension de l’Iran post-révolutionnaire, et livre une réflexion plus générale sur la condition carcérale. Elle incarne également avec modestie, ironie et non sans auto-dérision un combat courageux et lucide pour la liberté scientifique, de plus en plus menacée aussi bien dans les régimes autoritaires que dans les démocraties libérales.
Autour de la publication - 21/11/2024
Présentation et débat
25 novembre 2024
Vidéo - Podcast
À l'occasion de la publication de son livre, présentation de Fariba Adelkhah suivi d'un débat avec Stéphanie Balme, Vincent Casanova, Béatrice Hibou, Pascale Laborier et Jean-François Bayart
Médias
21 novembre 2024
« J'ai voulu démystifier la prison d'Evin »
Entretien avec Fariba Adelkhah, par Arnaud Pontus, RFI
16 novembre 2024
"Toutes les prisonnières politiques ont un projet d'émancipation"
Entretien avec Fariba Adelkhah, par Charline Vanhoenacker, France Inter
11 novembre 2024
Retenue 4 ans en Iran - Fariba Adelkhah
Entretien avec Fariba Adelkhah, par Anne-Elisabeth Lemoine, France 5
"J'ai survécu en faisant mon métier, en transformant la prison iranienne en objet d'étude"
Entretien avec Fariba Adelkhah, par Sonia Devillers, France Inter
Derrière les murs d'Evin, à Téhéran
Entretien avec Fariba Adelkhah, par Pauline Paccard, France 24
07 novembre 2024
Fariba Adelkhah, une anthropologue en prison
Entretien avec Fariba Adelkhah, par Sylvain Bourmeau, France Culture
Prisonnière en Iran
Entretien avec Fariba Adelkhah, par Elisabeth Quin, Arte
Recension
23 novembre 2024
Iran. Fariba Adelkhah, carnets de prison
Laurent Bonnefoy, Orient XXI
CERI/Lab.
01 janvier 2024
« Je ne vais pas manquer à mes promesses… »
Témoignages de Fariba Adelkhah
Extraits
Préface (cliquer sur "Feuilleter")
Dernier chapitre
Postface de Béatrice Hibou
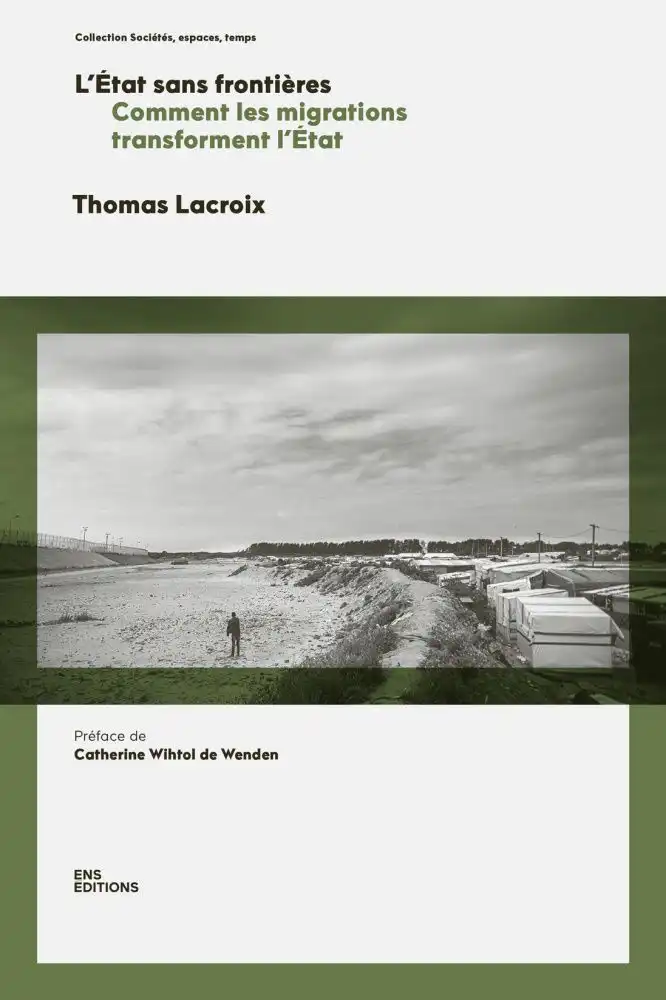
Thomas Lacroix
L'État sans frontières. Comment les migrations transforment l'État
ENS Éditions, Sociétés, Espaces, Temps, 2024, 348 p.
Accords de double nationalité, externalisation des contrôles aux frontières, multiplication des ministères publics en charge des diasporas… Les États développent un nombre croissant d’instruments pour intervenir au-delà leurs frontières. Comment les politiques ciblant les flux migratoires transforment-elles l’État ? Le présent ouvrage renouvelle un débat sur le transnationalisme qui, depuis plus de trente ans, anime les études migratoires. Thomas Lacroix explore la relation étroite entre « État transnational », c’est-à-dire l’ensemble des politiques et administrations d’un État destinées à réguler les flux transnationaux, et « société transnationale », soit l’écheveau des institutions sociales permettant de maintenir des liens, des pratiques et des relations par-delà les frontières. L’auteur propose ainsi la première théorie globale de l’État transnational en lien avec une théorie sociale de la société transnationale. S’appuyant sur plus de vingt ans de recherches sur des terrains variés – dans les pays du Nord comme du Sud, dans des espaces de départ, de transit ou de destination –, ce livre fournit aux spécialistes et étudiants une boîte à outils conceptuelle permettant d’appréhender aussi bien les pratiques des migrants que les politiques d’État.
Autour de la publication - 20/11/2024
Les entretiens du CERI
20 novembre 2024
"L'Etat face au flux migratoire ne se déterritorialise pas, il se transnationalise"
Entretien avec Thomas Lacroix, par Miriam Périer

Laure de Roucy-Rochegonde
La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle
Paris, PUF, 2024, 344 p.
Les progrès fulgurants des techniques d'intelligence artificielle et de la robotique, et surtout leur application au domaine de la défense, font entrevoir l'émergence de nouveaux types de robots militaires, rendus toujours plus autonomes, c'est-à-dire capables de recourir à la force de leur propre chef. Les « robots tueurs » soulèvent néanmoins de nombreuses questions : ces moyens de guerre permettant de ne pas exposer l’humain peuvent-ils être pleinement contrôlés ? Qu’implique le recours à ces technologies ? Quels effets produisent-elles sur ceux qui les emploient, sur les adversaires qui y font face, et sur la forme même des rapports entre agresseurs et agressés ? Ces systèmes modifient-ils les relations entre les États, mais aussi le lien entre l’État et ses citoyens ? Sont-ils compatibles avec le droit de la guerre ?
Autour de la publication - 27/10/2024
Médias
27 octobre 2024
La guerre à l’heure de l’IA
Laure de Roucy-Rochegonde, The Conversation
28 octobre 2024
La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle
Entretien avec Laure de Roucy-Rochegonde, par Quentin Lafay, France Culture
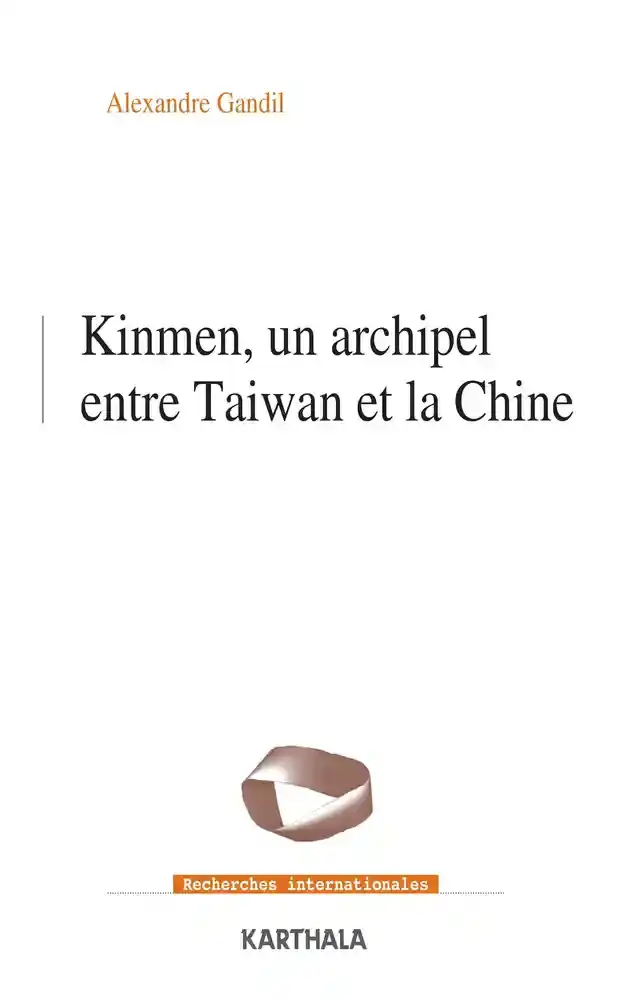
Alexandre Gandil
Kinmen, un archipel entre Taiwan et la Chine
Paris, Karthala, 2024, 396 p.
C’est le reliquat de la guerre civile chinoise (1946-1950) et de la Guerre froide. À quelques kilomètres seulement des côtes de la République populaire de Chine, aux portes de la province continentale du Fujian, le drapeau de la République de Chine (Taiwan) flotte encore sur le petit archipel de Kinmen (Quemoy). La lecture de cet ouvrage s’impose à qui veut comprendre la question sino-taiwanaise et la menace qu’elle fait peser sur la paix mondiale, en ces temps dangereux. Et aussi à qui veut reprendre à nouveaux frais le rapport de l’État à la nation, dans une perspective comparative.
Autour de la publication - 15/10/2024
Les Entretiens du CERI
08 décembre 2024
Kinmen, un archipel entre Taiwan et la Chine
Entretien avec Alexandre Gandil, par Corinne Deloy
Médias
15 octobre 2024
La Chine veut-elle envahir Taïwan ?
Entretien avec Alexandre Gandil, par Guillaume Erner, France Culture

Bertrand Badie
L'Art de la paix. Neuf vertus a honorer et autant de conditions à établir
Paris, Flammarion, 2024, 256 p.
Sun Tzu, général chinois du VIᵉ siècle avant Jésus-Christ, a écrit un Art de la guerre qui aujourd’hui encore suscite l’intérêt de très nombreux lecteurs. Tandis que la guerre refait irruption en Europe et au Proche-Orient, si l’on étudiait comment faire la paix au XXIᵉ siècle ? C’est à cette mission que Bertrand Badie, le plus philosophe des professeurs en relations internationales, s’est attelé dans cet ouvrage à la portée universelle. La paix a changé de nature. Longtemps cantonnée à l’état de non-guerre, associée à des périodes de trêve obtenues par transactions géographiques, économiques, dynastiques, elle ne peut désormais être établie qu’à la condition d’être redéfinie, pensée comme un tout, considérée à l’heure de la mondialisation et des nouvelles menaces, notamment climatiques, qui pèsent sur notre planète. S’appuyant sur quantité d’exemples historiques ou contemporains, Bertrand Badie dresse des perspectives : faire primer le social sur le rapport de force, chercher à comprendre l’Autre, trouver les justes normes, combler ce qui nous sépare… Revisitant des références essentielles d’Aristote à Kant, il propose neuf vertus à mettre en œuvre pour faire la paix.
Autour de la publication - 02/10/2024
Extraits
06 octobre 2024
Pourquoi la paix est un art autant que la guerre
Extraits de l'introduction, The Conversation
Médias
02 octobre 2024
« L'art de la paix » - 4 questions à Bertrand Badie
Entretien avec Bertrand Badie, par Pascal Boniface, Mediapart
08 octobre 2024
L'invité de Points de Vue
Entretien avec Bertrand Badie, par Vincent Roux, Le Figaro
26 octobre 2024
La parole aux auteurs: Kako Nubukpo et Bertrand Badie
Entretien avec Bertrand Badie, par Emmanuel Lechypre, BFMTV
23 novembre 2024
"La paix couvre un champ d'action qui va au-delà du seul secteur de la guerre"
Entretien avec Bertrand Badie, par Aude Lechrist, France 24
30 novembre 2024
Et la paix dans tout ça ?
Entretien avec Bertrand Badie, par Marie-France Chatin, RFI
Recensions
27 octobre 2024
Livre : Bertrand Badie en quête de paix
Dominique Vidal, Mediapart
02 novembre 2024
Agir pour la paix dans un monde complexe et globalisé
Francis Wurtz, L'Humanité

Christophe Jaffrelot et Vanessa Caru
Histoire de Bombay/Mumbai
Paris, Fayard, 2024, 544 pages.
Bombay, devenue Mumbai en 1995, est surtout connue en France pour ses conditions catastrophiques de logement et pour son industrie cinématographique florissante, Bollywood. Au-delà de ces images attendues, Vanessa Caru et Christophe Jaffrelot ont voulu retracer l'histoire de cette cité devenue, depuis le XIXe siècle, la capitale économique de l'Inde ainsi que la ville la plus peuplée du pays, attirant migrants et migrantes à la recherche d'une vie meilleure. De port inséré dans de multiples réseaux commerciaux, elle s'est mue en une métropole industrielle et s'est imposée comme un des hauts lieux de la lutte pour l'Indépendance, mais aussi de puissants mouvements sociaux qui visaient à remettre en cause les inégalités de classe et de caste. Ressaisissant sa trajectoire historique, les auteurs éclairent les défis auxquels la ville est à présent confrontée : la montée de la xénophobie, notamment du nationalisme hindou, l'emprise du crime organisé, les effets de la désindustrialisation ainsi que des dégradations environnementales dont pâtissent au premier chef ses habitantes et habitants les plus précaires.
Autour de la publication - 15/01/2025
Entretiens du CERI
30 août 2024
De Bombay à Mumbai : une ville en mutation politique, économique et sociale
Entretien avec Christophe Jaffrelot, par Corinne Deloy
Recensions
Novembre 2024
Les livres du mois
Lili Frèrebeau, Le Monde diplomatique
12 novembre 2024
Les livres de la dernières minute
Jean-Marc Daniel, BFMTV
Janvier 2025
De Bombay à Mumbay
Clément Fabre, L'Histoire

Alice Mesnard, Filip Savatic, Jean-Noël Senne, Hélène Thiollet
Revolving Doors: How Externalization Policies Block Refugees and Deflect Other Migrants across Migration Routes
Population and Development Review, 2024, 36 p. DOI: 10.1111/padr.12650. HAL: hal-04687266
Migrant destination states of the Global North generally seek to stem irregular migration while remaining committed to refugee rights. To do so, these states have increasingly sought to externalize migration control, implicating migrant origin and transit states in managing the movement of persons across borders. But do externalization policies actually have an impact on unauthorized migration flows? If yes, do those impacts vary across different migrant categories given that both asylum seekers and other migrants can cross borders without prior authorization? We argue that these policies do have an impact on unauthorized migration flows and that those impacts are distinct for refugees and other migrants. Using data on “irregular/illegal border crossings” collected by Frontex, the Border and Coast Guard Agency of the European Union (EU), we first find that the geographical trajectories of refugees and other migrants who cross EU borders without authorization are distinct. Using a novel method to estimate whether individuals are likely to obtain asylum in 31 European destination states, we find that “likely refugees” tend to be concentrated on a single, primary migratory route while “likely irregular migrants” may be dispersed across multiple routes. Through an event study analysis of the impact of the 2016 EU–Turkey Statement, a paradigmatic example of externalization, we show that the policy primarily blocked likely refugees while deflecting likely irregular migrants to alternative routes. Our findings ultimately highlight how externalization policies may fail to prevent unauthorized entries of irregular migrants while endangering refugee protection.
Autour de la publication - 20/11/2024
Médias
20 novembre 2024
L’externalisation des contrôles migratoires de l’UE : une politique dangereuse et inefficace
Alice Mesnard, Filip Savatic, Hélène Thiollet et Jean-Noël Senne, The Conversation
Blog
10 septembre 2024
The Distinct–and Damaging–Impacts of Policies Externalizing Migration Control on Refugees and Other Migrants
Alice Mesnard, Filip Savatic, Jean-Noël Senne, Hélène Thiollet, Population Council
Réseaux sociaux
24 juillet 2024
Just published!
Hélène Thiollet
Vulgarisation
14 juin 2024
The Effects of Externalization Policies on Refugees and other Migrants
Alice Mesnard, Filip Savatic, Jean-Noël Senne, Hélène Thiollet, Externalizing Asylum, a compendium of scientific knowledge
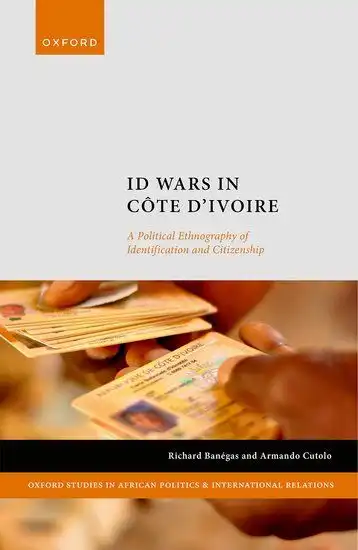
Richard Banégas and Armando Cutolo
ID Wars in Côte d'Ivoire. A Political Ethnography of Identification and Citizenship
Oxford University Press, 2024, 352 p.
Identity documents provide rights to citizenship and social inclusion. They can also generate violence and conflicts. This book explores Côte d'Ivoire's 'ID war' as a paradigmatic case of a citizenship crisis, centered on the access to national identity cards and certificates. Using ethnographic and historical data, it shows how the documentary struggle for citizenship has continued in the post-crisis reconstruction, affecting the new policies of identification and registration based upon biometrics and new technologies. It describes how the latter have been overturned and reframed by the Ivorian society. Focusing on the production and negotiation of legal identities, the book delves into the social life of IDs and biometrics and describes the clandestine world of the 'margouillats', the corrupt brokers of the civil registry, the forms of documentary falsification aimed at taming legal and bureaucratic principles with the requirements of ordinary social life, the hidden practices of state apparatuses of identification and the local machinery of biometric registration, and the self-made censuses and systems of identification used by minorities seeking recognition in the public space. Through these ethnographic descriptions with a specific approach 'from below', the book shows that actual reforms supposed to depoliticize - and in the case of biometric technologies, to de-socialize - identification do not erase its constitutively political dimension. From a comparative perspective, the case of Côte d'Ivoire reveals the unprecedented revenge of the documentary state on the biometric state and encourages us to rethink their dyadic opposition in a more complex triangulation of identification, debt and recognition.
Autour de la publication - 27/09/2024
Entretiens du CERI
27 septembre 2024
ID Wars in Côte d'Ivoire
Interview with Richard Banégas and Armando Cutolo, by Miriam Périer
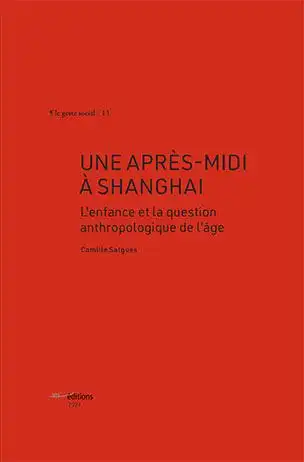
Camille Salgues
Une après-midi à Shanghai. L'enfance et la question anthropologique de l'âge
Genève, Les Éditions ies, 2024, 288 pages.
L’enquête a donc duré trois ans et non ‘une après-midi’ : mais je voulais, avec ce titre, garder quelque chose de la temporalité de ces longs moments à traîner avec les enfants. Et, on l’aura compris, ce n’est pas le Shanghai que l’on voit d’habitude, ce n’est pas une après-midi à faire du shopping sur le Bund dont il s’agit ici. C’est plutôt le Shanghai des ‘mauvaises herbes’ de Lu Xun, celui des habitats dégradés entre deux zones en rénovation, là où vivaient les enfants sur lesquels j’enquêtais, venus des campagnes chinoises pour accompagner leurs parents en quête de travail. C’est là que l’on suivra la trame ordinaire de ces vies petites, au gré des rencontres et des lieux de l’ethnographie qui organisent le parcours de l’enquête et du livre. (…) Le souci de (r)ouvrir la discussion de l’enfance en sciences sociales est soigneusement entremêlé dans ces déambulations, comme un livre dans un autre livre, dont on peut suivre le fil à travers le système des sous-titres. Chaque chapitre est ainsi l’occasion d’un arrêt sur un moment clé de ce qui pourrait être une réflexion sur l’enfance ou, plutôt, sur la question anthropologique de l’âge, abordée à partir de l’enfance.
Autour de la publication - 06/09/2024
Entretiens du CERI
06 septembre 2024
Les sciences sociales et l'expérience de l'enfance pauvre
Entretien avec Camille Salgues, par Corinne Deloy
Jeanne Bouyat, Amandine Le Bellec, Lucas Puygrenier (eds)
States in the Making of Others. Perspectives on Social State Institutions and Othering in Southern Africa and Western Europe
New York, Palgrave Macmillan, 2024, 275 p.
This volume offers a unique interdisciplinary and comparative perspective on contemporary processes of othering by state institutions in relation to dynamics of racism, xenophobia, sexism, homo-transphobia, as well as ethnic- and class-based discriminations. It focuses on eight original case studies empirically grounded in various domains of the ‘social state’, in Southern African and Western European contexts: the education and health care systems, the regulation of work and of procreation rights, and institutions in charge of granting asylum. The authors provide key insights on how states produce Others, and on how othering contributes in turn to the process of state formation and the politicization of public action.
Autour de la publication - 29/08/2024
Entretiens du CERI
29 Août 2024
From the State to the Other and the Other to the State.
Interview with Jeanne Bouyat, Amandine Le Bellec & Lucas Puygrenier by Miriam Périer

François Bafoil et Paul Zawadzki (dir.)
Politiques de la destructivité. Sciences sociales et psychanalyse
Paris, Hermann, 2024, 254 p.
Le séminaire dont est issu cet ouvrage est né du constat de l’affaissement du dialogue entre les sciences sociales et la psychanalyse qui avait pourtant été vif et fécond en France jusqu’aux années 1980. Les auteurs du présent livre se proposent d’en reprendre le fil, aujourd’hui que la guerre est revenue en force sur le sol européen tandis qu’elle ne cesse de se poursuivre inlassablement dans d’autres régions du monde. Plus que jamais s’impose la réflexion sur le lien entre la pulsion de destruction et le social pour penser la place des institutions dans leur rapport à leurs soubassements psychologiques. Selon quelles modalités est-il possible d’articuler la compréhension sociologique et l’interprétation psychanalytique, quelles en sont les limites et les apports respectifs ? Après avoir discuté les catégories freudiennes de la horde primitive, de l’Œdipe, de la Masse et de la liberté, les réflexions des auteurs se confrontent plus directement à l’expérience historique de la guerre, du viol et du nationalisme. Entre universalité du psychisme, compulsion pulsionnelle et expériences historiques toujours spécifiques, quelle place conférer à l’inconscient, collectif ou individuel ?
Autour de la publication - 26/06/2024
Podcasts
Sciences Sociales et Psychanalyse
Cycle de séminaires du groupe de recherche "Sciences sociales et psychanalyse"
Entretiens du CERI
26 mai 2024
Renouer le dialogue entre sciences sociales et psychanalyse.
Entretien avec François Bafoil et Paul Zawadski, par Miriam Périer
Renewing the dialogue between the social sciences and psychoanalysis.
Interview with François Bafoil and Paul Zawadski, by Miriam Périer

Benoît Pélopidas (dir.)
Nuclear France. New Questions, New Sources, New Findings
Routledge, 2024, 186 p.
This book offers the first non-official history of French nuclear policies which goes beyond the divide between nuclear weapons and nuclear energy policies. It addresses the sizing of France’s nuclear forces, technological assistance to countries with nuclear weapons programs, uranium prospection, nuclear testing, its health effects and protests against it, as well as plans to prevent and manage accidents in nuclear power plants. It is based on new questions and new sources from France and abroad. The chapters in this volume show how independent and interdisciplinary scholarship free from conflicts of interests can uniquely advance our understanding of nuclear history and politics. This is the case because it does not treat the categories and judgments of official discourse as neutral starting points of the analysis. This volume is based on untapped primary sources from France, the UK, the US, India, South Africa and Iran, on a new assessment of the health consequences of French nuclear testing in Polynesia thanks to a modern atmospheric particle transport code coupled with historical weather data, open-source information about radioactive debris (“mushroom”) clouds, as well as data on the composition and particle sizes of the fallout; and on new survey data about French knowledge of and attitudes towards nuclear weapons and nuclear energy. They show notably that the first generation of French nuclear forces lacked technical credibility despite reliance on outside help. Several French officials knew this, as did France's allies and adversaries. Moreover, French strategic collaborations associated to nuclear programs extended to India and South Africa; nuclear safety regulations changed fundamentally after the Cold War, and approximately 110,000 people, i.e. 90% of the French Polynesian population in the 1970s, could have received doses that would qualify them for compensation according to French law.
Autour de la publication - 26/06/2024
Entretiens du CERI
28 juin 2024
Pour une recherche indépendante sur le nucléaire
Entretien avec Benoît Pelopidas, par Miriam Périer
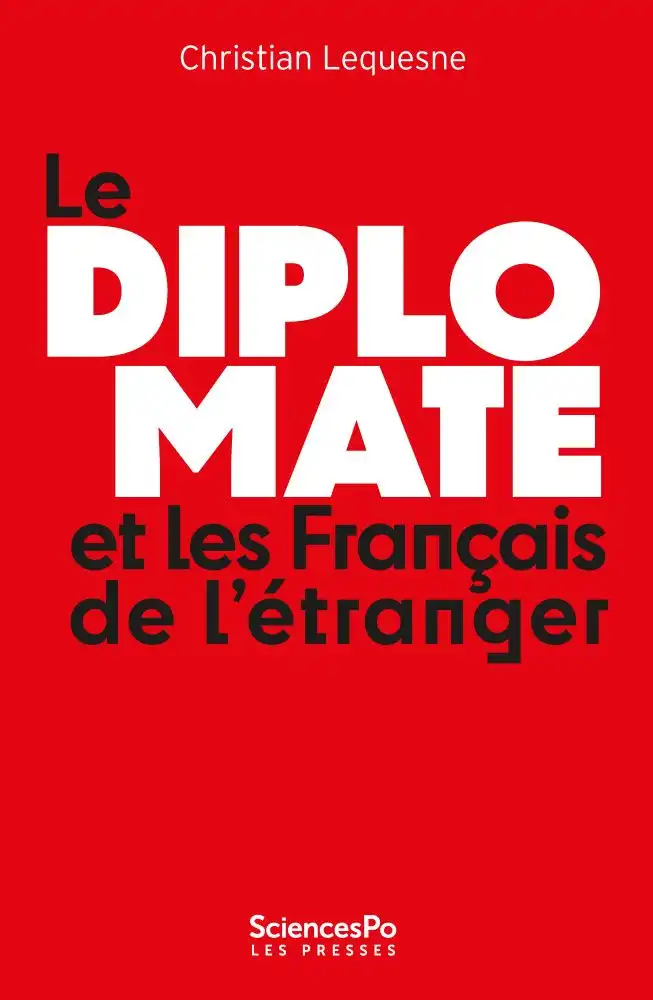
Christian Lequesne
Le diplomate et les Français de l'étranger. Comprendre les pratiques de l'État envers sa diaspora
Paris, Presses de Sciences Po, 2024, 176 p.
Binationaux, expatriés, actifs internationalisés, retraités, étudiants et, de plus en plus, e-travailleurs, les quelque 2,5 millions de citoyens français vivant à l'étranger sont loin de constituer une communauté homogène. Par le biais de son réseau diplomatique et consulaire, l’État cherche à construire une relation avec cette diaspora en mettant à sa disposition des services et des institutions (lycée français, système de protection sociale, chambre de commerce, mais aussi élus consulaires et parlementaires) qui lui permettent de ne pas renoncer au lien avec le territoire d’origine. Enquête inédite de science politique menée sur trois continents, l’ouvrage met au jour une pratique diplomatique de la France qui reste largement régalienne : l’État continue de considérer ses ressortissants à l’étranger comme ses protégés, mais peine davantage à faire d’eux une ressource productive au service d’une véritable stratégie d’influence.
Autour de la publication - 16/06/2024
Podcast
04 juin 2024
Présentation de l'ouvrage
Avec Christian Lequesne, Sylvain Beck, Samantha Cazebonne et Thomas Lacroix
Entretien
16 juin 2024
Comment s’organisent les relations entre le diplomate et les Français de l’étranger ?
Entretien avec Christian Lequesne, par Pierre Verluise, Diploweb
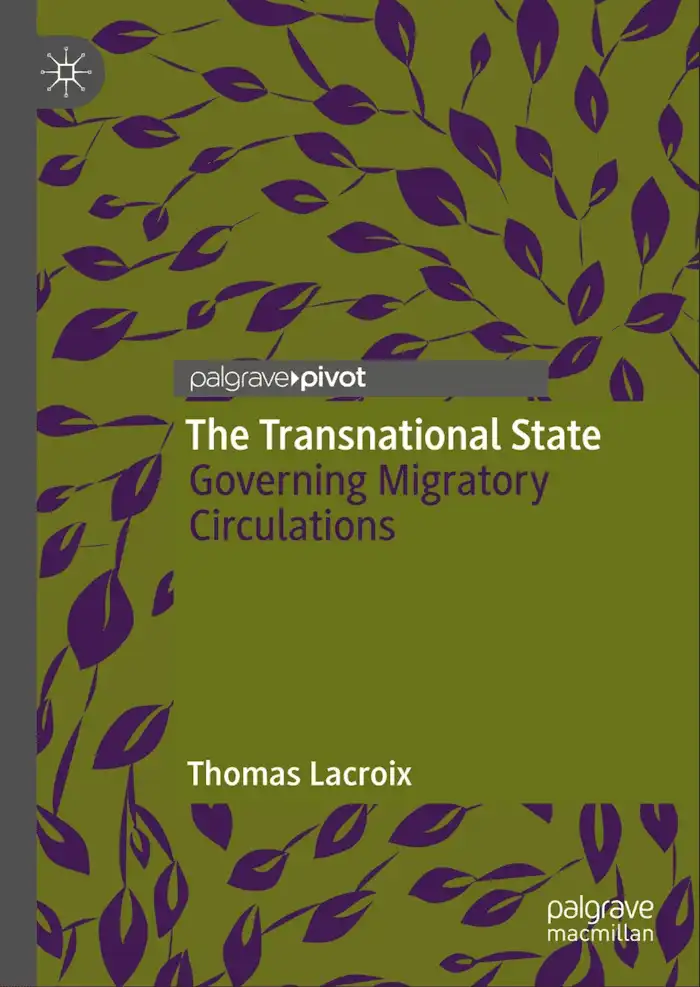
Thomas Lacroix
The Transnational State. Governing Migratory Circulations
Cham, Palgrave Macmillan, 2024, 188 p.
This work in two parts examines the relations between transnational societies and states. The second volume of this work contends that current policies meant to control or enhance transnational flows have led to the emergence of a transnational policy apparatus coined the transnational state. This book proposes an innovative conceptual framework to grasp the transformations of the contemporary state in both sending and receiving countries. It shows how states expand beyond national territorial limits by reaching out to migrants where they are. In response to the migrants’ endeavours to circumvent the constrains imposed by selective migration policies, public authorities expand the reach of their control beyond (externalisation), within (internalisation) and at (expansion) borders. A totalitarian temptation seems to have seized contemporary state bureaucracies, affecting the very nature of borders and societies. The core argument of this research is that the development of the transnational state is not random. It is a process shaping and shaped by the structures of the transnational society.
Autour de la publication - 03/06/2024
Entretiens du CERI
03 juin 2024
What is the Transnational State?
Interview with Thomas Lacroix, by Miriam Périer
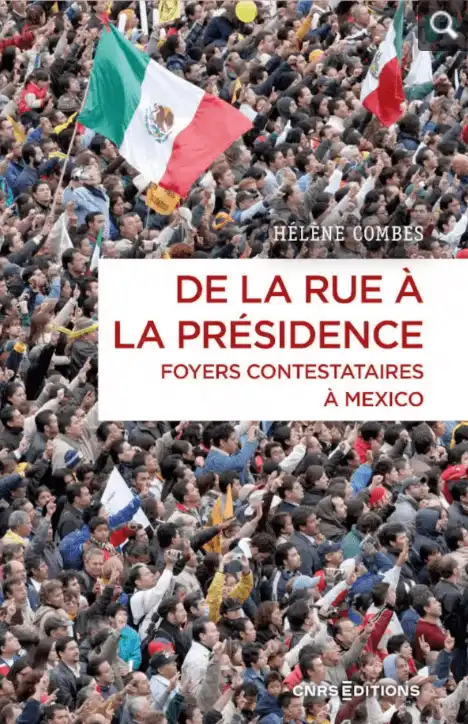
Hélène Combes
De la rue à la présidence. Foyers contestataires à Mexico
Paris, CNRS Éditions, 2024, 328 p.
De Maïdan à Nuit debout, les années 2010 ont été secouées par les mouvements d’occupation de l’espace public. Tous ont suscité une même question sur leurs débouchés politiques concrets. À cet égard, le cas du Mexique apporte un décalage éclairant. La contestation du résultat des élections présidentielles de 2006 donne en effet lieu à un vaste campement contestataire installé au cœur de Mexico durant 48 jours, initiant une dynamique qui débouche, douze ans plus tard, sur l’accession au pouvoir d’Andrés Manuel López Obrador. Année après année, Hélène Combes a suivi nombre de protagonistes de ce mouvement. Son enquête revient sur les principales étapes de sa structuration – du tour du Mexique entrepris par Obrador à la création du parti Morena, en passant par la constitution de brigades de militantes ou la mise sur pied d’un journal. En retraçant les trajectoires politiques et sociales de quatre protagonistes, représentatifs de différents foyers de contestation au sein d’une des plus grandes villes du monde, elle met en lumière les modalités de mobilisation croisant classes, genres, territoires et structuration du champ politique
Autour de la publication - 21/05/2024
Entretiens du CERI
21 mai 2024
« De la rue à la présidence ». Retour sur une enquête de long cours à Mexico
Entretien avec Hélène Combes, par Corinne Deloy
27 mai 2024
From the Streets to the Presidency: A Review of a Long-Term Study in Mexico
Interview with Hélène Combes, by Corinne Deloy
Podcast
30 mai 2024
Mexique : élections 2024
Intervenants : Hélène Combes et David Recondo. Modérateur : Olivier Dabène
Médias
28 septembre 2024
Mexique: de AMLO à Sheinbaum, ou l'incroyable mobilisation de la gauche
Entretien avec Hélène Combes, par Achim Lippold, RFI
12 juin 2024
« De la rue à la présidence. Foyers contestataires à Mexico » : retour sur l’ascension politique d’Andres Manuel Lopez Obrador, dit « AMLO »
Recension d'Anne Vigna, Le Monde (abonnés)
08 juin 2024
Mexique politique : de la rue aux urnes
Débat avec Hélène Combes, par Sylvain Bourmeau, France Culture
06 juin 2024
Au Mexique, l’élection de la présidente de gauche Claudia Sheinbaum est « la victoire de trente ans d’implantation dans les quartiers populaires »
Entretien avec Hélène Combes, par Mathieu Dejean, Mediapart (abonnés)
03 juin 2024
Au Mexique, la tâche de la nouvelle présidente est « absolument titanesque »
Entretien avec Hélène Combes, RFI
Présidentielle au Mexique : « Ce n’est pas une surprise qu’une femme devienne présidente »
Entretien avec Hélène Combes, par Richard Godin, Le Nouvel Obs
02 juin 2024
"La violence a pris une ampleur sans précédent au Mexique"
Entretien avec Hélène Combes, par Achren Verdian, France 24
30 mai 2024
Mexique : de la mobilisation de la société civile à la victoire de la gauche
Hélène Combes, The Conversation
27 mai 2024
Élections : le social au cœur de la campagne
Débat avec Hélène Combes, par Julie Gacon, France Culture
26 mai 2024
Mexique, un État nord-américain ?
Débat avec Hélène Combes, par Marie-France Chatin, RFI
25 mai 2024
Mexique : Claudia Sheinbaum, probable successeur au président sortant Lopez Obrador
Débat avec Hélène Combes, par Marie-France Chatin, RFI
Recensions
22 mai 2025
Combes (Hélène) – De la rue à la présidence. Foyers contestataires à Mexico, Paris, CNRS Éditions, 2024. 322 p.
Héloïse Nez, Revue française de science politique
25 mars 2025
Hélène Combes (2024). De la rue à la présidence. Foyers contestataires à Mexico, París: CNRS Éditions, 322 pp.
Pierre Gaussens, Revista Mexicana De Sociología
30 janvier 2025
Hélène Combes, De la rue à la présidence. Foyers contestataires à Mexico
Margaux De Barros, Cahiers des Amériques Latines
14 novembre 2024
Mexique, classes populaires et scène politique
Christophe Patillon, Mediapart
Octobre 2024
Hélène Combes, De la rue à la présidence. Foyers contestataires à Mexico
Nathalie Ludec, IdeAs
Août 2024
Les livres du mois
Christophe Ventura, Le Monde diplomatique
12 juin 2024
« De la rue à la présidence. Foyers contestataires à Mexico » : retour sur l’ascension politique d’Andres Manuel Lopez Obrador, dit « AMLO »
Anne Vigna, Le Monde (abonnés)
Extrait de l'ouvrage
Lire l'introduction
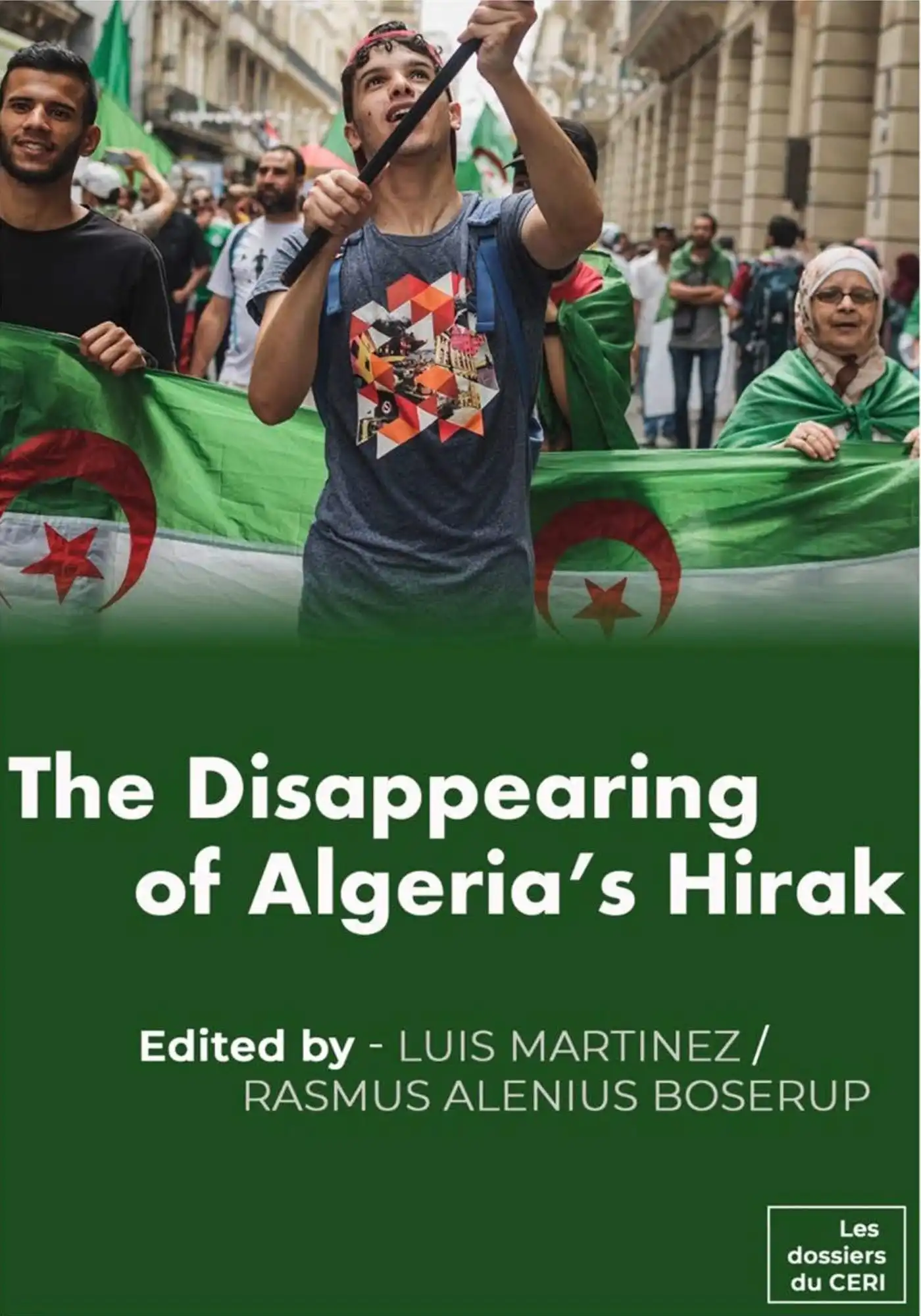
Luis Martinez & Rasmus Alenius Boserup (dir.)
The Disappearing of Algeria’s Hirak
Paris, Centre de recherches internationales (CERI), 2024, 191 p.
Ten years after the “Arab Uprisings”, a peaceful mass protest movement abruptly emerged in Algeria. In an astonishing show of force, the so-called Hirak exponentially grew from a few thousand protesters in the capital in early February 2019 to hundreds of thousands of protesters in all major Algerian cities. Inspired by the peaceful regime changes in Tunisia in 2011 and in Sudan after the dismissal of Omar el-Bashir in 2019, the protestors called for a regime change and for an establishment of a democratic system based on the rule of law. With the Hirak, Algeria’s civil society demonstrated remarkable energy and creativity, both online and in the streets. Actors from civil society including judges, feminists, artists, journalists, independent trade unionists, and academics worked together to create a powerful political dynamic. This dynamic was not matched by capable politicians, however. And as the movement failed to transform itself into a formal political actor, the existing state elites—and in particular the military establishment—came to dominate the political scene. Through six thought-provoking contributions, this new Dossier du CERI gathers specialists of Algerian politics, economy, military, media and society to explore what we have called The Disappearing of the Algerian Hirak
Autour de la publication - 01/05/2024
Open Access
Lire l'ouvrage en accès libre - format epub
Lire l'ouvrage en accès libre - format pdf
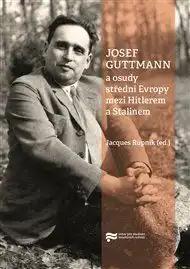
Jacques Rupnik (dir.)
Josef Guttmann a osudy střední Evropy mezi Hitlerem a Stalinem
Prague, Ústav pro studium totalitních režimů, 2023.
Dva životy, dvě jména, dva pohledy na sovětský komunismus a jeho poválečnou expanzi do východní Evropy. Zdají se úhledně oddělené, a přesto je spojuje zkušenost jednoho člověka a jeho snaha pochopit naděje a tragédie 20. století. Levicový intelektuál Josef Guttmann se na počátku třicátých let 20. století stal členem vedení Komunistické strany Československa. Se stranou se rozešel kvůli strategii Kominterny, která v roce 1933 pomohla Hitlerovi k moci. Z ostrého kritika Stalinovy diktatury i jeho zahraniční politiky se stal význačný levicový oponent. Československo opustil koncem roku 1938 a o tři roky později se usadil v New Yorku, kde pod pseudonymem působil jako přední znalec dění v sovětském bloku a kritik totalitarismu. Byl také autorem prvních článků o antisemitském charakteru procesu s Rudolfem Slánským. Jeho české texty z třicátých let spolu se studiemi a eseji o povaze komunistických režimů, genocidě a antisemitismu psanými již ve Spojených státech vycházejí u nás poprvé.
Autour de la publication - 03/04/2024
Podcast
03 avril 2024
Hledání Josefa Guttmanna
Interview with Jacques Rupnik, by Martin Groman and Michal Stehlík, Přepište dějiny
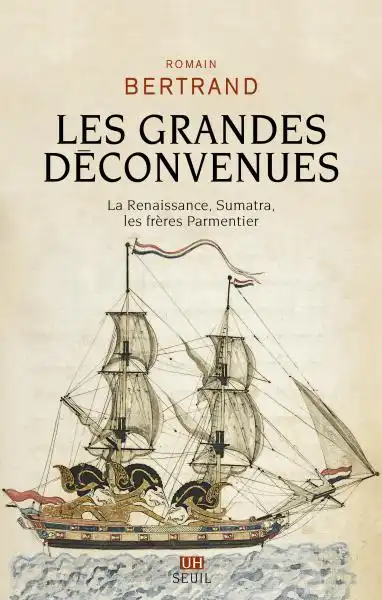
Romain Bertrand
Les Grandes Déconvenues. La Renaissance, Sumatra, les frères Parmentier
Paris, Seuil (L'Univers historique), 2024, 384 p.
On dit que la France, au XVIe siècle, a manqué son rendez-vous avec le Monde, puisqu’elle n’aurait pris aucune part à l’épopée de l’exploration des sociétés lointaines – flirtant avec le Brésil, mais boudant l’Asie. Pourtant, deux capitaines dieppois, Jean et Raoul Parmentier, conduisent jusqu’à l’île de Sumatra, en 1529, deux nefs de fort tonnage. Ils en ramènent des plaies, des bosses et un peu de poivre. Aujourd’hui oubliée, leur navigation fut érigée au XIXe siècle en preuve incontestable d’une contribution française glorieuse à la geste des Grandes découvertes. C’est toute la Renaissance occidentale qui aurait débarqué, sous pavillon tricolore, en Insulinde. La fable est flatteuse pour l’idée que nous nous sommes longtemps faite de nous-mêmes comme de pionniers, voire de missionnaires de la « modernité ». Il n’est pas certain qu’elle résiste à l’examen. Menée en archives et dans les méandres des chroniques, l’enquête oblige à s’intéresser d’un même mouvement au monde des marins normands et à celui des négociants malais, à la cour de François Ier et à celle du sultan de Tiku, à la poésie mariale du « Puy » de Rouen et à celle des maîtres de mystique musulmans. Ce qui se joue alors le long du troisième parallèle, lorsque les Dieppois font relâche à Sumatra, ne se comprend qu’à condition de rouvrir les portes de la comparaison – entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est aussi bien qu’entre le savoir des « gens de mer » et celui des érudits. En nous aidant à contempler, défardées, nos grandes déconvenues, cette traversée nous invite à penser la « modernité » au pluriel et la Renaissance au conditionnel.
Autour de la publication - 10/07/2024
Entretiens du CERI
10 septembre 2024
Sixteenth Century Expeditions and Modernity
Interview with Romain Bertrand, by Josefina Gubbins
10 juillet 2024
Repenser la modernité pluriel
Entretien avec Romain Bertrand, par Josefina Gubbins
Podcast
10 avril 2024
La Renaissance, Sumatra, les frères Parmentier
Entretien avec Romain Bertrand, par Luc Daireaux, Chemins d'histoire
Recension
4 mars 2024
21 livres à lire en mars 2024
Florian Louis, Le Grand Continent
Extrait de l'ouvrage
Lire l'extrait
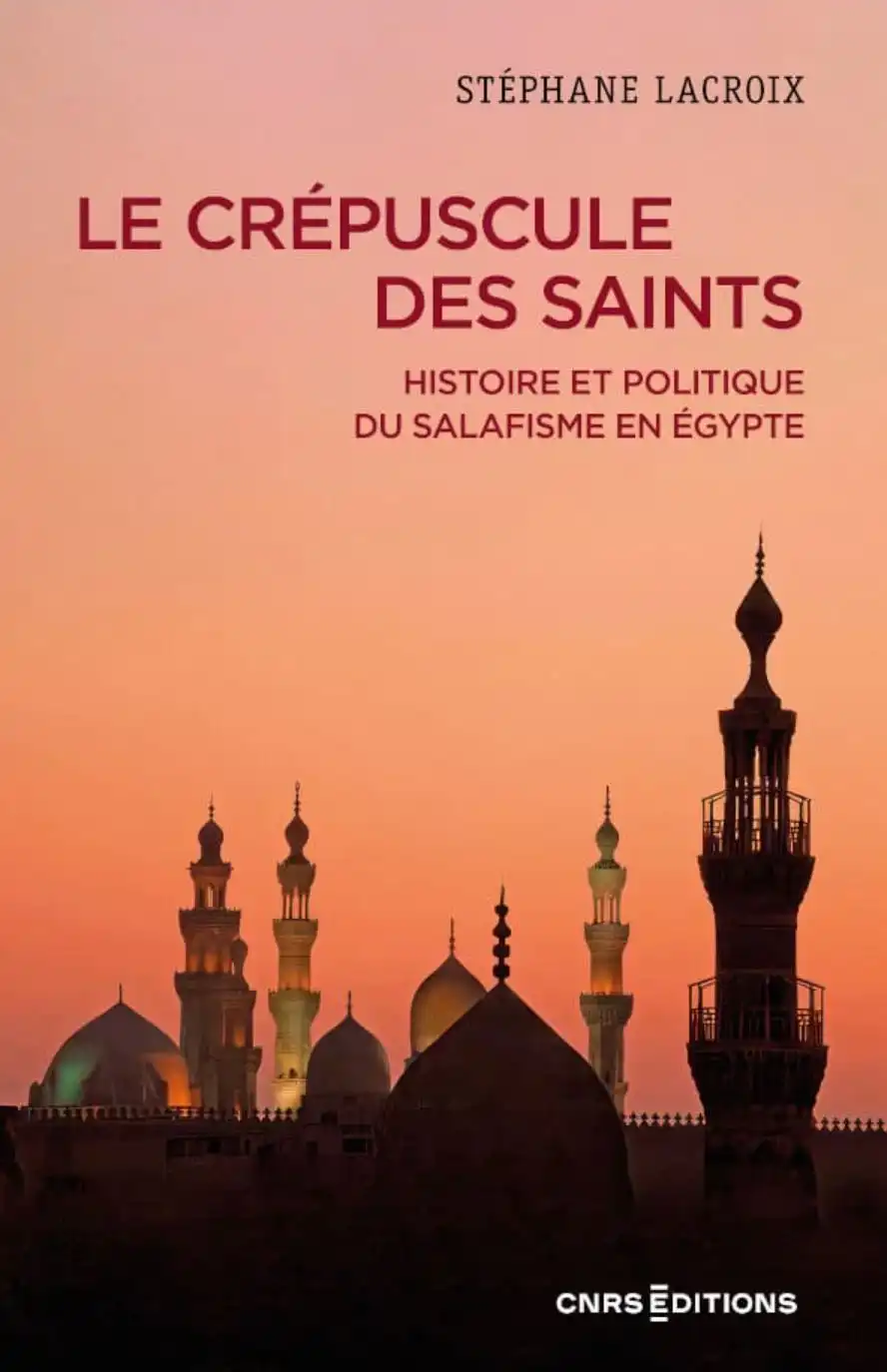
Stéphane Lacroix
Le crépuscule des Saints. Histoire et politique du salafisme en Égypte
Paris, CNRS Éditions, 2024, 424 p.
Qu’est-ce que le salafisme ? Et comment ce mouvement ultraconservateur a-t-il gagné en influence pour se placer au cœur de la normativité islamique sunnite ? Quel rapport entretient-il avec le politique ? Et pourquoi est-il important, pour en déchiffrer les évolutions, de le distinguer des Frères musulmans ? Stéphane Lacroix nous invite à démêler ces questions dans cette socio-histoire du salafisme égyptien. Issu d’une enquête menée en Égypte à partir de 2010, avant, pendant et après la révolution ayant mené à la chute de Moubarak et l’arrivée au pouvoir de l’islam politique, cet ouvrage retrace l’histoire de ce mouvement et de ses acteurs. Il nous introduit à la grammaire d’action des salafistes et analyse les mutations qu’a connues l’islam égyptien tout au long du XXe siècle, et jusqu’à très récemment. Loin de constituer une idéologie immuable, le salafisme est lui-même sorti transformé de ce processus, au point de devenir un acteur central de la transition démocratique avortée de 2011. Une contribution majeure à l’étude des transformations de l’islam et de son rapport au politique à l’époque contemporaine.
Autour de la publication - 23/04/2024
Entretiens du CERI
23 avril 2024
The Rise, Politicisation and Decline of Egyptian Salafism
Interview with Stéphane Lacroix, by Corinne Deloy
20 mars 2024
Essor, politisation(s) et reflux du salafisme égyptien
Entretien avec Stéphane Lacroix, par Corinne Deloy
Recension
20 février 2024
Ambivalences du salafisme en Égypte
Thibaud Laval, Orient XXI
Médias
11 février 2024
En Égypte et ailleurs, les multiples visages du salafisme
Stéphane Lacroix, The Conversation
Janvier-février 2024
En quête de politique - L'islamisme
Série en quatre épisodes avec Stéphane Lacroix, par Thomas Legrand, France Inter

David Recondo (dir.)
Amérique latine. L'année politique 2023
Les Études du CERI, n°271-272, janvier 2024.
Amérique latine. L’Année politique 2023 est une publication de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes (Opalc) du CERI-Sciences Po. Il prolonge la démarche du site www.sciencespo.fr/opalc en offrant des clés de compréhension d’un continent en proie à des transformations profondes. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site.
Autour de la publication - 25/03/2024
Entretiens du CERI
25 mars 2024
Latin American Politics in 2023. Democracy, Authoritarianism and Hope for Change?
Interview with David Recondo, by Corinne Deloy
02 février 2024
Amérique latine en 2023 : gouvernants à la peine et victoire de candidats de rupture, sur fond de violence et de saignée migratoire
Entretien avec David Recondo, par Corinne Deloy
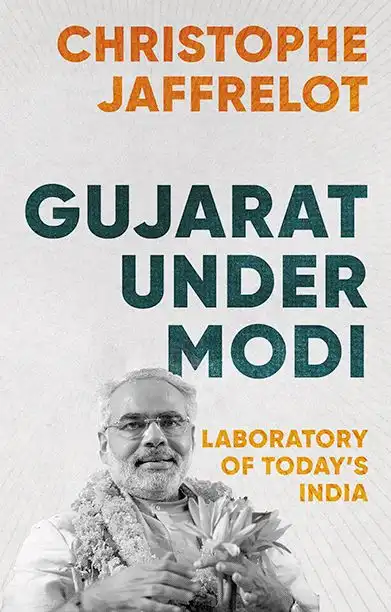
Christophe Jaffrelot
Gujarat Under Modi. Laboratory of Today's India
London, Hurst, 2024, 416 p.
In 2012 Narendra Modi became the first Hindu nationalist politician thrice elected to lead a state of the Indian Union, his stewardship as Chief Minister of Gujarat being the longest in that state’s history. Modi and his BJP supporters explained his achievement by pointing to economic growth under his leadership, yet detractors point out that Modi has been more business-friendly than market-friendly—to the benefit of large industrial corporations, and at the cost of great social polarisation. In 2002, an anti-Muslim pogrom of unparalleled ferocity occurred in Gujarat, leading to the biggest number of Muslim deaths since Partition. The state’s Hindu majority immediately rallied around Modi. No serious riot has occurred in Gujarat since, but polarisation was key to Modi’s strategy there, and he has deployed that strategy again and again since he became Prime Minister of India in 2014. For Modi has cultivated a communal image. A marketing genius, his messaging combines the politics of Hindutva with economic modernisation, to the clear appreciation of Gujarat’s middle class. Christophe Jaffrelot’s revealing book shows how Modi’s Gujarat served as the laboratory of Modi’s India, not only in terms of Hindu majoritarianism and national populism, but also of caste and class politics.
Autour de la publication - 19/03/2024
Médias
13 février 2024
The enduring personality cult of Narendra Modi
Book's extract, Himal Southasian
Vidéos
22 mai 2024
[Book Talk] “Gujarat Under Modi: Laboratory of Today's India”
Interview with Christophe Jaffrelot by Ingrid Therwath, Asia Society
24 février 2024
Modi is India’s Most Powerful PM Ever But the Divisions He Has Caused Are Very Worrying
Interview with Christophe Jaffrelot by Karan Thapar, The Wire
Entretiens du CERI
19 mars 2024
Modi’s Strategy, Rise, and Rule, from Gujarat to the Indian Nation State.
Interview with Christophe Jaffrelot, by Miriam Périer
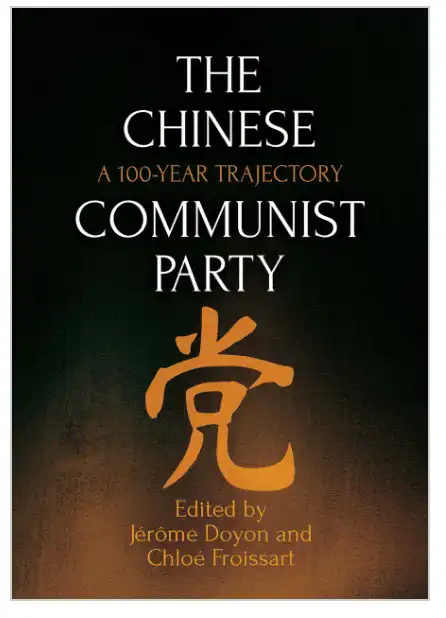
Jérôme Doyon et Chloé Froissart
The Chinese Communist Party. A 100-Year Trajectory
Canberra, ANU Press, 2024, 454 p.
This volume brings together an international team of prominent scholars from a range of disciplines, with the aim of investigating the many facets of the Chinese Communist Party’s 100-year trajectory. It combines a level of historical depth mostly found in single-authored monographs with the thematic and disciplinary breadth of an edited volume. This work stands out for its long-term and multiscale approach, offering complex and nuanced insights, eschewing any Party grand narrative, and unravelling underlying trends and logics, composed of adaption but also contradictions, resistance and sometimes setbacks, that may be overlooked when focusing on the short term. Rather than putting forward an overall argument about the nature of the Party, the many perspectives presented in this volume highlight the complex internal dynamics of the Party, the diversity of its roles in relation to the state, as well as in its interaction with society beyond the state. Our historical approach stresses impermanence beyond the apparent permanence of the Party’s organisation and ideology while also bringing to light the recycling of past practices and strategies. Looking at the Party’s evolution over time shows how its founding structures and objectives have had a long-lasting impact as well as how they have been tweaked and rearranged to adapt to the new economic and social environment the Party contributed to creating.
Autour de la publication - 12/03/2024
Open access
Lire l'ouvrage en accès ouvert
Entretiens du CERI
12 mars 2024
Looking through 100 years of the Chinese Communist Party
Interview with Jérôme Doyon and Chloé Froissart, by Miriam Périer

Centre de recherches internationales
Déchiffrer 2024
Alternatives Économiques, hors-série n°128, janvier 2024.
Déchiffrer 2024, c'est le hors-série de référence d'Alternatives Economiques pour décrypter les grands enjeux de l'année, avec les analyses des meilleurs experts. Cent pages pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. Déchiffrer 2024, ce sont aussi 50 cartes et infographies. Tous les chiffres clés de l’année, mis en scène de façon pédagogique et graphique, et 4 pages de tableaux d’indicateurs pour retrouver facilement les dernières données économiques, sociales et environnementales.
Autour de la publication - 27/02/2024
Podcast
27 février 2024
Ukraine, deux ans après l'envoi des forces armées russes à Kiev
Conférence débat organisée à l'occasion de la parution du hors-série Déchiffrer 2024 de la revue Alternatives Economiques dont le dossier spécial Ukraine est réalisé en partenariat avec Le CERI.
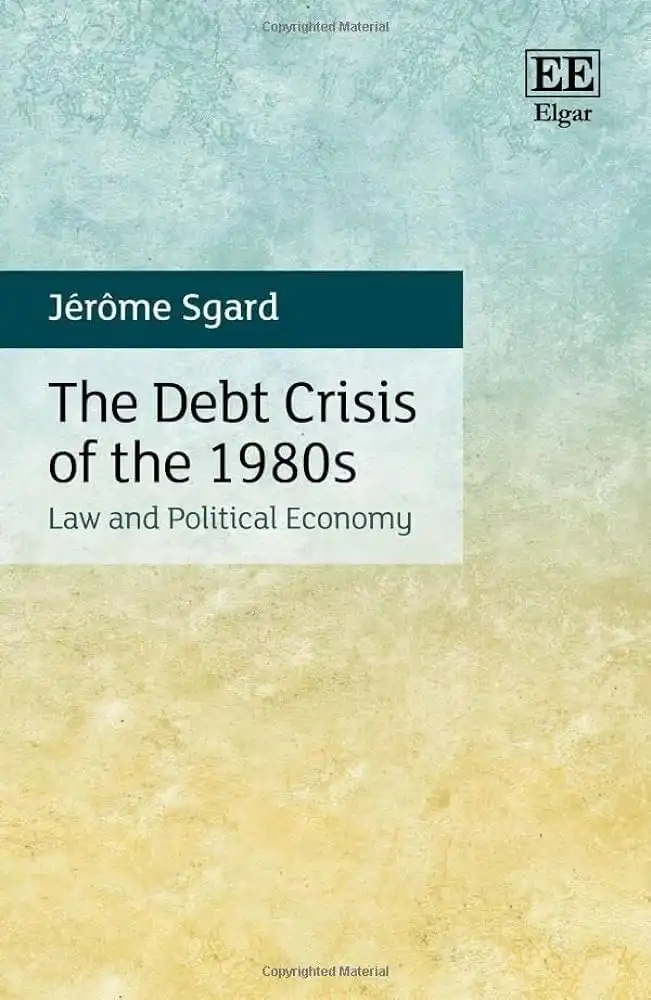
Jérôme Sgard
The Debt Crisis of the 1980s. Law and Political Economy
Edward Elgar Publishing, 2023, 354 p.
This book offers a novel account of the significant debt crisis which hit many developing countries during the 1980s. It starts with the flawed cycle of bank lending during the 1970s, and then moves from the opening act, in Mexico in 1982, until a solution was found with the 1989 Brady Initiative. The Debt Crisis of the 1980s also articulates closely the economic and financial dimensions alongside the political and multilateral ones. The key relation between debtor countries and the IMF is explored in detail, but the book also documents the tense and often coercive interactions with commercial banks as well as on the continuing resistance to the IMF-led strategy among G7 governments. How debt contracts were restructured during all those years helps understanding how the Brady Initiative worked in practice, and how it prepared the ground for the turn to global markets after 1990. This debt crisis was indeed one of the main incubators of globalisation. This underlines further its unique character in the long-run history of sovereign debts, before and after the 1980s. Remarkably, this book rests on in-depth interviews with the key players. Transcripts are included for the six most important players, including the former heads of the US Federal Reserve and the IMF. Archives from the IMF, the New York Federal Reserve, the Bank of England and commercial banks have also been systematically exploited, often for the first time ever.
Autour de la publication - 26/02/2024
Entretiens du CERI
26 février 2024
"The 1980s debt crisis, an incinerator of past policies & an incubator of the global turn?
Interview with Jérôme Sgard by Miriam Périer
Podcasts
10 avril 2024
1982: the debt crisis that could have destroyed Western banking. What we can learn from four decades of financial turmoil and recovery
Institut Brueghel, Bruxelles
08 avril 2024
Lessons from the 1980s Debt Crisis
Clauses & Controversies, par Mitu Gulati et Mark Weidemaier
Textes en accès ouvert
21 novembre 2023
Chronology
Introduction: the 1980s debt crisis in historical perspective
Chapter 1: Inventing conditionality, exploring its politics (1946-1958)
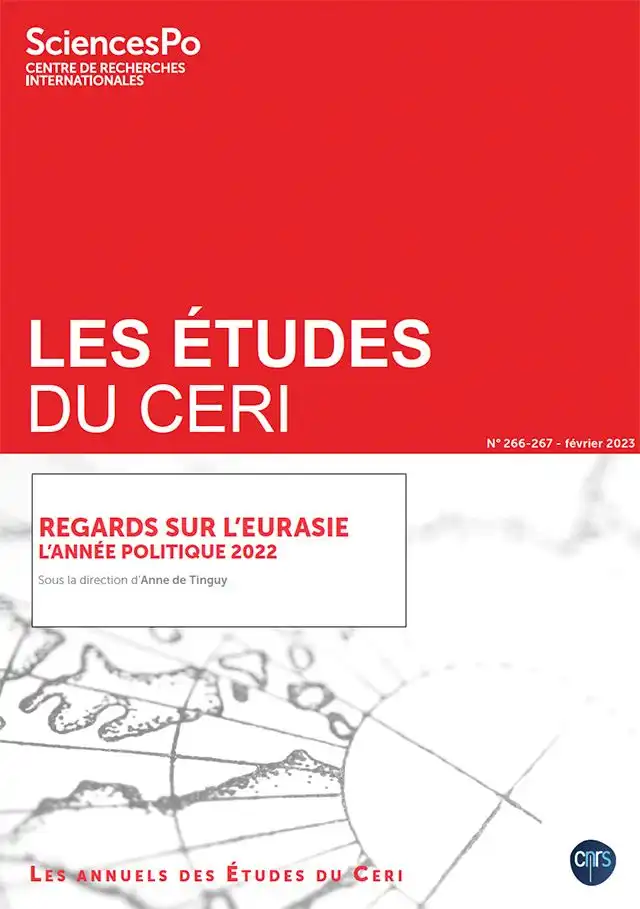
Anne de Tinguy (dir)
Regards sur l'Eurasie - L'année politique 2023
Les Études du CERI, n°273-274, février 2024.
Regards sur l’Eurasie. L’année politique est une publication annuelle du Centre de recherches internationales de Sciences Po (CERI) dirigée par Anne de Tinguy. Elle propose des clefs de compréhension des événements et des phénomènes qui marquent de leur empreinte les évolutions d’une région, l’espace postsoviétique, en profonde mutation depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Forte d’une approche transversale qui ne prétend nullement à l’exhaustivité, elle vise à identifier les grands facteurs explicatifs, les dynamiques régionales et les enjeux sous-jacents.
Autour de la publication - 22/02/2024
Podcast
26 février 2024
L'Eurasie à l'épreuve d'une guerre longue en Ukraine
Conférence organisée à l’occasion de la publication de Regards sur l’Eurasie. L'année politique 2023
Entretiens du CERI
02 février 2024
"Le choc d'une guerre longue en Ukraine : Le temps joue-t-il vraiment en faveur de la Russie?"
Entretien avec Anne de Tinguy, par Corinne Deloy
02 février 2024
"Les États d'Asie Centrale face aux turbulences du monde"
Entretien avec Bayram Balci, par Corinne Deloy
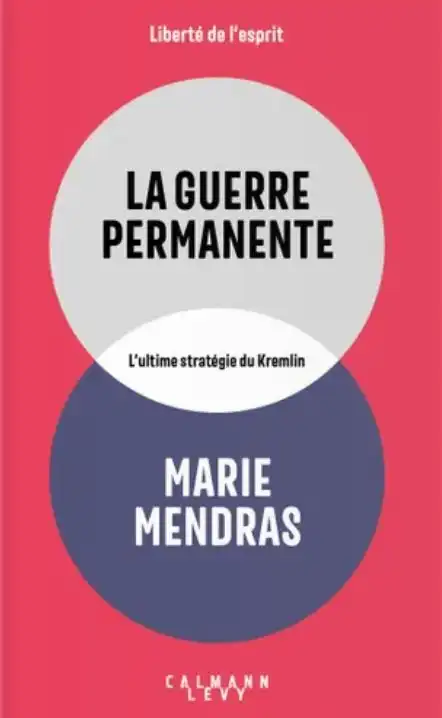
Marie Mendras
La guerre permanente - Ultime stratégie du Kremlin
Paris, Calmann-Lévy, 2024, 350 p.
Vladimir Poutine livre en Ukraine une cinquième guerre depuis 1999, après la Tchétchénie, la Géorgie, le Donbass et la Syrie. Jamais la Russie n’a réellement été menacée par ceux qu’elle attaquait, il lui a fallu trouver des prétextes : protéger des « russophones en danger », lutter contre le terrorisme, « dénazifier l’Ukraine ». Ce que craint Poutine plus que tout, c’est la démocratisation des anciennes républiques soviétiques et leur émancipation de la tutelle d’un État russe prédateur. Pour assurer la survie de son pouvoir, il mène une guerre de destruction et sacrifie les soldats russes en grand nombre. Mais il n’avait anticipé ni la résistance des Ukrainiens ni le soutien des pays occidentaux. La guerre permanente n’a fait qu’accentuer la répression à l’intérieur et fragiliser la Russie à l’extérieur. En livrant à l’Ukraine une guerre ingagnable, Poutine enferme les Russes dans une confrontation majeure avec l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon, et entraîne son pays vers l’abîme.
Autour de la publication - 19/02/2024
Introduction
Lire l'introduction
Entretiens du CERI
12 mars 2024
Poutine en guerre permanente, contre tous
Entretien avec Marie Mendras, par Corinne Deloy
Podcast
29 février 2024
La guerre permanente. Pourquoi Vladimir Poutine préfère la guerre à la paix
Conférence débat organisée à l'occasion de la parution de l'ouvrage
Médias
26 février 2024
"Vladimir Poutine a peur de tout le monde, comme tous les grands paranoïaques"
Entretien avec Marie Mendras, par Pauline Godart, France 24
19 février 2024
Qui peut arrêter Vladimir Poutine ?
Débat avec Marie Mendras, par Elisabeth Quin, Arte

Jean-Pierre Filiu
Comment la Palestine fut perdue
Et pourquoi Israël n'a pas gagné. Histoire d'un conflit (XIXe-XXIe siècle)
Paris, Seuil, 2024, 432 p.
Si vous estimez connaître assez du conflit israélo-palestinien pour en nourrir des opinions définitives, mieux vaut ne pas ouvrir ce livre. Vous risqueriez d’y apprendre que le sionisme fut très longtemps chrétien avant que d’être juif. Et que l’évangélisme anglo-saxon explique beaucoup plus qu’un fantasmatique « lobby juif » le soutien déterminant de la Grande-Bretagne, puis des États-Unis à la colonisation de la Palestine. Vous pourriez aussi découvrir que la soi-disant « solidarité arabe » avec la Palestine a justifié les rivalités entre régimes pour accaparer cette cause symbolique, quitte à massacrer les Palestiniens qui résistaient à de telles manoeuvres. Ou que la dynamique factionnelle a, dès l’origine, miné et affaibli le nationalisme palestinien, culminant avec la polarisation actuelle entre le Fatah de Ramallah et le Hamas de Gaza. La persistance de l’injustice faite au peuple palestinien n’a pas peu contribué à l’ensauvagement du monde actuel, à la militarisation des relations internationales et au naufrage de l’ONU, paralysée par Washington au profit d’Israël durant des décennies, bien avant de l’être par Moscou sur la Syrie, puis sur l’Ukraine. L’illusion qu’un tel déni pouvait perdurer indéfiniment a volé en éclat dans l’horreur de la confrontation actuelle, d’autant plus tragique qu’aucune solution militaire ne peut être apportée au défi de deux peuples vivant ensemble sur la même terre. Comprendre comment la Palestine fut perdue, et pourquoi Israël n’a pourtant pas gagné, participe dès lors d’une réflexion ouverte sur l’impératif d’une paix enfin durable au Moyen-Orient et, donc, sur le devenir de ce nouveau millénaire.
Autour de la publication - 06/02/2024
Médias
19 février 2024
Guerre Israël-Hamas : l’abandon de Gaza ?
Entretien avec Jean-Pierre Filiu, par Quentin Lafay, France Culture
13 février 2024
Guerre Israël-Hamas : l’offensive israélienne sur Rafah alarme la communauté internationale
Entretien avec Jean-Pierre Filiu, par Anne-Elisabeth Lemoine, France 5
Comment mettre un terme à la guerre au Proche-Orient ?
Débat avec Jean-Pierre Filiu, par Patrick Saint-Paul, Le Figaro
12 février 2024
Israël/Hamas : une guerre sans fin ?
Débat avec Jean-Pierre Filiu, par Thomas Hugues, Public Sénat
08 février 2024
« Israël est en train de détruire Gaza sans détruire le Hamas »
Entretien avec Jean-Pierre Filiu, par Mathieu Magnaudeix, Mediapart
06 février 2024
L'invité de 8h20 : le grand entretien
Entretien avec Jean-Pierre Filiu, par Nicolas Demorand et Léa Salamé, France Inter
29 novembre 2023
Israël-Palestine : Les Palestiniens
Série d'entretiens avec Jean-Pierre Filiu, par Thomas Snégaroff, France Inter
Extrait de l'ouvrage
Février 2024
Lire l'extrait
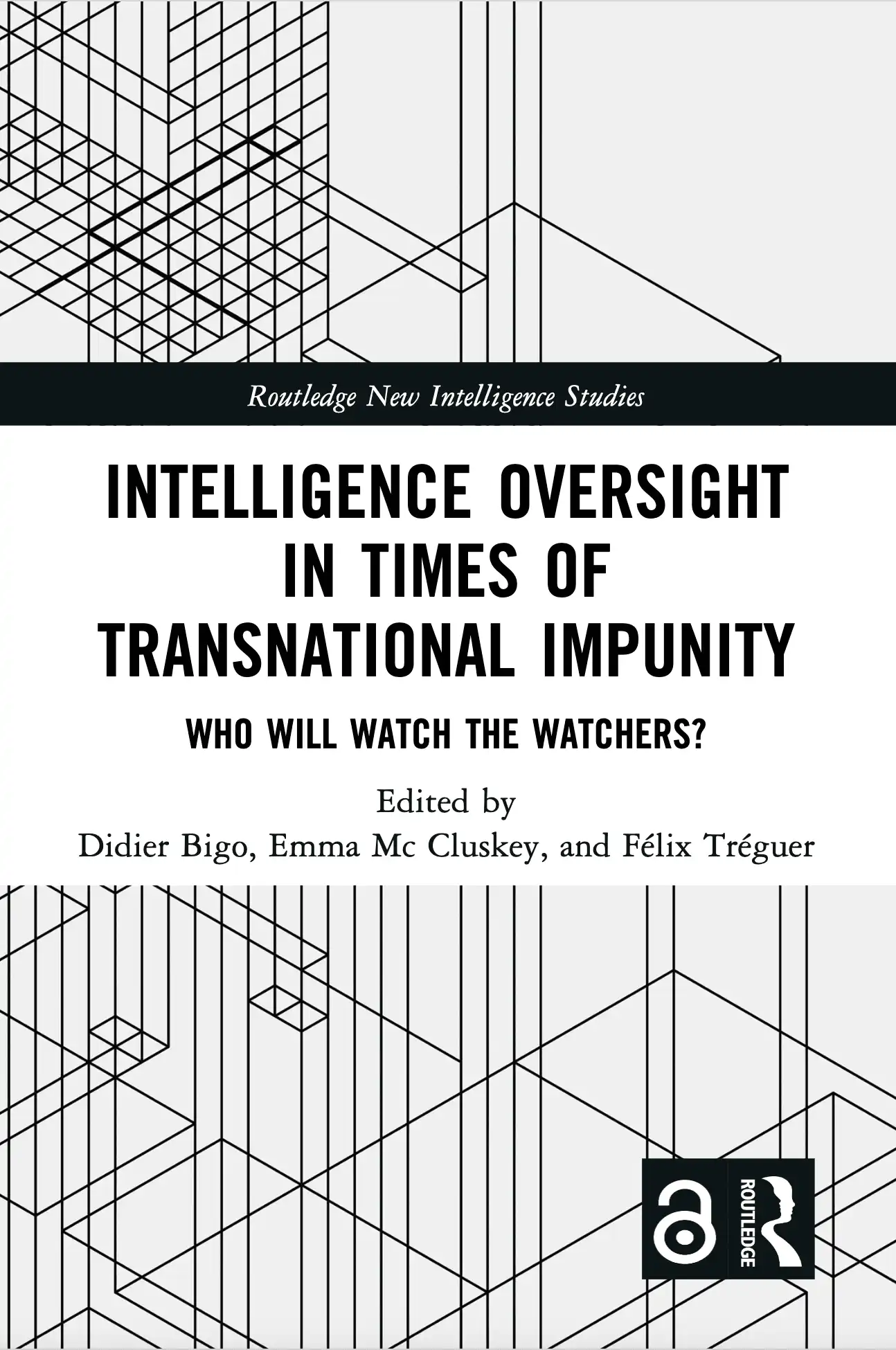
Didier Bigo, Emma Mc Cluskey, Félix Tréguer
Intelligence Oversight in Times of Transnational Impunity
New Intelligence Studies, New York, Routledge, 2023, 311 p.
This book adopts a critical lens to look at the workings of Western intelligence and intelligence oversight over time and space. Largely confined to the sub-field of intelligence studies, scholarly engagements with intelligence oversight have typically downplayed the violence carried out by secretive agencies. These studies have often served to justify weak oversight structures and promoted only marginal adaptations of policy frameworks in the wake of intelligence scandals. The essays gathered in this volume challenge the prevailing doxa in the academic field, adopting a critical lens to look at the workings of intelligence oversight in Europe and North America. Through chapters spanning across multiple disciplines – political sociology, history, and law – the book aims to recast intelligence oversight as acting in symbiosis with the legitimisation of the state’s secret violence and the enactment of impunity, showing how intelligence actors practically navigate the legal and political constraints created by oversight frameworks and practices, for instance by developing transnational networks of interdependence. The book also explores inventive legal steps and human rights mechanisms aimed at bridging some of the most serious gaps in existing frameworks, drawing inspiration from recent policy developments in the international struggle against torture. This book will be of much interest to students of intelligence studies, sociology, security studies, and international relations.
Autour de la publication - 22/01/2024
Entretiens du CERI
22 janvier 2024
Intelligence Agencies: Never Accountable?
Interview with Didier Bigo, Emma Mc Cluskey & Félix Tréguer, by Miriam Périer
Open Access
Janvier 2024
Ouvrage complet disponible en Open Access
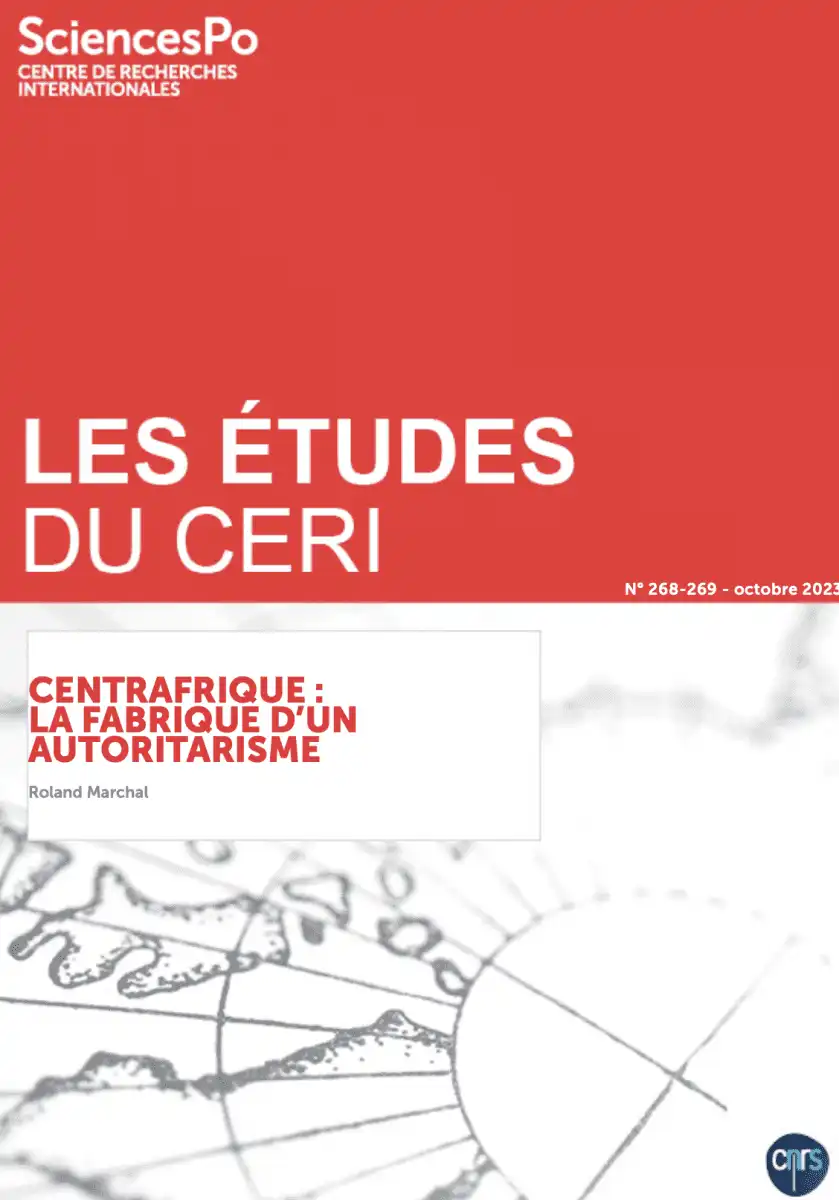
Roland Marchal
Centrafrique : la fabrique d'un autoritarisme
Les Études du CERI, n°268-269, octobre 2023, 68 p.
Ce texte analyse les conditions dans lesquelles la Centrafrique, un Etat déliquescent au sortir d’une crise existentielle, sait jouer de ses propres faiblesses et d’une configuration régionale et internationale particulière pour aujourd’hui contraindre le champ politique et terroriser sa propre population en construisant un ennemi forcément étranger et en instrumentalisant la Russie pour sa pérennisation. Les moyens et techniques de coercition sont d’une grande modernité, même s’ils s’appuient sur un répertoire de pratiques coercitives déjà bien rodées en Afrique centrale. La fabrique d’un tel autoritarisme s’appuie sur la construction d’une menace particulière (des groupes armés transnationaux), une communauté internationale atone qui s’épuise à mettre en œuvre des solutions éculées et une offre de sécurité qui renvoie le maintien de la paix onusien ou la mission de formation européenne à la marge : l’implication militaire russe mais aussi rwandaise traduit une volonté de mettre hors jeu une gestion régionale et internationale de la crise qui a échoué, tout en reconduisant une économie concessionnaire dans le domaine minier et agricole, dont les premiers bénéficiaires restent les gouvernants à Bangui.
Autour de la publication - 17/01/2024
ENTRETIENS du CERI
17 janvier 2024
Centrafrique: la fabrique d'un autoritarisme
Entretien avec Roland Marchal, par Corinne Deloy
23 janvier 2024
A New Authoritarianism in the Central African Republic?
Interview with Roland Marchal, by Corinne Deloy

Gilles Favarel Garrigues et Laurent Gayer
Proud to Punish. The Global Landscape of Rough Justice
Palo Alto, Stanford University Press, 2024, 234 p. Traduis par Cynthia Schoch et Trista Selous
A magisterial comparative study, Proud to Punish recenters our understanding of modern punishment through a sweeping analysis of the global phenomenon of "rough justice": the use of force to settle accounts and enforce legal and moral norms outside the formal framework of the law. While taking many forms, including vigilantism, lynch mobs, people's courts, and death squads, all seekers of rough justice thrive on the deliberate blurring of lines between law enforcers and troublemakers. Digital networks have provided a profitable arena for vigilantes, who use social media to build a following and publicize their work, as they debase the bodies of the accused for purposes of edification and entertainment. It is this unabashed pride to punish, and the new punitive celebrations that actualize, publicize, and commercialize it, that this book brings into focus. Recounted in lively prose, Proud to Punish is both a global map of rough justice today and an insight into the deeper nature of punishment as a social and political phenomenon.
Autour de la publication - 09/01/2024
Introduction de l'ouvrage
Janvier 2024
Introduction. Breaking the Law to Maintain Order
Gilles Favarel Garrigues et Laurent Gayer
Vidéo
26 mars 2024
Le monde des justiciers hors-la-loi
Conférence de Gilles Favarel-Garrigues autour du livre, Avenue centrale. Rendez-vous en sciences humaines (MSH-Alpes)
Entretiens du CERI
10 mai 2021
La loi des justiciers. Vigilantisme et maintien de l'ordre
Entretien avec Gilles Favarel Garrigues et Laurent Gayer par Miriam Périer
06 mai 2021
Punishing with Pride. Vigilantism and Policing
Interview with Gilles Favarel Garrigues and Laurent Gayer by Miriam Périer
Valorisation autour de la version française
2021
Recensions, podcasts, articles
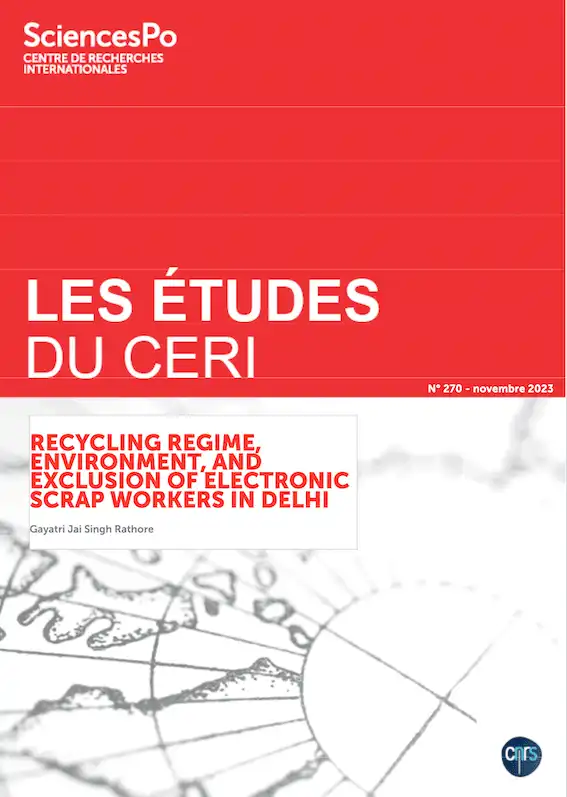
Gayatri Jai Singh Rathore
Recycling Regime, Environment, and Exclusion of Electronic Scrap Workers in Delhi
Les Études du CERI, n°270, Décembre 2023.
Le secteur indien des déchets électroniques a connu un processus de formalisation ces dernières années, grâce à la mise en œuvre de règles de gestion des déchets électroniques (2016), ce qui a conduit à la création de ce que nous appelons le « régime de recyclage ». De fait, les classes moyennes et supérieures, les ONG et les acteurs de l’industrie, qui sont les premiers à avoir réfléchi aux politiques en matière de déchets électroniques en Inde, ont été poussés par une double motivation : le désir de voir émerger une ville de « classe internationale », propre et non polluée, et la saisie d’opportunités commerciales par l’accaparement de la valeur des déchets électroniques. Ne se substituant pas à l’Etat, ces acteurs l’ont toutefois coopté afin qu’il légifère en faveur de la protection de l’environnement et qu’il s’attaque aux problèmes de toxicité et de santé liés aux déchets électroniques. Le régime de recyclage repose sur des processus de formalisation intégrés dans de multiples technologies – technicité, installations couteuses, certifications, autorisations et licences – qui fonctionnent ensemble pour exclure le secteur « informel » du système de gouvernance de ces déchets électroniques. Les technologies de recyclage agissent comme des « technologies de domination » qui contribuent à mettre à l’écart le travail « informel » des ferrailleurs ou des e-kabadis, qui se trouvent déjà en marge de la société en raison de leur appartenance à la communauté musulmane. En définitive, toutefois, le régime de recyclage ne parvient pas à protéger l’environnement car les déchets électroniques finissent par retomber dans le secteur informel par l’intermédiaire d’acteurs autorisés.
Autour de la publication - 08/01/2024
Entretiens du CERI
8 janvier 2024
Indian E-Waste Management. A Recycling Regime
Interview with Gayatri Jai Singh Rathore, by Miriam Périer
Regards sur nos publications
Au-delà de cette page
Suivez-nous
Nous contacter
Contact Média
Coralie Meyer
Tel: +33 (0)1 58 71 70 85
coralie.meyer@sciencespo.fr
Corinne Deloy
Tel: +33 (0)1 58 71 70 68
corinne.deloy@sciencespo.fr

