Accueil>L’histoire comme cause. Historicités en dispute en Afrique
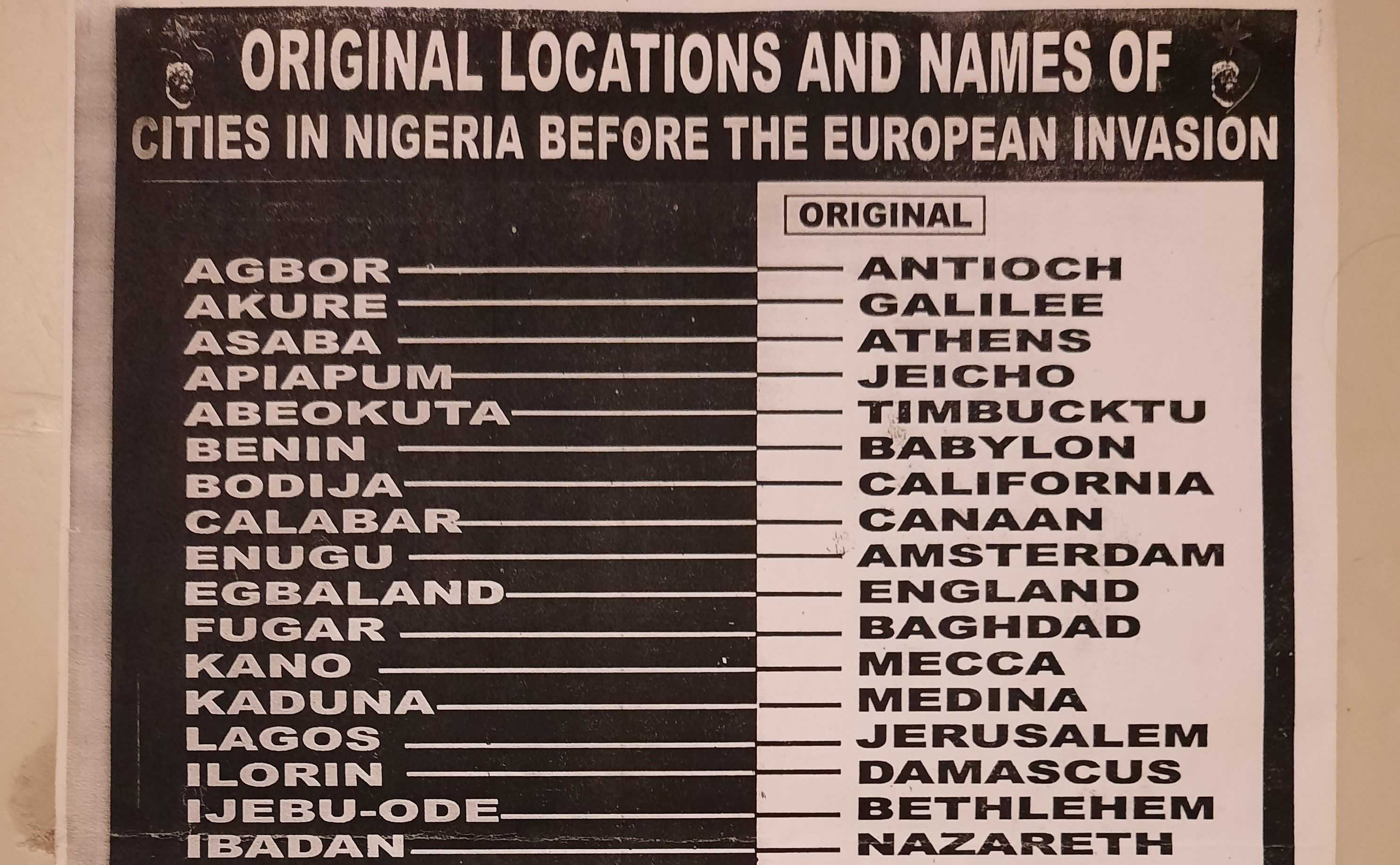
04.11.2024
L’histoire comme cause. Historicités en dispute en Afrique
À propos de cet événement
Du 04 novembre 2024 à 10:30 au 05 novembre 2024 à 10:00
Salons scientifiques
1 pl. Saint-Thomas-d'Aquin, 75007, ParisOrganisé par
Africa ProgrammeLundi 4 novembre
10h30 Introduction
Laurent Fourchard (CERI, Sciences Po) et Gregory Mann (Columbia University)
11h00-12h30 Réinterprétations contemporaines de l’histoire ancienne
Adrien Delmas (Sciences Po), La Modernité comme Moyen-Age. La construction postcoloniale de l’histoire précoloniale
Daouda Gary-Tounkara (CNRS, IMAF), Maliba, le grand Mali de la tradition orale, revisité par le rappeur Van Baxy
12h30-14h00 Déjeuner
14h- 15h30 Réécriture coloniale des histoires familiales
Pietro Repishti (Università degli Studi di Pavia), De père en fils. Politiques, transformations et traductions dans la construction d’une “histoire de Porto-Novo”
Hugo Logez (Columbia University), « Le Livre de la famille d'Oliveira ». Genealogical Writing in Colonial Ouidah
15h30-16h00 Pause
16h00-18h30 Historicités et mémoires populaires de l’esclavage
Gabriel André (CERI, Sciences Po), Des entrepreneurs d’histoire(s). Raconter et performer le passé esclavagiste au Fouta-Djallon (Guinée)
Ibrahima Thioub (Université Cheikh Anta Diop de Dakar), Mémoires populaires et esclavage en Afrique : le silence de l'historiographie africaine
Mardi 5 novembre
10h00 – 12h30 Les récits concurrents du roman national
Chloé Josse-Durand (Newcastle University), Récits pluriels et compétitions mémorielles autour de l’histoire des luttes anticoloniales au Kenya
Timothy Gibbs (Université de Nanterre), Doing history in a wounded society: The Sinomlando Centre for Memory Work and the rise of Jacob Zuma in South Africa
Elara Bertho (CNRS, LAM), Trop bien jouer les traîtres. Quelques réflexions sur des colères de Sékou Touré au sujet de pièces de théâtre historiques (Guinée, 1958-1984)
12h30-14h00 Déjeuner
14h-15h30 La biographie comme récit de la nation
Irene Bono (Università degli Studi di Torino), Conflits biographiques et récits de la nation au Maroc. Parler pour, donner la voix, parler avec
Mylkah Djacko (Columbia University) “Et moi ?” On the construction of Marie-Thérèse Houphouët-Boigny’s memory in Côte d'Ivoire
15h30-16h00 Pause
16h00-17h30 Les luttes nationalistes contre l’histoire académique
Séverine Awenengo Dalberto (CNRS, IMAF), « Comment écrire l’histoire de la Casamance ? Elle se vit, d’abord ». Archives et expériences en dispute dans l’historiographie nationaliste du MFDC (années 1980-1990)
Richard Banégas (CERI, Sciences Po) et Armando Cutolo (Università degli Studi di Siena), Politique, prophétisme et parole dans l’historicité ivoirienne
17h30-18h00 Remarques conclusives

RESUMES
Réinterprétations contemporaines de l’histoire ancienne
Adrien Delmas (Sciences Po), La Modernité comme Moyen-Age. La construction postcoloniale de l’histoire précoloniale
Dans la perspective d’étudier les phénomènes de périodisation de l’histoire africaine, ce papier interroge la construction du passé précolonial après les indépendances africaines. Quel est ce passé précolonial construit durant la période postcoloniale ? Comment ce passé est-il construit, politiquement et scientifiquement ? A quelles sources documentaires, selon quelles preuves et quelles disciplines ? Ce papier voudrait mobiliser un certain nombre de cas, aussi éloignés soient-ils - de Fanon à Mandela - mais s’arrêtera en particulier sur la réappropriation politique de la période archéologique dite du (Late) Iron Age en Afrique australe.
Daouda Gary-Tounkara (CNRS, IMAF) Maliba, le grand Mali de la tradition orale revisité par le rappeur Van Baxy
Depuis les années 2010, le Mali traverse une grave crise politique, sécuritaire et morale. Dans ce contexte troublé, les usages publics de l’histoire témoignent d’une recherche de responsabilité historique dans l’avènement de la crise, les acteurs civils, militaires et religieux se rejetant la faute de la mauvaise gestion des affaires publiques. Ces acteurs, en vue d’élargir leur base clientéliste et/ou électorale, se retrouvent dans une vision de l’histoire pré-contemporaine du Mali qui continue de glorifier les grands empires soudanais, une vision qui ne fait pas l’unanimité au sein de la nation – fortement divisée entre Bamako et le reste du pays – et qui reste passéiste. Pour une partie de la société bamakoise en général et des jeunes gens en particulier, le Mali est devenu un pays « gâté », car les anciennes générations aux postes de responsabilités (de l’Etat au chef de famille) ont tourné le dos à leur héritage socioculturel et à leur dànbé – dignité, honneur, bonne conduite en bamana ou bambara –, de sorte qu’elles ne disent plus la « vérité » et entretiennent un climat d’« impunité » et de « mauvaise gouvernance ». Dans ces conditions, comment mobiliser le passé et en tirer les leçons du passé pour pouvoir se projeter dans le futur ?
L’objet de cette communication est d’analyser les usages publics de l’histoire à Bamako à travers le parcours et la production de Van Baxy, un rappeur de culture bamana. En 2016, ce dernier reprit sur YouTube la célèbre chanson du jeli ou griot Bazoumana Sissoko, Maliba ou grand Mali ou encore Empire du Mali dans la tradition orale. Initialement diffusée sur Radio Mali, en 1959, dans le contexte de la décolonisation et de l’éphémère Fédération du Mali (Sénégal et Soudan), Maliba affirme ensuite, en 1963, l’indépendance du Mali par rapport à l’ancienne puissance coloniale, la France, avant de devenir, à partir du coup d’Etat de 1968, dans la mémoire collective l’hymne annonciateur à la nation de la survenue d’un événement exceptionnel (coup d’Etat, guerre, etc.). Pour les deux artistes, Bazoumana et Van Baxy, le retour du Maliba passe par un réinvestissement effectif des Maliens dans leur histoire et leurs valeurs culturelles – d’origine manding.
A partir de l’analyse d’archives textuelles et audiovisuelles, d’entretiens menés à Bamako avec le rappeur et de l’analyse filmique du clip « Le Mali », je montre comment Van Baxy propose à sa façon une voie de sortie de la crise – sociale et morale – à l’intention de son public et des jeunes vivant à Bamako par une juxtaposition de récits : une histoire du Mali contemporain (y compris les tensions entre civils et militaires), une histoire visuelle du Mali (de ses régions et de leur patrimoine) et une histoire de la transmission intergénérationnelle sous la forme d’un featuring entre lui, Bazoumana et les populations locales. Van Baxy invite ainsi ses concitoyens à tirer les leçons du passé pour mieux se projeter dans l’avenir. Maliba constitue un projet politique de sortie de crise, à prendre au sérieux qui résonne chez beaucoup de Maliens par ailleurs, centré sur l’histoire et le respect de la transmission des valeurs culturelles héritées qui ne représente pas la répétition de traditions et de coutumes vidées de leur sens mais leur actualisation au contexte du moment.
Réécriture coloniale des histoires familiales
Pietro Repishti (Università degli Studi di Pavia), De père en fils. Politiques, transformations et traductions dans la construction d’une “histoire de Porto-Novo”
En 1914, fut publié un petit volume en yoruba intitulé « Iwé Itan Ajasè » (Histoire de Porto-Novo). Son auteur, Akindélé Akinsowon Coker Benjamin, un Egba natif d’Abeokuta (Nigeria), s’était installé à Porto-Novo (Bénin) pour travailler dans une succursale de la société britannique John Holt. Bien que la vie d’Akinsowon ait été largement oubliée, son nom a perduré grâce à son fils, Adolphe Akindélé, qui en 1953 publia, avec son collègue Cyrille Aguessy, un ouvrage intitulé « Contribution à l’étude de l’histoire de l’ancien royaume de Porto-Novo », qui représente jusqu'à présent la principale référence sur l'histoire de Porto-Novo. Alors qu’Adolphe Akindélé était un médecin estimé à Porto-Novo, son père fut probablement toujours considéré comme un étranger. L’ouvrage d’Akindélé et Aguessy a souvent été considéré par les historiens comme la traduction française de « Iwé Itan Ajasè », enrichie de quelques observations ethnographiques. Toutefois, ces mêmes historiens admettent n’avoir jamais eu accès à la version d’Akinsowon, rare et difficile à traduire. La redécouverte et la traduction de ce volume nous interpellent non seulement sur les correspondances et divergences existantes entre les deux versions, mais aussi sur le contexte historique et politique dans lequel ces textes ont été produits. Cet article vise à contribuer aux débats sur la « production de l’histoire », vue comme un processus dynamique et continu de transformation, mené par des historiens académiques et vernaculaires. Quels furent les motivations, les ambitions et les circonstances qui ont poussé Akindélé Akinsowon et après d’Adolphe Akindélé et de Cyrille Aguessy à s’intéresser à l’histoire de Porto-Novo ? Quelle approche ont-ils utilisée face à des sources multiples et souvent incohérentes ? La redécouverte de ce texte ouvre également de nouvelles perspectives pour l’analyse des projets politiques (colonial, missionnaire, royal) et des différents acteurs – locaux et globaux – qui ont influencé et contribué à la formation d'une version canonisée des mythes et de l'histoire de Porto-Novo.
Hugo Logez (Columbia University), Le Livre de la famille d'Oliveira : Genealogical Writing in Colonial Ouidah
Written around 1910 by Achille Féraud, an interpreter for the French colonial administration in Dahomey, Le Livre de la famille d'Oliveira traces the history of his own family from its alleged foundation in Ouidah in the 17th century by a French trader to the French conquest at the end of the 19th century. Combining genealogical writing and business history, Féraud's book recounts both the family tradition and the commercial successes and pitfalls of the d'Oliveira family over more than a century. Although the figures and events described by Féraud are relatively well known to historians, this text has been completely forgotten and never cited in academic works invoking the d'Oliveira family. The history of this family has traditionally been written using colonial reports from the 1910s and oral traditions collected decades later, with no mention of Féraud's manuscript. Only a few anthropologists in the 1940s were aware of this document, beginning with Pierre Verger, who preserved a copy in his personal papers. As a result, scholars have overlooked how this family narrative might have served to legitimize both the interpreter’s position and his lineage in Ouidah and within the new colonial order. Based on Verger's copy of Féraud's manuscript, this paper aims to question the political meaning of genealogical writing in a colonial context, the nature of family tradition collected by historians, and more broadly the status, and possible erasure of vernacular narratives in the production of academic history.
Historicités et mémoires populaires de l’esclavage
Gabriel André (CERI, Sciences Po), Des entrepreneurs d’histoire(s). Raconter et performer le passé esclavagiste au Fouta-Djallon (Guinée)
En Guinée, la région du Fouta-Djallon est profondément marquée par le souvenir d’un État pré-colonial, fondé par un jihad au début du XVIIIe siècle, mené principalement par des Peuls musulmans. Les hiérarchies sociales issues de cet État théocratique, fondé non seulement sur la vente mais aussi l’exploitation des esclaves, ont partiellement résisté à la colonisation puis au régime révolutionnaire de Sékou Touré. Aujourd’hui, l’écriture et la mise en scène de ce passé esclavagiste sont des objets politiques, c’est-à-dire des dispositifs de savoir et de pouvoir. Ces derniers nourrissent à la fois des dynamiques hégémoniques et contre-hégémoniques, permettant de discuter des critères d’appartenance à l’élite locale, dans un contexte national ethnicisé, où le premier parti du Fouta-Djallon, l’UFDG, réputé acquis aux intérêts peuls, n’a jamais gouverné depuis l’indépendance. Je souhaiterais ainsi montrer comment le post-esclavage n’est pas réductible à la reconduction des écarts de richesse entre descendants de maîtres et descendants d’esclaves, mais se rejoue quotidiennement dans les représentations plus ou moins érudites d’un passé douloureux.
Ibrahima Thioub (UniversitéCheikh Anta Diop de Dakar), Mémoires populaires et esclavage en Afrique : le silence de l'historiographique africaine
Le thème de l’esclavage est longtemps resté un angle mort de l’historiographie africaine de l’Afrique. Presque toujours confondu, à tort, avec les traites esclavagistes qui lui sont liées, il est longtemps resté absent des grands récits historiques et des programmes d’enseignement. L’absence relative des historiens africains sur ce champ de recherche contraste avec l’ancienneté du fait esclavagiste en Afrique, sa généralisation à l’échelle du continent, son ampleur variable d’une époque à une autre, le rôle et les fonctions des esclaves dans tous les domaines d’activité comme la diversité de leurs conditions sociales, mais surtout sa présence incontestable dans l’actualité du continent. Des arguments sont avancés pour expliquer, voire justifier, le peu d’intérêt accordé par les historiens africains à ce sujet : l’absence de sources écrites pour les périodes anciennes, le silence des traditions orales, la place négligeable de la force de travail servile dans l’économie, le caractère familial de la mise en servitude et la sensibilité de la question.
Le plus curieux de ces arguments reste l’évocation d’un silence des traditions sur le sujet au moment où celles-ci s’affirmaient comme sources crédibles et pertinentes de l’histoire du continent. Il ne fait aucun doute, et les recherches entreprises depuis les années 2000 le prouvent amplement, que les traditions et témoignages oraux documentent largement la présence ancienne et contemporaine des relations serviles dans toutes les régions du continent. Les mythes, légendes, épopée, poésie, proverbes et dictons de nombre de sociétés africaines foisonnent en références multiples sur l’esclavage. Aujourd’hui, les tabous à l’origine de ce silence académique sont certes brisés mais il reste encore beaucoup à faire dans la collecte et l’interprétation des multiples et diverses sources sur l’esclavage, ses abolitions et leurs héritages en Afrique.
Les récits concurrents du roman national
Chloé Josse-Durand (Newcastle University), Récits pluriels et compétitions mémorielles autour de l’histoire des luttes anticoloniales au Kenya
Cette présentation s’intéresse aux histoires alternatives et plurielles de la lutte pour l'indépendance au Kenya. L’insurrection Mau Mau — une rébellion anticoloniale brutale et complexe contre la domination britannique dans les années 1950 — et l’écriture de son histoire est au coeur des débats sur la formation de la nation kenyane post-1963. Pendant longtemps, cette mise en récit a été façonnée par des intellectuels Kenyans et Britanniques : écrivains, avocats, politiciens, journalistes, et anciens prisonniers politiques liés au mouvement Mau Mau devenus des figures politiques de premier plan après l’indépendance, comme J.-M. Kariuki.
En s’inscrivant dans des travaux d’historien·ne·s récents (Bethany Rebisz, Rose Miyonga) sur les mémoires silencieuses de la violence coloniale au Kenya, comme celle des femmes pendant la période de guerre civile, cette présentation s’appuie sur des recherches de terrain menées à Nyeri entre 2022 et 2024, afin d’explorer les récits historiques alternatifs et ambivalents qui émergent aujourd’hui autour de la mémoire Mau Mau. En examinant les « petits acteurs sociaux » de cette grande histoire, cette recherche s’intéresse aux moyens par lesquels des voix dissonantes et souvent marginalisées, telles que celles de différentes factions des vétérans de la lutte Mau Mau mais aussi des loyalistes, de leurs familles et de leurs descendants, parviennent à se faire entendre. Ces récits alternatifs de l’histoire des luttes prennent des formes diverses : projets de musées pour préserver les mémoires locales des luttes, projets photographiques restauratifs rejouant et mettant en scène ces luttes, collectifs militants menant leurs propres enquêtes de terrain, publications à compte d’auteur de biographies politiques, etc.
Cette recherche interroge comment ces différentes voix s’articulent dans l’espace public, et comment elles pourraient remettre en question les récits officiels sur la lutte pour l’indépendance. Un intérêt particulier sera porté aux enseignant.e.s d’histoire dans deux écoles situées sur d’anciens camps de détention coloniaux, dont certain.e.s sont parfois des descendant.e.s de partisans et aux visions qu’ils transmettent, à travers leurs enseignements, de l’histoire des Mau Mau aux nouvelles générations. Elle s’appuiera aussi sur d’autres exemples de mises en récit plurielles de l’histoire coloniale au Kenya, comme celles consacrées à Koitalel Samoei (héros de la lutte anticoloniale pour la communauté Nandi) et Lukas Pkoecch (leader de la résistance de la communauté Pokot à l’ordre colonial), pour illustrer comment les acteurs de ces revendications historiques locales remettent en cause les récits partiels et institutionnalisés des luttes anticoloniales.
Timothy Gibbs (Université de Nanterre), Doing history in a wounded society: The Sinomlando Centre for Memory Work and the rise of Jacob Zuma in South Africa
South Africa’s ex-president Jacob Zuma is today best known as an incendiary populist. But he was once known by his praise name, Nxamalala – the bringer of milk and meat. Indeed, he established ANC dominance in KwaZulu-Natal in the mid-1990s and 2000s by making the party the harbinger of reconstruction and development in the aftermath of a devastating civil war, which cost at least 10,000 lives and made 500,000 homeless across the province. This paper is about the popular history initiatives that were established during this period – epitomised by the Sinomlando Centre for Oral History and Memory Work – that ran concurrently with the politics of reconciliation. My argument tentatively suggests the Sinomlando Centre’s embeddedness is a particular liberal and Africanist intellectual milieu, which was somewhat different (perhaps) to the dominant strands of South Africa social history. This paper also makes some preliminary suggestions of why, despite their work being important and influential within South African political circles, they have perhaps not made such an impact inside the academy.
Elara Bertho (LAM, IEP de Bordeaux), « Trop bien jouer les traîtres. Quelques réflexions sur des colères de Sékou Touré au sujet de pièces de théâtre historiques (Guinée, 1958-1984) »
A partir d'un corpus d'archives privées et institutionnelles, j'ai recensé une trentaine de pièces de théâtre à matière historique jouées à Conakry lors des festivals de théâtre qui encadraient la jeunesse lors de la Première République (1958-1984). Je dispose le plus souvent de comptes rendus longs et parfois de textes intégraux. Les pièces traitent principalement de l'histoire guinéenne précoloniale, de la mise en scène de la résistance à la colonisation - où les parallélismes avec l'histoire contemporaine sont transparents pour le public de l'époque. Parler du passé pour parler du présent : l'objectif pour Sékou Touré est d'établir un roman national, à dominante malinké mais en intégrant un équilibre avec d'autres héros régionaux. Une part non négligeable traite également d'autres grands événements en dehors de la Guinée, à l'instar du massacre de Thiaroye (choisi pour représenter la Guinée au Festac de Lagos en 1977).
Sékou Touré a abondamment légiféré sur les règles du concours théâtral, reprenant inlassablement dans ses discours des règles et des sous-règles. A chaque nuance apportée, de discours en discours, on peut revenir sur les émotions générées par ces pièces, et aux censures dont certaines ont fait l'objet. Trop bien jouer un traitre, par exemple, peut révéler d'un exercice délicat dans un régime autoritaire qui entend cadenasser les émotions de la scène et de la salle. Après un état des lieux de l'usage de l'histoire dans ces pièces, je reviendrai sur certains cas de censure avérés, en opérant des croisements avec des entretiens oraux de spectateurs et acteurs de l'époque, pour reconstituer les causes de certaines colères de Sékou Touré liées à l'interprétation de l'histoire, et leurs usages sociaux.
La biographie comme récit de la nation
Irene Bono (Università degli Studi di Torino), Conflits biographiques et récits de la nation au Maroc.Parler pour, donner la voix, parler avec
Ahmed Benkirane est né à Marrakech en 1927. Militant appartenant à la génération des jeunes nationalistes du Maroc, haut commis de l’État à l’indépendance, patron de presse, animateur du débat politique et homme d’affaires également actif dans la représentation entrepreneuriale et dans les rapports avec les syndicats, Benkirane s’est engagé en 2010 dans un dialogue avec moi long de dix ans pour témoigner des expériences qu’il a vécues, à l’appui de ses archives privées. Ce travail s’est avéré être un véritable laboratoire pour réfléchir à la relation complexe qui lie les récits de soi aux récits de la nation.
En partant du préalable que chaque récit de soi reflète une manière spécifique et historiquement située de concevoir le récit de la nation, cette communication interroge les transformations successives dans la façon dont Benkirane a exprimé son propre récit en relation à l’histoire nationale, transformations qui ont émergé au fil de notre travail commun. Prendre en compte ces transformations permettra, en premier lieu, de faire ressortir trois ordres de conflits sous-jacents au récit de la nation au Maroc : l’un générationnel, l’autre géographique, le dernier idéologique. En deuxième lieu, interroger les transformations successives du récit de soi porté par Benkirane amènera à faire ressortir trois modalités différentes par lesquelles une place est accordée aux récits individuels dans les récits de la nation : selon que l’on vise à parler au nom d’un acteur donné, qu'on cherche à lui donner la voix, ou que l’on revendique la pertinence du dialogue avec lui. Revenir sur ces trois modalités permettra de faire ressortir le caractère perméable de la distinction entre les expressions académiques et vernaculaires de l’histoire, et de dresser les contours et les clivages qui caractérisent le champ au sein duquel se joue la compétition pour le passé au Maroc à l’heure actuelle.
Mylkah Djacko (Columbia University), “Et moi ?” On the construction of Marie-Thérèse Houphouët-Boigny’s memory in Côte d'Ivoire
This paper explores Marie-Thérèse Houphouët-Boigny’s career as first lady of Côte d'Ivoire from 1960 to 1993. Unlike her notorious successor Simone Gbagbo who had an iron lady reputation, Marie-Thérèse is simply remembered as Houphouët-Boigny’s wife. While journalist Serge Bilé has recently constructed a memory of her which emphasized her beauty and rumors about her personal life, the paper argues that she played a role in shaping the first decades of her newly independent nation. By exploring how her representation in the media, alongside Ivorian and international history, changed over the course of three eras, it contextualizes Marie-Thérèse’s first ladyship. It describes three stages in her career which include the modern girl stage, the women’s activism stage, and the saving the children stage.
Les luttes nationalistes contre l’histoire académique
Séverine Awenengo Dalberto (CNRS, IMAF), « Comment écrire l’histoire de la Casamance ? Elle se vit, d’abord ». Archives et expériences en dispute dans l’historiographie nationaliste du MFDC (années 1980-1990)
Cette communication examine les connexions et les disputes entre l’histoire nationaliste casamançaise et l’histoire académique autour des fondements juridiques coloniaux du droit à l’indépendance de la Casamance, un droit revendiqué par le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) depuis 1982. Elle se concentre sur un moment révélateur de cet affrontement historiographique, intervenant dans un contexte de négociations de cessez-le-feu entre la branche armée du mouvement et l’État sénégalais : la production d’un « témoignage historique » présenté en 1993 en Casamance par un Français, le conservateur général des archives Jacques Charpy, et la réponse qu'il provoque sous la forme de la première somme d’une histoire officielle indépendantiste, élaborée par l’abbé Augustin Diamacoune Senghor, leader du mouvement, dans Casamance, pays du refus.
Plutôt que de considérer l'interprétation et le réagencement des faits, des auteurs et des archives par Diamacoune comme un simple usage instrumental du passé utile à la cause, cette communication défend l’idée que le récit nationaliste casamançais témoigne d’une autre conception de l’histoire - agissante, performative et sensible -, de son régime de véridiction et de son écriture. C’est dans cette mesure que cette histoire résiste aux démonstrations académiques, tout en s'en nourrissant : elle témoigne d’une autre relation aux temporalités, à leurs productions matérielles, discursives et imaginaires. Or ce récit sur le passé ne se construit pas nécessairement contre les archives coloniales, mais dans leurs zones grises, leurs filigranes : il se forme sur les rebuts de l’empire — les fantasmes, les secrets, les possibles non advenus — qui en sont l'une des matrices.
Richard Banégas (CERI, Sciences Po) et Armando Cutolo (Università degli Studi di Siena), Politique, prophétisme et parole dans l’historicité ivoirienne
Dans son histoire, la Côte d’Ivoire a hébergé une longue tradition de prophétisme. De William Wade Harris à Papa Nouveau, d’Albert Atcho à Kakou Séverin, les prophètes ivoiriens n’ont fait qu’annoncer l’avènement d’un nouvel ordre sur la terre. Subjectivation religieuse et subjectivation politique se sont trouvées ici mutuellement impliquées dans ce qui Jean-Pierre Dozon a décrit comme une « production religieuse de la modernité ». Ainsi, le président Houphouët-Boigny, père de l’indépendance et bâtisseur du « miracle ivoirien », a été parfois représenté comme un prophète dans la culture populaire. Le président Laurent Gbagbo a été aussi doté de ce double statut de leader politique et de prophète d’un nouvel ordre. Sa conversion au pentecôtisme, les épreuves bravées pendant la guerre et le procès à la CPI de La Haye, dont il est sorti vainqueur après un longue détention, en ont fait un nouveau « Messie » - notamment le « Christ de Mama » (Mama étant son village d’origine). Ancien professeur d’histoire à l’Université de Cocody et maitre charismatique de la parole, Laurent Gbagbo a été pris comme modèle par les orateurs des « parlements de rue » abidjanais. Son combat pour libérer la nation de la tutelle néocoloniale, sa conversion et son annonce d’un nouvel ordre politique, constituent une allégorie du projet d’émancipation que la tradition prophétique a inscrit dans l’historicité ivoirienne.
(crédits : Laurent Fourchard)
À propos de cet événement
Du 04 novembre 2024 à 10:30 au 05 novembre 2024 à 10:00
Salons scientifiques
1 pl. Saint-Thomas-d'Aquin, 75007, ParisOrganisé par
Africa Programme