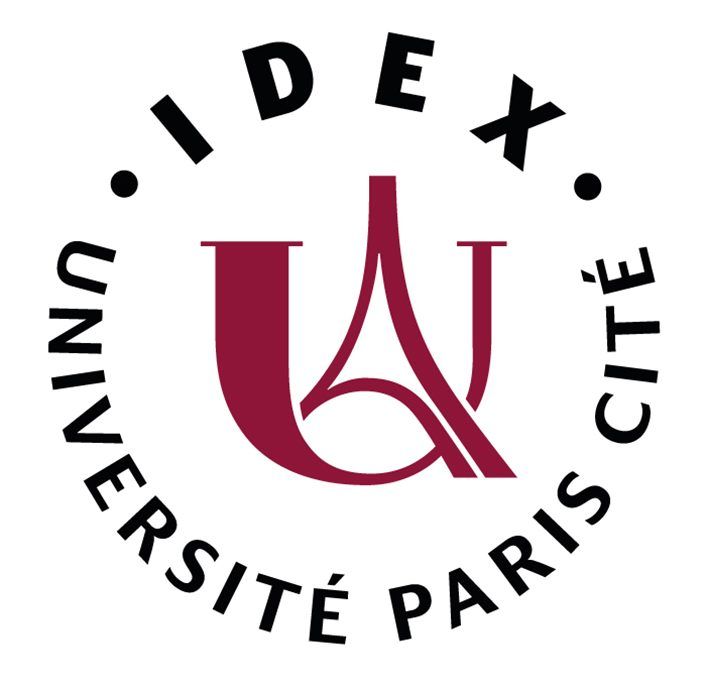Accueil>Transition juste et sécurisante

16.09.2025
Transition juste et sécurisante
Le LIEPP, la DGCS et six partenaires, lancent un appel à contributions sur le thème des initiatives de transition juste participant à renforcer la dimension sécurisante des protections sociales.
Ce projet vise à capitaliser sur les innovations locales permettant de penser l’avenir des protections sociales, dans un contexte marqué par une double exigence de transition écologique et de justice, à travers une logique d’identification et d’analyse de telles innovations déployées à différentes échelles territoriales, et d’évaluation de leur potentiel de généralisation. Il s’adresse autant aux chercheurs dont les analyses théoriques sur ces thématiques ou des études de cas pourraient être accueillies sous forme d’articles scientifiques qu’aux collectivités et associations encouragées à partager des présentations étayées d’expérimentations mises en place, accompagnées de données d’observation ou d’évaluation, permettant d’en faire un premier bilan.
Calendrier
- L’appel à contributions est lancé en septembre 2025. Il est ouvert pour une durée de trois mois.
- Des manifestations d’intérêt, facultatives, peuvent être envoyées avant le 15 octobre.
- Le rendu des contributions est fixé au 30 novembre.
- La réponse finale sur la sélection est fixée le 15 janvier.
- L’objectif est de monter un évènement (colloque ou séminaire) en juin ou septembre 2026, suivi probablement d’une publication.
Les éléments attendus pour le format sont les suivants :
- Pour les manifestations d’intérêt, facultatives, avant le 15 octobre : celles-ci doivent contenir le titre, le nom du ou des auteurs, la problématique pressentie, une bibliographie indicative et un résumé du travail allant être fourni. Le texte ne doit pas excéder deux pages police Times New Roman 12.
- S’agissant du rendu des contributions finales, fixé au 30 novembre, celles-ci doivent contenir le titre, le nom du ou des auteurs, un résumé en Français et en Anglais de 750 caractères espaces compris maximum, un texte n’excédant pas 50 000 signes espaces compris ainsi qu’une bibliographie.
L’adresse électronique à utiliser est : dgcs-transitionjuste@social.gouv.fr
Contexte
La réflexion sur une transition juste et sécurisante part du constat que les protections sociales remplissent de moins en moins leur rôle premier : sécuriser les existences. Aujourd’hui, elles tendent à se recomposer autour d’interventions ponctuelles, ciblées et conditionnelles, tandis que le modèle du salariat intégré s’affaiblit. Ce contexte nourrit un sentiment diffus de crainte pour l’avenir, de peur du déclassement et d’isolement face aux difficultés, aggravé par la contrainte budgétaire pesant sur une partie des ménages et par l’affaiblissement des services publics. Dans ce cadre déjà fragilisé, les enjeux écologiques apparaissent souvent comme une menace supplémentaire, synonyme de restriction et d’insécurité.
Cet appel à contributions propose de changer de regard : plutôt que de voir l’écologie comme une contrainte, il s’agit de mettre en lumière les initiatives qui, en intégrant les enjeux environnementaux, contribuent à stabiliser et sécuriser les parcours de vie. La dimension locale y joue un rôle central, car les inégalités se redéfinissent de plus en plus territorialement (pollution, tensions sur les ressources, catastrophes naturelles). De nombreuses solutions sont portées par des associations, des mouvements citoyens ou des collectivités, et méritent d’être étudiées pour comprendre leur impact sur la cohésion sociale et la protection des populations.
Cette démarche vise enfin à réfléchir à un nouveau système de protection sociale capable d’intégrer pleinement les risques socio-écologiques. Il s’agit de questionner comment l’action sociale peut évoluer pour renforcer son rôle sécurisant : développement de formations liées à l’économie verte, articulation avec les politiques d’insertion et d’emploi, initiatives alimentaires locales, projets de mobilité verte ou encore expérimentations de « travail social vert ». Les services publics eux-mêmes peuvent retrouver une légitimité renforcée en intégrant les effets du changement climatique.
Cet appel encourage donc les contributions qui documentent ces initiatives, en mobilisant des approches qualitatives permettant de saisir leurs effets sur les trajectoires individuelles et sur les représentations collectives de la sécurité sociale et écologique.
Axes proposés
Cet axe regroupe les contributions qui aborderont de manière directe les initiatives dans lesquelles la transformation écologique des protections sociales a per- mis de réduire l’incertitude et la vulnérabilité de leurs « bénéficiaires », ou ont tenté de le faire. Les contributions attendues pourront revêtir plusieurs formes : présentation de projets en cours accompagnée de données probantes, évaluation d’initiatives mises en place et retours d’expérience, analyse scientifique par étude de cas, élaboration théorique de propositions d’initiatives de ce type, etc. Elles pourront porter sur un ensemble très large de thématiques et de domaines qui s’inscrivent dans le cadre de la cohésion sociale, de l’alimentation à la lutte contre le chômage, de la mobilité à la santé, des minima sociaux aux services publics. L’intégration de dimensions comparatives internationales, et notamment européennes, afin de mettre en perspective les initiatives analysées, sera en outre valorisée. Elles pourront mobiliser des analyses quantitatives ou qualitatives, mais également des ana- lyses comparées sur différents contextes en Europe.
Il s’agit ici de réfléchir à la place de l’échelle locale et territoriale dans l’élaboration de protections sociales en contexte de transition. Les contributions attendues pourraient aborder cette thématique tant depuis les évolutions touchant les risques et les vulnérabilités impliquées par la transition que depuis les évolutions des attentes, des outils et des échelles de l’action publique. Les contributions théoriques sur cette thématique pourraient relever de l’histoire, de la science politique, de la philosophie, de la sociologie, de l’économie, de la géographie ou des études urbaines et rurales.
Les contributions attendues devront aborder les évolutions impliquées par l’émergence de la question écologique et sa traduction dans des politiques de transition au regard de la promesse de sécurité qui travaille la société française moderne. Elles pourront porter une réflexion théorique sur le contrat social et les évolutions qui touchent sa structure. Elles auront aussi la possibilité d’analyser de manière plus circonscrite et localisée des cas où la question de la sécurité de l’existence et des trajectoires (et donc l’accès pour tous à des conditions de vie décentes) se trouve liée à la question sociale et la question écologique. Les contributions scientifiques en théorie politique, en histoire, en sociologie et en science politique seront particulièrement valorisées.
Partenaires
Pour répondre à ces enjeux, cet appel à contributions est réalisé sur un mode partenarial. La MASSP s’associe à plusieurs institutions aux fonctions et à l’expertise complémentaires. Ces institutions sont :
- LIEPP (Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques)
Le LIEPP est une plateforme de recherche de Sciences Po et Université Paris Cité qui développe l’évaluation scientifique des politiques publiques. Il croise méthodes quantitatives et qualitatives pour produire des analyses utiles aux décideurs, notamment sur les politiques environnementales. - La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est chargée de la conception, du pilotage et de l’évaluation des politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité favorisant la cohésion sociale. La DGCS intervient sous l’autorité du ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations et coordonne notamment les politiques publiques en matière de droit des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle. - FAS (Fédération des acteurs de la solidarité)
La FAS est un réseau rassemblant plus de 900 associations et organismes luttant contre les exclusions et agissant pour la solidarité. Elle porte des actions de plaidoyer, d’analyse et d’innovation sociale, et représente la grande majorité des centres d’hébergement et services pour les plus précaires. - HCC (Haut Conseil pour le Climat)
Le HCC est un organisme indépendant qui évalue les politiques publiques françaises de réduction des émissions de gaz à effet de serre et leur cohérence avec les objectifs de neutralité carbone. Il publie des rapports réguliers et prend en compte les impacts socio-économiques et environnementaux de la transition. - IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales)
L’IDDRI est un think tank français spécialisé dans la transition écologique et la refondation des politiques publiques, notamment sociales. Ses travaux explorent comment intégrer l’écologie au cœur du contrat social français et analyser ses implications politiques et symboliques. - Institut Mutualiste pour l’Environnement et la Solidarité (Crédit Mutuel Alliance Fédérale)
Créé en 2024, cet institut vise à réduire de 20 % l’empreinte carbone du groupe mutualiste et à accompagner la transformation écologique de ses métiers. Il agit dans les domaines de l’éco-rénovation, de l’agriculture et de la lutte contre les fractures sociales. - ADEME (Agence de la transition écologique)
L’ADEME est un établissement public chargé d’accompagner et d’accélérer la transition écologique en soutenant l’innovation et en mobilisant citoyens, entreprises et territoires. Elle définit les stratégies environnementales nationales et en évalue la mise en œuvre. - CNAF (Caisse nationale des allocations familiales)
La CNAF et son réseau de 101 caisses accompagnent les familles dans leur quotidien à travers les prestations sociales, les aides au logement et le financement de services d’accueil et d’animation sociale. Elle contribue ainsi à la cohésion sociale et à l’accès aux droits sur tout le territoire.
Objectifs
Au-delà de ses enjeux directement scientifiques, cet appel à contributions visera également à rapprocher ces différentes institutions autour d’une culture commune de la transition juste dans les politiques sociales, en identifiant les bonnes pratiques et les obstacles à lever pour mettre en place une protection sociale écologique, autant qu’à diffuser ces conceptions auprès des cadres dirigeants des politiques sociales. Il devra donner lieu à un colloque au cours duquel les travaux sélectionnés pourront être discutés entre les auteurs, les membres de ce partenariat, le conseil scientifique et un public, et aura pour vocation principale la publication d’un ouvrage collectif rassemblant ces contributions.