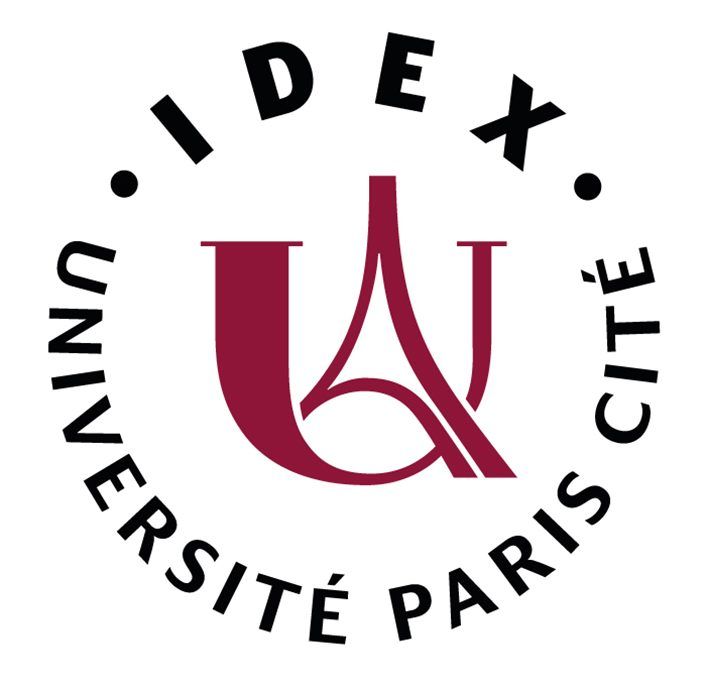Accueil>Rendre les sciences sociales utiles à la société : enjeux et pratiques de l’évaluation de programmes

19.11.2025
Rendre les sciences sociales utiles à la société : enjeux et pratiques de l’évaluation de programmes
Dans le cadre du partenariat avec Université Paris Cité, le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) en collaboration avec l’Ecole de la recherche de Sciences Po, ouvre son cours intersemestre « Rendre les sciences sociales utiles à la société : enjeux et pratiques de l’évaluation de programmes » aux masterant.e.s et aux doctorant.e.s d’Université Paris Cité et de Sciences Po.
Descriptif du cours
L’évaluation de programmes/évaluation des politiques publiques (au sein d’administrations, d’O.N.G., de cabinets de conseil privé, ou en libéral) est un débouché professionnel essentiel pour les titulaires de Masters recherche en sciences sociales qui ne se destinent pas à la recherche académique. Pour les doctorants, cela permet d’élargir le champ des orientations professionnelles possibles, mais aussi d’ouvrir une réflexion sur les apports de la recherche académique pour l’évaluation des politiques publiques.
Ce cours interdisciplinaire prend appui sur la réflexion autour de l’évaluation développée depuis plusieurs années au sein du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques (LIEPP). Il propose une introduction large aux enjeux et aux pratiques de l’évaluation, qui ne se limite pas aux enjeux méthodologiques et qui aborde ces derniers de manière plurielle, à partir d’une diversité d’apports disciplinaires. Plus précisément, le cours propose d’aborder les enjeux de l’évaluation de programmes à partir de trois grandes entrées : méthodes, valeurs, et utilisation des savoirs.
Module 1 : Introduction et méthodes d’évaluation d’impact
Ce premier module introduit le sujet à partir de quelques définitions et éléments de vocabulaire essentiels, avant d’aborder la question des méthodes en évaluation d’impact. Le champ de l’évaluation s’étant historiquement construit (dans le contexte de la Great society de Johnson aux États-Unis) autour de la mobilisation des méthodes expérimentales et quasi expérimentales pour évaluer l’impact d’interventions publiques, nous revenons d’abord sur les grandes caractéristiques de ces approches, notamment sur le plan de la logique d’inférence causale contrefactuelle (Fougère et Jacquemet 2019; Rossi et al. 2004). Le module présente ensuite les approches d’évaluation dites « basées sur la théorie » (Weiss 1998; Devaux-Spatarakis 2023), qui se sont développées en réaction aux limites de ces premières approches (quasi-)expérimentales en proposant d’ouvrir la « boîte noire » des interventions pour décomposer (le plus souvent à partir de méthodes qualitatives) les différents mécanismes qui conduisent à la production d’un impact donné. Nous montrons comment ces approches reposent sur une conception différente de la causalité, générative plutôt que contrefactuelle. Sans nier l’importance des conflits méthodologiques et épistémologiques autour de ces enjeux d’évaluation d’impact, le cours insiste sur la complémentarité entre ces différentes approches (Revillard 2023).
Module 2 : Valeurs, critères et indicateurs
Au-delà de l’application de différentes méthodes de sciences sociales, l’évaluation suppose la formulation d’un jugement sur l’intervention. La pratique de l’évaluation implique donc des choix normatifs qui se traduisent dans les questions évaluatives, les critères utilisés et les indicateurs associés (OECD/DAC Network on Development evaluation 2019; Teasdale 2021). Ce deuxième module revient sur cette dimension plus normative de la pratique de l’évaluation, en ouvrant une réflexion sur son rapport à l’aspect scientifique/méthodologiques présenté dans le premier module. Nous montrons que la question des valeurs mobilisées dans l’évaluation engage des rapports de pouvoir entre parties prenantes de la politique étudiée, et réfléchissons sur le rôle professionnel de l’évaluateur dans ce contexte. Outre sa dimension épistémologique et éthique, ce deuxième module propose de travailler concrètement sur la définition des indicateurs, outil central de l’évaluation dont nous abordons à la fois les enjeux pratiques (comment construire un bon indicateur) et les risques associés (effets sur l’action publique du pilotage par les indicateurs).
Module 3 : Utilisation des savoirs
En tant que science sociale appliquée, l’évaluation de programmes est particulièrement attentive à l’enjeu de son utilisation : en quoi les évaluations conduisent-elle effectivement à des changements des politiques étudiés ? Comment sont-elles appropriées par les décideurs publics et par les citoyens ? Le champ de l’évaluation a ainsi développé des théories sur l’utilisation des savoirs et des outils pratiques visant à favoriser celle-ci, autant de théorie et d’outils qui sont par ailleurs utiles pour la recherche fondamentale (Alkin et King 2017). Elles invitent effectivement à une réflexion plus large sur la médiation scientifique et les relations sciences – société. Dans ce module, nous reviendrons sur les théories développées sur l’utilisation de l’évaluation (en lien avec le projet de recherche en cours EVALUSE financé par CIVICA). Nous explorerons ensuite plusieurs outils visant à favoriser l’utilisation des savoirs : participation des parties prenantes, répertoire en ligne de données probantes, revues systématiques de littérature, pratiques de médiation scientifique.
Au fil des modules, cette formation permet donc d’aborder des questions transversales importantes dans le cadre de la formation à la recherche, indépendamment même du cas particulier de l’évaluation des politiques publiques : enjeux méthodologiques et épistémologiques autour de l’inférence causale, articulation entre valeurs et production des savoirs, enjeux d’utilisation des savoirs et de médiation scientifique.
Le cours suit une approche de pédagogie active, avec beaucoup de séquences interactives. Les étudiants seront invités à s’approprier le cours à partir de leurs spécialisations/centres d’intérêt disciplinaires et thématiques. La validation se fait à partir de l’assiduité, selon un système de pass/fail.
Informations pratiques
- Enseignante : Anne Revillard, professeure de sociologie à Sciences Po et directrice du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP)
- Format : formation de 8h sur deux demi-journées en présentiel
- Dates : 16 janvier, 9h-13h et 14h-18h
- Langue de l'enseignement : Français
- Prérequis : aucun
- Nombre de places ouvertes : 30
- Ouverts aux : 1) doctorants, 2) mastérants de l'Ecole de la Recherche et de Sciences Po, 3) doctorants et mastérants d'Université Paris Cité
Merci de vous inscrire via ce formulaire avant le 15 décembre 2025.
Pour plus d’information sur le LIEPP, merci de contacter andreana.khristova@sciencespo.fr