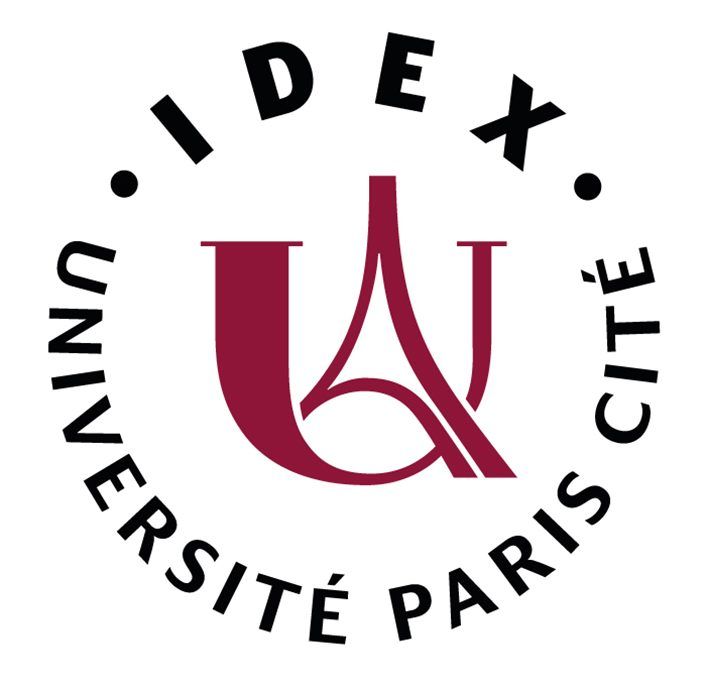Accueil>Programme jeune recherche (2025)
04.03.2025
Programme jeune recherche (2025)
Le LIEPP lance la 6ème édition de son programme de soutien à la jeune recherche en évaluation des politiques publiques. Le programme s’inscrit dans la dynamique de partenariat avec Université Paris Cité. Il est ouvert aux doctorant.e.s (qui doivent être inscrit.e.s en thèse au moment du d�épôt de leur candidature) et jeunes docteur.e.s (ayant soutenu depuis moins de 2 ans, la thèse devant avoir été soutenue après le 31 août 2023) dont l’affiliation principale est un laboratoire de Sciences Po ou d’Université Paris Cité, toutes disciplines confondues.
Il poursuit quatre objectifs :
- Valoriser et apporter un appui aux travaux de jeunes chercheur.e.s ;
- Faciliter la traduction des recherches académiques en résultats utiles pour l’évaluation des politiques publiques ;
- Favoriser la mise en dialogue interdisciplinaire des recherches, en vue notamment de favoriser l’émergence de projets interdisciplinaires ;
- Donner une meilleure visibilité, auprès d’acteurs publics et de la société civile, aux travaux de jeunes chercheur.e.s ayant un apport pour l’évaluation des politiques publiques.
Lauréats du programme 2025/2026
XIAN Jiaqing, économie, CESSMA (Université Paris Cité) : Construction and calculation of China's green GDP input-output model
L'économie mondiale évolue rapidement et, en tant que grand pays en développement, la Chine continue d'enregistrer une croissance soutenue de son PIB. Cependant, ces progrès se font souvent au prix d'un épuisement des ressources et d'une dégradation de l'environnement. Le Système de comptabilité nationale (SCN) traditionnel ne parvient pas à pleinement appréhender ces impacts, ce qui nécessite un cadre amélioré. En réponse, les Nations Unies ont introduit le Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) afin d'intégrer les considérations relatives aux ressources et à l'environnement dans les indicateurs économiques. Cette étude s'appuie sur le SCEE et utilise une analyse entrées-sorties pour développer un modèle entrées-sorties de PIB vert. En intégrant l'épuisement des ressources et les coûts environnementaux dans la comptabilité économique, le modèle améliore la précision de l'évaluation du développement durable. Contrairement aux études précédentes, il intègre ces facteurs directement dans les calculs du PIB en utilisant des approches de production, de revenus et de dépenses. En utilisant les données officielles du Bureau national des statistiques de Chine, cette recherche souligne l'importance du PIB vert comme indicateur économique clé, favorisant une croissance durable.
RAVALIHASY Andrainolo, santé publique, CEPED (Université Paris Cité) : Une modélisation par narration quantitative : le cas de l'évaluation d'impact du projet MAKASI sur la transmission du VIH
La pandémie de COVID-19 a montré que les outils mathématiques de modélisation des épidémies pouvaient être mis à profit par les politiques pour évaluer des décisions en santé publique. Leur appropriation en tant qu’outils d’aide à la décision s’accompagne cependant d’une simplification des scénarios de propagation des épidémies qui engage à repenser le processus de construction de ces modèles. Cette recherche propose de repenser ce processus en étudiant le cas de l’intervention MAKASI. MAKASI est une intervention sociale visant à réduire l’exposition à l’infection au VIH chez les immigrés originaires d’Afrique subsaharienne vivant en Île-de-France. Elle entend agir sur leur capacité à se saisir des ressources disponibles via le système de soins. Sa mise en œuvre repose sur un dispositif participatif incluant des chercheurs et des intervenants associatifs. Ce dispositif sera mis à contribution pour coconstruire un modèle d’évaluation d’impact de l’intervention sur la transmission du VIH chez les bénéficiaires. Les résultats de cette recherche permettront d’explorer dans quelles mesures l'exercice de modélisation peut s'approprier un dispositif participatif pour proposer une évaluation plus proche du terrain en conciliant les savoirs scientifiques, expérientiels et contextuels.
MAYNIER Valentin, sociologie, Cermes3 (Université Paris Cité) : Le rôle des psychologues dans les parcours de soins des enfants en situation de souffrance psychique et dans l’organisation des soins en pédopsychiatrie
Les psychologues sont des acteurs de plus en plus importants face à une « crise » de la pédopsychiatrie, caractérisée par l’augmentation de la demande de soins et la baisse du nombre de pédopsychiatres qui amènent à des difficultés de prise en charge. Les psychologues, dont le nombre a doublé depuis 2012, deviennent de plus en plus importants dans ce contexte et ont notamment fait l’objet d’une politique de remboursements des séances en libéral contestée par les organisations professionnelles. Cette recherche étudie la place des psychologues dans le champ de la pédopsychiatrie et les transferts de compétences à l’œuvre des pédopsychiatres vers les psychologues. Elle se situe à la croisée de la sociologie des groupes professionnels, de la sociologie de la santé mentale et des childhood studies, et propose d’analyser ce que produisent les psychologues au sein de l’organisation des soins en pédopsychiatrie. Pour cela, j’utilise diverses données qualitatives, principalement des entretiens avec des psychologues et des observations dans des lieux de soins. Cette thèse montre comment se reconfigure un la pédopsychiatrie à partir de la crise et comment les institutions doivent réadapter leur organisation face à elle.
BORDERS Kane, économie/histoire/science politique, Département d'économie (Sciences Po) : Matching Dutch Voter Surveys to Administrative Data: Unlocking New Evidence on Political Inequality
Ce projet relie deux enquêtes électorales majeures aux Pays-Bas (DPES et LISS) aux fichiers administratifs de Statistics Netherlands (CBS), créant un ensemble de données unique combinant informations socio-économiques et données de participation électorale pour presque l’ensemble de la population néerlandaise, des années 1970 à aujourd’hui. Il vise à répondre à deux questions principales : (1) Le votant médian reflète-t-il le profil socio-économique et politique de l’électeur médian éligible ? et (2) Comment les politiques publiques et les chocs économiques ont-ils influencé les inégalités de participation électorale ? En contournant les biais des enquêtes traditionnelles, ce projet permettra d’identifier les écarts de participation selon le revenu, le niveau d’éducation et les préférences politiques, et d’évaluer les effets des réformes électorales, d'un scandale des allocations familiales, ainsi que des chocs macroéconomiques tels que la crise de 2008 et la pandémie de Covid- 19.
LAPI Thomas, économie, LIED (Université Paris Cité) : Analyse systémique du recyclage des métaux stratégiques dans les pays nordiques
Le « couplage énergie-matière » soulève des enjeux écologiques et géostratégiques majeurs dans le cadre de la transition écologique en raison des besoins croissants en métaux nécessaires à la production des nouvelles technologies (cuivre, nickel, lithium, etc.). Face à cette accélération de la demande, de nombreux États déploient des stratégies pour sécuriser les approvisionnements en matériaux considérés « critiques » et misent sur le recyclage. Toutefois, les espoirs politiques associés au recyclage se heurtent à des contraintes multiples, relevant de disciplines différentes : la résolution d’un défi technique (chimie séparative, physique), l’encadrement juridique (droit, sciences politiques), ou encore la quantification des potentiels socio-économiques (économie, sociologie). La difficulté de l’enquête réside dans l’élaboration, à l’échelle d’un État, d’une vision transversale portant sur le système de recyclage dans son ensemble. De nouvelles filières de recyclage des métaux sont en train d’émerger dans les pays nordiques (Suède, Norvège, Finlande) avec des succès contrastés. Ces initiatives mettent en lumière des problématiques structurelles au niveau européen, à l’interface entre les défis de soutenabilité et les enjeux géostratégiques. L’objectif de ces travaux de thèse (financé par le PEPR Métaux Stratégiques) est de proposer une vision systémique et stratégique pour le recyclage des métaux dans un contexte européen, à partir du cas nordique.
TEBOULLE Clémentine, sociologie/études de genre, Laboratoire de changement social et politique (Université Paris Cité) : La fabrique du jugement pénal. Approche sociologique et comparative du traitement judiciaire des féminicides et homicides conjugaux en France
Les homicides de partenaires intimes ont gagné en visibilité au cours des dernières décennies, entraînant un renouveau des recherches sur une question traitée par le passé via la lecture des crimes passionnels. Cette thèse s’inscrit à la croisée de la sociologie du droit et de la justice et des études de genre. Elle propose, via une approche comparative entre les sexes du traitement judiciaire des homicides et féminicides sur (ex-)conjoints, de se décentrer du paradigme homme auteur/femme victime afin d’analyser la fabrique du jugement pénal. Cette deuxième phase du traitement judiciaire, située entre la période présentencielle et l’application des peines, est relativement délaissée par la recherche en outre très riche sur la police et la prison. La démarche entend ainsi mettre le continuum des violences (Liz Kelly) au service d’une compréhension sociologique du processus. Partant de l’expérience des professionnel·le·s et des procès, il s’agit d’identifier les nuances dans la prise en charge des prévenu·e·s et de démêler les tendances dans la construction de la décision judiciaire, au prisme des enjeux pluriels qui l’animent. Au moyen d’une enquête qualitative mobilisant l’observation ethnographique, les entretiens et l’analyse documentaire, la recherche place le genre et l’intersectionnalité en son centre et se positionne du côté d’une lecture consubstantielle des rapports sociaux (Danièle Kergoat), à laquelle elle entend contribuer dans la sphère judiciaire.
BERNARD Bérénice, histoire/sciences de l'éducation, Centre d'histoire de Sciences Po : État et formation à la prise en charge éducative des jeunes enfants en Angleterre (seconde moitié du XXe siècle) : du sanitaire au pédagogique ?
Longtemps centrée sur le XIXe siècle et le début du XXe siècle, l’histoire de l’éducation de la petite enfance demeure peu explorée pour les périodes plus récentes. Or, c’est dans la seconde moitié du XXe siècle que la prise en charge collective des jeunes enfants connaît un essor significatif, en lien avec de profondes transformations économiques et sociales. Dans ce contexte, de nombreux pays mettent en place des formations visant à mieux préparer les professionnelles en contact avec les jeunes enfants. Ce projet interroge la manière dont ce champ professionnel s’est structuré en Angleterre depuis le milieu du XXe siècle, sous l’effet conjugué des politiques publiques, de l’action syndicale et des attentes familiales. Il examine l’émergence de nouveaux statuts professionnels et leurs conséquences sur les parcours de formation, les conditions d’emploi et les trajectoires de vie des travailleuses. Il éclairera également les contrastes institutionnels entre l’Angleterre, la France et la Suisse, ces deux derniers cas étant traités dans le cadre de ma thèse, reflet de la diversité des conceptions pédagogiques de la petite enfance.
MARTINEZ HERNANDEZ Alberto Gabino, économie, LADYSS (Université Paris Cité) : Horizontal Governance and Environmental Upgrading: Addressing Power Relationships in the Automotive Industry of the Atoyac Watershed, Mexico
Ce projet analyse les dynamiques de gouvernance horizontale et les processus d’« environmental upgrading » dans l’industrie automobile de la région du bassin hydrographique de l’Atoyac (Mexique), l’un des plus pollués du pays. En combinant les approches des chaînes de valeur mondiales et de l’économie écologique, il s’intéresse à la manière dont les acteurs locaux – entreprises, autorités publiques, société civile – mobilisent différents types de pouvoir (structurel, institutionnel, narratif, etc.) pour favoriser ou freiner la transition environnementale. Basé sur une enquête de terrain (entretiens semi-directifs, cartographie des acteurs et des chaînes de valeur), le projet vise à identifier les effets différenciés des mécanismes de gouvernance sur les résultats environnementaux et économiques. Il contribuera à l’évaluation des politiques environnementales industrielles en mettant en lumière le rôle souvent sous-estimé d’acteurs non dominants – tels que les agences gouvernementales locales ou les organisations de la société civile – dans les dynamiques de durabilité au sein des chaînes globales de production.
ROTH Johanna, économie, Departement d'Economie (Sciences Po) : Les demandeurs d’emploi sans domicile – logement ou emploi d’abord ?
Un logement stable est une condition préalable à l'obtention de résultats positifs dans de nombreux domaines, tels que l'emploi, la santé et l'éducation. Pourtant, un nombre de plus en plus important de ménages en France et dans d'autres pays sont confrontés à des conditions de logement précaires, avec une augmentation significative du nombre de personnes sans domicile. Malgré une large prise de conscience de ces problèmes, les connaissances sur les parcours professionnels des personnes sans domicile et sur l'efficacité des politiques publiques à grande échelle ciblant cette population sont limitées. Ce projet vise à remédier à ces lacunes importantes en étudiant l'impact du sans- domicilisme sur les résultats du marché du travail.