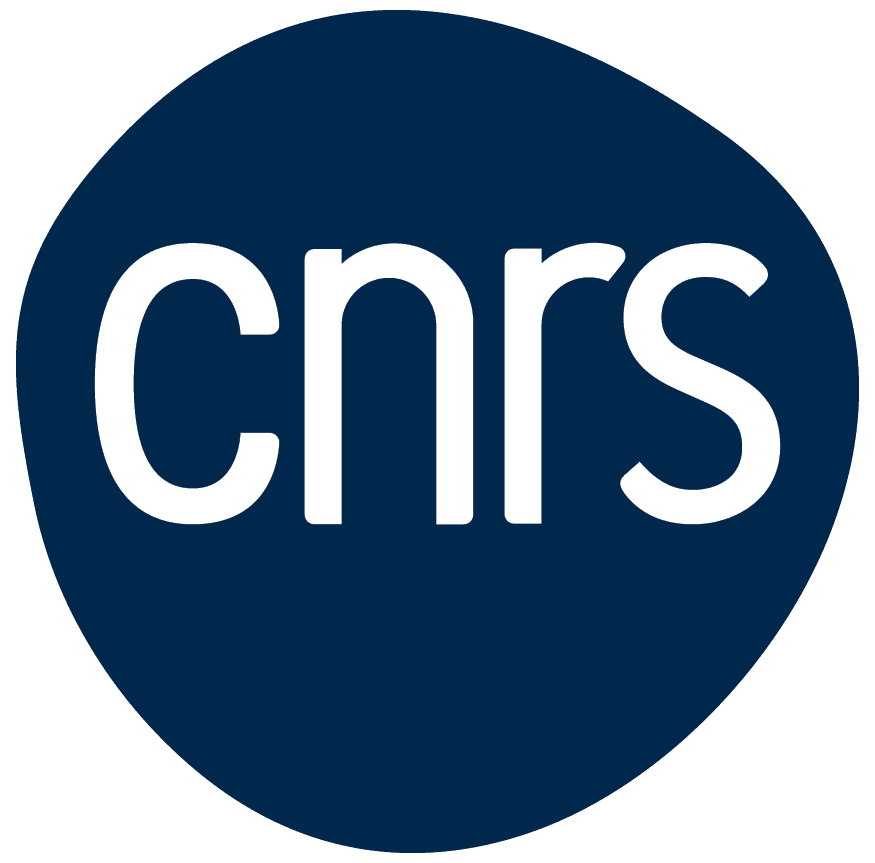Accueil>Trois questions à Sophie Dubuisson-Quellier, sur le Haut Conseil pour le climat

28.07.2025
Trois questions à Sophie Dubuisson-Quellier, sur le Haut Conseil pour le climat
Trois questions à Sophie Dubuisson-Quellier, sur le Haut Conseil pour le climat
Entretien publié dans la lettre CNRS Sciences humaines & sociales du 15 juillet 2025
Directrice de recherche CNRS, directrice du Centre de sociologie des organisations (CSO, UMR7116, CNRS / Sciences Po), Sophie Dubuisson-Quellier conduit des travaux en sociologie économique sur la fabrique sociale des comportements de consommation, à partir de l’analyse du rôle des mouvements sociaux, des politiques publiques et des fonctionnements marchands. Pour CNRS Sciences humaines & sociales, elle revient sur son rôle dans le Haut conseil pour le climat (HCC) et nous présente les grandes lignes du rapport qui vient de paraître.
Madame Dubuisson-Quellier, pouvez-vous nous parler du Haut Conseil pour le climat, de ses objectifs, et du rôle que vous y jouez ?
Le Haut conseil pour le climat est un organisme indépendant chargé d’évaluer l’action publique en matière de climat et sa cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France, en particulier l’Accord de Paris, l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 et le respect des budgets carbone de la France. Il produit non seulement un rapport annuel formulant des recommandations à destination du gouvernement, mais également des rapports ou avis en réponse à des saisines du gouvernement ou du Parlement, et des rapports d’auto-saisine offrant un avis expert et indépendant sur des politiques nationales ; ce fut par exemple le cas en 2025 sur des documents stratégiques du gouvernement comme le Plan pluriannuel pour l’énergie ou le Plan national d’adaptation au changement climatique.
Le Haut Conseil pour le climat est composé d’une quinzaine d’analystes et de treize experts, dont un président. Les domaines d’expertise couvrent les sciences du climat, l’agronomie, les sciences pour l’ingénieur, l’économie, la sociologie. Parmi les treize experts, j’y suis à la fois la seule chercheuse du CNRS et la seule sociologue. Je porte donc la voix de la recherche non seulement en sociologie, mais aussi en science politique, sur les questions liées au climat : cela couvre aussi bien les questions de justice environnementale, que de construction et d’acceptabilité des politiques publiques, ou encore de construction de l’action climatique et de régulation des acteurs économiques. L’enjeu est assez lourd car, contrairement à d’autres secteurs des sciences qui sont parvenus à produire des états de l’art sur ces questions — comme le GIEC a pu le faire pour les sciences du climat — les sciences sociales se sont emparées plus récemment de ce sujet et arrivent en ordre plus dispersé. Nous disposons de moins de travaux de synthèse, alors que paradoxalement les sciences sociales ont produit de très nombreux travaux récemment sur ces questions et sont devenues absolument indispensables pour comprendre les mécanismes qui facilitent ou entravent l’action climatique.
Face à l’urgence climatique, en quoi les sciences sociales sont-elles indispensables ?
Puisque les sciences du climat ont contribué à établir le rôle des activités humaines dans le réchauffement climatique, il est absolument indispensable et urgent de considérer le réchauffement climatique comme un fait social à part entière. C’est-à-dire qu’il est le produit de l’organisation de nos sociétés. Cela signifie dans le même temps que la prise en charge de cette crise, à travers les politiques de transition, engage des changements sociaux profonds. Les sciences sociales sont donc les mieux armées pour comprendre comment nous en sommes arrivés là et à quelles conditions les sociétés pourront se transformer. Elles peuvent apporter leurs connaissances non seulement sur les causes du réchauffement climatique, mais aussi sur leurs impacts. Elles peuvent enfin documenter la manière dont les sociétés réagissent et tous les verrouillages institutionnels et sociaux qu’il est nécessaire de lever pour opérer la transition. Le réchauffement climatique est lié à la manière dont les sociétés se sont développées à travers une dépendance aux énergies fossiles et aux ressources naturelles, institutionnalisée dans des choix politiques et économiques comme le colonialisme, le capitalisme, la globalisation, le libéralisme. La transition écologique suppose de penser ces transformations au-delà de ce qu’on appelle habituellement la « décarbonation » porteuse d’une vision plus technique que politique. En effet, le recours aux énergies fossiles a façonné les modes d’existence et d’organisation des sociétés contemporaines sur le temps long : on ne peut tout simplement pas enlever la brique « carbone » parce que l’ensemble de nos fonctionnements collectifs en dépendent. Il faut donc transformer plus structurellement nos organisations sociales, économiques, politiques, juridiques, redéfinir la manière dont on produit de la valeur et, plus largement, ce qui compte. Le changement social est un mécanisme très complexe qui suppose des transformations institutionnelles prenant en compte les interdépendances organisationnelles et socio-techniques. Les sciences sociales sont indispensables autant pour comprendre les causes et les impacts du changement climatique que les conditions sociales de la transition.
Le nouveau rapport annuel du Haut conseil pour le climat vient de paraître. Est-il possible d’en connaître les grandes lignes ?
Le rapport annuel du HCC permet de suivre les trajectoires d’émission de gaz à effet de serre (GES) des principaux secteurs en France ; il met également au jour les points d’attention comme un secteur du transport et une agriculture qui peinent à atteindre les objectifs, des puits de carbone qui restent insuffisants. Il documente les impacts du changement climatique et évalue les effets des différentes politiques publiques mises en œuvre. Chaque année, nous présentons aussi, dans le chapitre sur la transition juste, les effets sociaux du changement climatique et des politiques publiques qui luttent contre celui-ci. Dans le rapport 2025, ces développements permettent de bien mettre en évidence le triple cadre d’injustice qui se matérialise autour de ces enjeux climatiques. On voit en effet que les populations les plus modestes sont à la fois celles qui sont les plus exposées aux impacts climatiques, du fait de conditions de vie et de formes de vulnérabilités moins favorables. Pourtant ce sont ces populations qui sont les moins contributrices aux émissions de GES, en raison de leurs faibles revenus et niveaux de consommation. Mais malgré tout, ce sont ces populations qui doivent consentir le plus d’efforts face à des politiques de transition qui ont souvent des effets régressifs — c’est-à-dire qu’elles pèsent plus sur les bas revenus — parce que ces populations sont plus contraintes économiquement et ont peu de marge de manœuvre pour financer des modes de vie moins émetteurs. Ces dimensions sociales qui sont indispensables pour penser les politiques de transition et évaluer les politiques climatiques peuvent être éclairées par les travaux de sciences sociales. À cet égard, nous avons besoin de davantage de recherches pour comprendre ces inégalités d’exposition, de contribution et d’effort. On aurait besoin urgemment d’un grand programme de recherche en sciences sociales du climat car nous allons avoir besoin de comprendre, par exemple et parmi de multiples autres questions, comment le changement climatique va impacter les populations, comment les organisations productives, mais aussi celles qui assurent les services de santé ou d’éducation, vont pouvoir s’adapter, comment les tensions sur la ressource en eau vont peser sur les arbitrages politiques aux niveaux territoriaux, comment les marchés du travail vont devoir se reconfigurer pour certains secteurs fortement émetteurs.