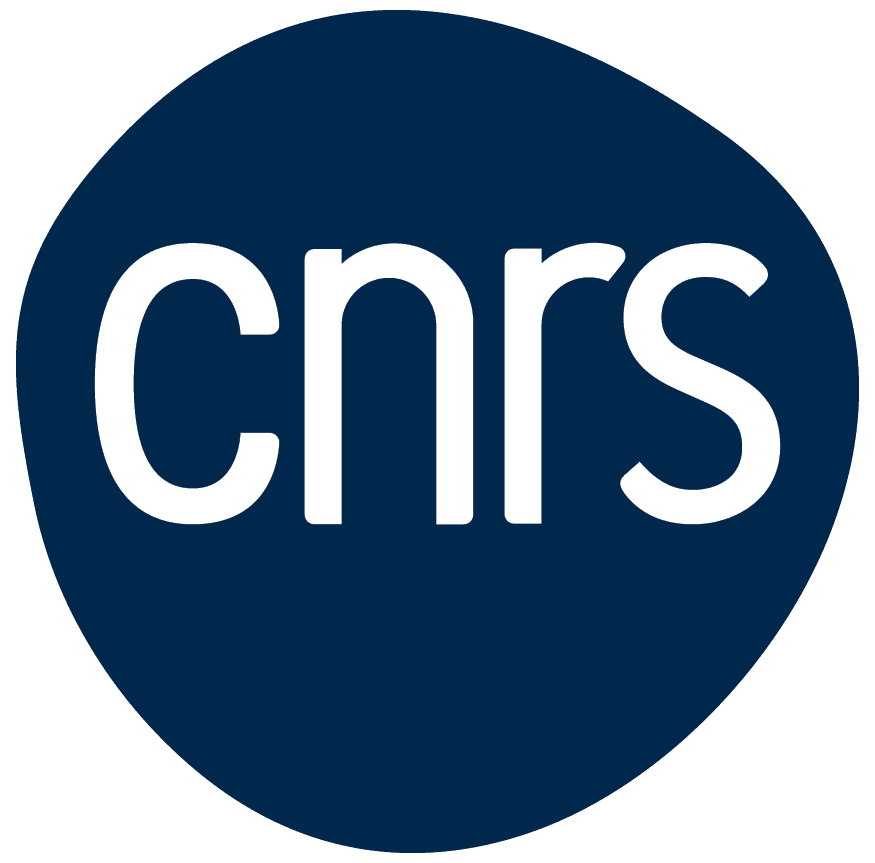Accueil>L’accord de Paris a suscité un extraordinaire apprentissage collectif
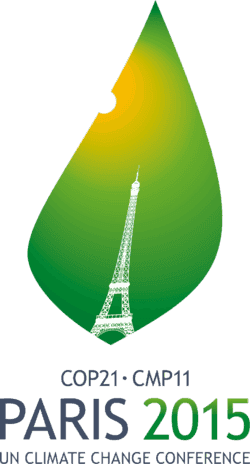
12.11.2025
L’accord de Paris a suscité un extraordinaire apprentissage collectif
L’accord de Paris, en 2015, a été le déclencheur d’une formidable montée en compétences climatiques partout dans le monde, dans tous les domaines et à toutes les échelles. Pourtant, la transition reste bloquée et l’on assiste même à une remise en cause grandissante des politiques environnementales. Parviendrons-nous à repenser notre monde entièrement bâti sur la dépendance aux énergies fossiles, âprement défendues par leurs groupes d’intérêts ? Trois éminentes spécialistes de la question environnementale en débattent ici et soulignent le rôle que peuvent jouer les sciences sociales dans l’identification et la compréhension des obstacles institutionnels et politiques à l’indispensable transformation de la société du carbone.
Pourriez-vous exposer la situation climatique aujourd’hui, en France et dans le monde ?
Sophie Dubuisson-Quellier : Les vagues de chaleur que nous avons subies durant l’été 2025 sont une épreuve de réalité. Elles révèlent l’impréparation de nos sociétés face aux impacts du changement climatique. Elles montrent à quel point certaines catégories y sont plus exposées que d’autres, en particulier les personnes qui travaillent sur les routes, dans le bâtiment, dans la restauration, dans l’agriculture. Les effets sur la santé sont également perceptibles et, contrairement à ce qu’il est souvent affirmé, ils ne concernent pas seulement une petite partie de la population. Cela touche bien entendu les plus vulnérables, mais aussi des personnes en bonne santé, car la canicule met les corps à l’épreuve. Les risques auxquels nous sommes exposés sont à la fois massifs, très inégalement distribués et relativement méconnus, et ils soulèvent de nombreuses problématiques opérationnelles. Comment nos sociétés peuvent-elles continuer à fonctionner si ces risques ne sont pas pris en charge ?
Valérie Masson-Delmotte : L’Europe est la région du monde qui connaît le plus fort réchauffement, si l’on excepte l’Arctique. Aujourd’hui, en France, la température moyenne est supérieure de 2,2 °C à celle du début du XXe siècle. Les vagues de chaleur terrestres, qui ont parfois lieu hors de la période estivale, sont devenues plus fréquentes, plus intenses et plus longues. En Europe de l’Ouest, les phénomènes d’assèchement et d’augmentation de la température sont même plus importants que prévu dans les projections climatiques. Le réchauffement planétaire se poursuit à un rythme rapide, car les émissions de gaz à effet de serre (GES) continuent à augmenter bien que les efforts accomplis aient ralenti les émissions de CO2 dues à la combustion fossile. Si le rythme des dix dernières années se maintient, le monde sera en moyenne plus chaud de 1,5 °C dans seulement cinq ans. Rappelons que l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris était de ne pas dépasser cette limite. Ce niveau a été dépassé pour la première fois durant l’année 2024. Il faut toutefois préciser qu’environ un cinquième du réchauffement que nous connaissons actuellement résulte des progrès accomplis en Europe, en Amérique du Nord et en Chine pour améliorer la qualité de l’air. Les particules de pollution ayant un effet refroidissant, leur diminution a un impact négatif sur le climat. Ces deux facteurs, augmentation des émissions des GES et amélioration de la qualité de l’air, expliquent que le rythme actuel soit plus élevé que prévu.
Les réponses politiques sont-elles à la hauteur ?
V. M.-D. : Les politiques publiques et les engagements actuels, sans renforcement de l’action sur les émissions de GES, impliquent, au mieux, une légère diminution de ces émissions d’ici à 2030. Cela veut dire que la trajectoire des émissions ne suit pas les scénarios de très forte réduction qui seraient nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. À l’inverse, les scénarios de très forte hausse des émissions de GES ne sont plus plausibles, parce que les technologies propres, devenues compétitives, se déploient. En 2024, par exemple, les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables ont représenté le double des investissements dans le secteur fossile. Si l’on extrapole les politiques publiques actuellement mises en œuvre, et sans tenir compte du recul des États-Unis, le réchauffement planétaire devrait atteindre 2 °C vers 2050, environ 3 °C vers 2100, et se poursuivre tant que l’on ne parviendra pas à la neutralité carbone mondiale. Pour la France métropolitaine, cela signifie + 4 °C en 2100 et dix fois plus de vagues de chaleur, qui seront plus intenses et plus longues que durant la seconde moitié du XXe siècle. Autrement dit, une situation intenable. On ne peut pas mettre des climatiseurs partout. On ne peut pas climatiser les mers. Or, les écosystèmes marins et la ressource halieutique sont déjà durement affectés. On ne peut pas mettre les forêts sous cloche. Or, la mortalité des arbres augmente fortement et les forêts dépérissent, ce qui sape leur rôle de puits de carbone. Si nous voulons préserver les écosystèmes, maintenir leurs fonctions et leurs services ainsi que nos conditions de vie, si nous voulons aussi avoir le plus large choix possible d’options d’adaptation, nous avons tout intérêt à limiter le réchauffement à un niveau le plus proche possible de 1,5 °C, et largement sous 2 °C.
Laurence Tubiana : Le déni face aux conséquences dramatiques du réchauffement, y compris au plus haut niveau, est difficile à traiter, et ce sera l’une des missions de la Paris Climate School de Sciences Po. Les responsables politiques se réfugient dans le déni parce qu’il est leur difficile d’adopter une vision systémique, d’inventer une politique radicalement différente de celle qu’ils pratiquent habituellement. Comme ils n’y parviennent pas et que ce défi engendre une forme de panique, ils cherchent des échappatoires.
V. M.-D. : Les responsables locaux qui, eux, sont ancrés dans leur territoire, ont en revanche fait un cheminement. Ils se sont interrogés sur les impacts du changement climatique à leur échelle, sur les ressources, les capacités, les moyens nécessaires à l’adaptation et sur les limites de cette adaptation. Le changement climatique pose à la fois des questions de bien-être, de santé et de cohésion sociale. Si toutes ces questions ne sont pas anticipées, les efforts d’adaptation produiront des résultats très insuffisants et l’on frôlera constamment les situations de crise.
S. D.-Q. : Lors de la vague de chaleur de fin juin-début juillet 2025 en France, par exemple, des établissements scolaires qui n’étaient pas équipés pour accueillir des enfants par des températures aussi élevées ont été fermés. Mais on sait que pour certains enfants, les effets de la chaleur sont peut-être encore plus délétères dans leurs propres logements. Les décisions à prendre sont complexes et les solutions ne sont pas aisées à mettre en œuvre. En protégeant ici, on expose ailleurs, etc. Nous devons impérativement avoir une vision systémique et planifiée des transformations à long terme, comme le préconise d’ailleurs le dernier rapport du Haut conseil pour le climat.
V. M.-D. : Plusieurs travaux récents montrent que l’exposition aux conséquences du réchauffement est très différente en fonction des générations. Les personnes nées pendant les années 1960 ont été et seront bien moins exposées, au cours de leur vie, à des événements de type sécheresse agricole, vague de chaleur, pluie extrême, cyclones de très forte intensité ou incendies graves que des personnes nées pendant les années 1990, elles-mêmes moins exposées que celles nées au cours de la décennie actuelle. Ces travaux montrent aussi que si l’on parvient à limiter le réchauffement non pas à 3 °C, mais à 2 °C, il sera possible de réduire significativement cette exposition cumulée. Un tel constat suffit à justifier un renforcement de l’action collective. Qui a envie de soumettre ses enfants à cette réalité ? Il est crucial de comprendre que les épisodes critiques que nous traversons ont des effets chroniques et durables. Par exemple, la multiplication des sécheresses fragilise les sols et finit par endommager les maisons. La France est particulièrement exposée à la montée du niveau des mers. Cette hausse va se poursuivre à l’échelle des siècles, ce qui confirme le besoin de se projeter sur le temps long. Depuis 1900, le niveau des mers est monté de vingt-trois centimètres et le rythme s’accélère pour atteindre actuellement quatre millimètres par an. Certes, on a révisé le cadre réglementaire, notamment après la tempête Xynthia de 2010, mais les projections de l’élévation n’ont pas été actualisées pour entrer en cohérence avec la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique et avec les nouvelles connaissances scientifiques. Avec 3 °C de réchauffement, le rythme de hausse passerait à un centimètre par an vers 2100, c’est-à-dire que les mers s’élèveraient de vingt-cinq centimètres en un quart de siècle et que nous aurions une chance sur deux de dépasser soixante centimètres de hausse en 2100.
L. T. : Dans l’Ouest de la France, un nombre croissant de municipalités achètent des maisons abîmées par la montée du niveau des mers, les détruisent et indemnisent les propriétaires pour qu’ils puissent se reloger ailleurs. C’est une décision courageuse, mais raisonnée. On observe rarement ce type d’approche au niveau national. La transmission des expériences est par ailleurs une méthode extrêmement puissante pour faire comprendre que les catastrophes qui se produisent au niveau local ont en réalité une dimension planétaire et systémique. C’est le but d’une organisation que j’ai contribué à créer, Conséquences, qui aide ceux qui ont subi des inondations à partager leur vécu, à expliquer comment et pourquoi cela leur est arrivé. Un autre exemple est celui de la politique de lutte contre les îlots de chaleur menée par la Ville de Paris. Cette politique a été raillée par des responsables d’urbanisme travaillant au sein même de la municipalité. Comme si verdir Paris allait défigurer son formidable patrimoine minéral ! Certes, ce n’est pas la solution miracle, mais cela aide. On assistait là à un déni quelque peu aristocratique, à une attitude défensive qui, par méconnaissance, se muait en mépris.
Comment expliquez-vous que les politiques environnementales restent souvent perçues comme des atteintes aux libertés individuelles et des facteurs aggravant des inégalités ?
S. D.-Q. : La notion de cadrage des problèmes publics, élaborée par les sciences sociales, est ici très utile. Depuis qu’elle a émergé, la question climatique a été abordée sous l’angle des responsabilités individuelles. La croissance des émissions de CO2 est attribuée aux modes de vie des pays occidentaux, ce qui met chacun d’entre nous face à la responsabilité de changer ses comportements. Autrement dit, si la transition ne se fait pas, c’est à cause d’un manque de volonté des individus. Ce cadrage a été dramatique, car il a occulté l’essentiel, à savoir que nos modes de vie et nos comportements sont la résultante de nos organisations sociotechniques et institutionnelles. Ils sont le produit du mécano géant que constituent nos structures sociales et leurs interdépendances. Les sociétés occidentales se sont développées grâce aux énergies fossiles, elles ont construit une dépendance collective à ces énergies. Cela ne veut pas dire que nous devons nous dégager de toute responsabilité individuelle, cela signifie surtout que les bons leviers se situent au niveau collectif, dans la construction des politiques publiques et des organisations post-carbone. D’un côté, en mettant l’accent sur la responsabilité individuelle, on a créé du désespoir chez les plus engagés. J’entends ainsi souvent dire : « Ça fait 20 ans que je roule à vélo, que je ne mange plus de viande, que je ne prends plus l’avion, et pourtant il ne se passe rien. » De l’autre côté, on a exigé des efforts de personnes qui ne pouvaient pas les accomplir. Le mouvement des Gilets jaunes traduit bien la révolte de tous ceux que l’on cherche à dissuader d’utiliser leur voiture alors même qu’ils en sont totalement dépendants à cause de l’aménagement du territoire, du prix du foncier, du marché du travail, c’est-à-dire d’autant de décisions collectives. Être en faveur de la transition, ce n’est pas uniquement une question de choix individuel, cela dépend aussi des contraintes socio-matérielles que l’on subit et des possibilités que l’on a d’accéder aux solutions bas carbone. La vision comportementale et hyper-individualisante de la problématique du climat a éloigné de la transition des personnes que l’on a excessivement culpabilisées. Certains partis politiques ne se sont pas privés d’exploiter ces difficultés. Là réside l’une des principales causes de ce que l’on appelle aujourd’hui le backlash écologique. Ce cadrage a aussi eu pour conséquence une très forte polarisation de la société. Cette polarisation, bien étudiée à Sciences Po, traduit la volonté d’une partie de la société de ne pas adhérer à une citoyenneté écologique imposée. L’action climatique est devenue l’affaire d’un groupe social qui a laissé penser que les efforts à réaliser pour la transition étaient à la portée de tous. Les questions de liberté ont alors été largement instrumentalisées. « Les écolos veulent vous empêcher de vivre, ils veulent rajouter des contraintes », entend-on dire fréquemment. La non-prise en compte des savoirs des sciences sociales, que ce soit dans les politiques publiques, dans l’expertise climatique ou encore dans les entreprises, a facilité la prégnance d’un cadrage erroné de la crise climatique.
L. T. : Il faut aussi pointer le rôle de l’économie, qui a abordé le changement climatique comme un problème de déséquilibre, que le marché ne sait pas résoudre, entre l’offre et la demande de biens publics. Autrement dit, dans le jargon économique, comme une défaillance du marché. On s’est massivement employé à corriger cette défaillance en utilisant les instruments classiques, notamment les fameuses taxes sur les carburants. En l’absence de toute infrastructure qui rende possible un changement de comportement, ce type de mesures est tout simplement régressif car il entraîne une baisse du revenu et du bien-être. Par ailleurs, comme les économistes ne savent pas évaluer le coût de l’inaction et qu’ils continuent de privilégier l’idée que l’on sera beaucoup plus riche dans vingt ou trente ans, ils sont tentés de minimiser les problèmes, de reporter toutes les actions à demain ou de mener des politiques régressives. D’où la colère. Aujourd’hui, 79 % des Français pensent qu’ils payent pour les émissions du 1 % de la population que représentent les plus riches. Un exemple frappant est celui des publi- cités sur les SUV, qui restent omnipré- sentes dans les médias alors que, dans le même temps, on nous recom- mande de privilégier la marche pour nos déplacements quotidiens. Ces injonctions contradictoires sont une insulte au bon sens. On ne peut pas à la fois nous inciter à changer nos com- portements et nous assommer de publicité sur les SUV. En 2020, l’une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat a été d’inter- dire ce type de message. Vous ne pou- vez pas imaginer la levée de boucliers qu’elle a suscitée. « Vous allez ruiner les médias ! » « Vous allez porter atteinte à leur indépendance ! » Je suis très choquée par le mépris et l’ar- rogance de différents milieux à l’égard de ceux qui osent dire qu’il va falloir changer le système. Les Gilets jaunes ont été décrits comme anti- écologistes, mais ce n’est pas vrai. La fameuse pétition à un million de signatures qui a lancé le mouvement en 2018 disait que ce n’était pas aux citoyens les plus pauvres de payer pour les erreurs du gouvernement, et elle faisait des recommandations très simples : transportspublics, accèsauxvéhicules électriques bon marché, etc. Bref, elle listait ce qu’il faudrait faire au lieu de simplement imposer une mesure régressive.
V. M.-D. : Je voudrais rebondir sur plusieurs points. Premièrement, sur la désinformation. L’invention du rideau de fumée climatosceptique à destination des journalistes, des décideurs et du grand public date des années 1980 aux États-Unis. Aujourd’hui le climat reste l’une des premières cibles de ces entreprises de désinformation, mais le phénomène s’est déplacé. Il ne se concentre plus sur la réalité du réchauffement ou sur l’influence humaine, il s’efforce plutôt de rendre toujours plus clivants les leviers qui permettraient de décarboner. Cela résulte parfois d’ingérences étrangères, qui ont pour but systématique de paralyser, de retarder les décisions collectives et les transformations. Récemment, le débat public sur les actions à mener en matière d’adaptation a lui aussi été rendu plus clivant. Deuxièmement, j’aimerais aborder les attaques menées contre la science. Depuis les années 1990, les impacts du changement climatique ne cessent de s’aggraver. On sait aujourd’hui que, pour un même niveau de réchauffement, les effets seront beaucoup plus importants que ce que l’on imaginait en 2015 au moment de l’accord de Paris. Dans le même temps, notre expérience de ces impacts s’est accrue, nos capacités d’action sont mieux comprises. Nous savons ce qui peut fonctionner, nous savons qu’il nous faut transformer nos systèmes énergétiques, alimentaires, industriels, urbains, sociaux. Face à notre meilleure compréhension des enjeux de transformation, l’obstruction se durcit. Elle se pense, s’organise, se met en œuvre. Aux États-Unis, cela se manifeste par une volonté cynique et assumée de détruire les sciences du climat, par de la censure, des purges, des coupes budgétaires, etc. On note un vrai changement d’échelle. En Europe et en France, les attaques contre les sciences du climat, de l’environnement et de la biodiversité sont plus insidieuses, mais elles sont également bien présentes. Dans les moments de crise et d’insécurité, la protection de l’environnement sert de bouc émissaire.
Comment lutter contre une construction aussi profondément ancrée ?
V. M.-D. : Nous devons apprendre à penser autrement. Pour revenir à l’exemple du littoral, la gestion de risque a longtemps reposé sur la construction d’ouvrages en dur, mais on a bien vu que cela ne fonctionnait pas, que ces structures pouvaient même devenir des pièges. En certains endroits, il faudra composer avec la nature, en d’autres, il faudra reculer, décider d’aller vivre ailleurs ou habiter des lieux temporaires. Aujourd’hui, on a compris que les choix peuvent ouvrir des possibilités ou au contraire figer les situations, créer des verrouillages.
L. T. : Les enquêtes qualitatives montrent que les écologistes sont détestés parce que perçus comme des Cassandre. On leur reproche aussi leur vision très techniciste et très moralisatrice. J’ai rencontré une jeune femme qui est à l’initiative de Banlieues climat, une association qui sensibilise les populations des quartiers populaires aux questions climatiques et environnementales. Elle m’a décrit la première fois où elle a été confrontée aux organisations écologistes alors qu’elle était chargée des problèmes de santé et de pollution à la municipalité de Cergy-Pontoise. « Voilà des gens d’un autre monde, d’un autre milieu social », m’a-t-elle raconté, outrée. « Des gens qui viennent nous dire, vous, les immigrés, vous ne savez pas gérer les ordures. » Ne pas comprendre à qui l’on parle et comment on parle est très révélateur d’une forme d’enfermement. Voilà pourquoi les écologistes ont été perçus comme les messagers des élites contre le peuple. En tant que militants, ils ont incarné le sujet environnemental et son traitement, et cela les a posés en surplomb de la société. Autant dire que c’est l’échec assuré.
Sous quel angle faudrait-il attaquer le problème ? Quel serait le bon cadrage pour les politiques publiques, pour les entreprises, pour les scientifiques ?
S. D.-Q. : Dans cette discussion, nous cherchons à comprendre pourquoi la transition ne se fait pas, alors que nous aurions toutes les solutions en main comme on l’entend souvent dire. C’est vrai, mais en partie seulement, car les transformations à mettre en œuvre sont en réalité très complexes et structurelles. Depuis deux siècles, nos sociétés se sont entièrement organisées autour du carbone. Il est évident que la décarbonation n’est pas uniquement une question technique, comme s’il existait une brique carbone que l’on pourrait tout simplement retirer de l’édifice. Elle est aussi et surtout institutionnelle. Prenons le sujet de l’automobile. Bien sûr, il est techniquement possible de décarboner la voiture, mais le véritable enjeu n’est pas là. Il est de repenser la mobilité. La voiture individuelle, l’hypermobilité et l’usage des énergies fossiles sont très interdépendants. Or, la notion de décarbonation, héritée d’une vision technocentrée de la transition, fait l’impasse sur ces interdépendances. Repenser la mobilité suppose aussi de repenser l’aménagement du territoire, la question du temps et des distances. Ces défis sont à la fois sociotechniques et politiques. Ils sont sociotechniques, car la technique, comme le disait Bruno Latour, ne saurait se concevoir en dehors de la société dans laquelle elle est inventée ; ils sont politiques, car le développement des énergies fossiles a fait des gagnants et des perdants et il a établi des rapports de force. Ceux qui sont plutôt du côté des gagnants ont peu intérêt à ce que cela change. La structure d’intérêts issue de la société du carbone soutiendra difficilement les options de transition qui lui sont défavorables.
Que peuvent apporter les sciences humaines et sociales dans ce contexte ?
S. D.-Q. : Les sciences sociales contribuent à mettre au jour les verrouillages sociotechniques, institutionnels et politiques de la société du carbone. Par exemple, du macro au micro, depuis la mesure du PIB jusqu’aux instruments de pilotage de la décision économique comme le calcul du retour sur investissement, toute l’instrumentation économique est arrimée à la valeur des fossiles et favorise donc les décisions carbonées. Dans ce contexte de verrouillages très structurels, les injonctions au changement de comportements paraissent de faible portée. Quel poids peuvent avoir les recommandations de limiter les déplacements en voiture quand des zones entières n’ont pas d’alternative, les injonctions à prendre moins souvent l’avion quand la taxation du kérosène rend ce mode de déplacement très compétitif ? En outre, à cause de la moralisation de ces débats, nous passons à côté du fait que les verrouillages structurels tiennent aussi à des pratiques et à des règles professionnelles détenant de fortes valeurs dans notre société. Prenons l’exemple du patrimoine. Les normes d’esthétique et de conservation des bâtiments historiques privilégient, voire imposent, des décisions qui ne sont pas toutes favorables au climat. On le constate avec la difficulté que l’on a à équiper certains immeubles de volets pour les protéger de la chaleur. Il est donc indispensable de faire évoluer les structures concernées en jouant sur les très nombreux instruments, principes et règles qui cadrent les décisions. Enfin, nous devons réfléchir à la question de l’accès aux solutions alternatives et apprendre à séquencer les décisions de manière moins contre-productive. Plutôt qu’augmenter, d’un côté, le prix de l’essence et, de l’autre, donner un chèque énergie pour que l’on puisse consommer de l’essence, on aurait pu commencer par réfléchir à l’accessibilité aux déplacements bas carbone. Autrement dit, concevoir des solutions à la dépendance automobile pour les quelque onze millions de personnes qui sont dépourvues de toute forme de transport collectif. Si l’on prend le cas des zones urbaines interdites aux véhicules les plus polluants – les zones à faibles émissions (ZFE) – pourquoi n’a-t-on pas attendu pour les créer que tout le monde soit équipé de solutions alternatives ? Au lieu de quoi, on a produit des clivages très dommageables à la transition.
L. T. : Dans le cas du charbon, l’Espagne a agi bien plus intelligemment que l’Allemagne. En Allemagne, le gouvernement a annoncé une date de fermeture de toutes les centrales, moyennant quoi les entreprises produisant de l’électricité à partir du charbon ont demandé une compensation équivalente à leur perte d’amortissement jusqu’à cette date. Elles ont appelé ça de la transition juste, alors qu’en réalité cela revenait à payer les pollueurs. En Espagne, au lieu de donner une date de fermeture, on a commencé par discuter avec les syndicats et les élus locaux, puis un processus de transition a été enclenché à l’égard des personnes qui seraient impactées par la fermeture : retraite anticipée, etc. Cet exemple montre qu’il est possible de traiter le problème au moment et à l’endroit où il doit être traité, et non pas à l’envers comme cela se passe bien souvent et qui est très préoccupant. Autre exemple, la France n’est pas encore parvenue à instaurer une formation obligatoire des artisans aux technologies bas carbone. Des rapports le préconisent depuis vingt ou trente ans, mais les organisations professionnelles refusent l’idée d’une formation obligatoire, donc il n’y a pas de formation. Voilà un cas typique de blocage relevant de l’économie politique du travail, alors qu’à l’évidence, les artisans doivent être formés, parce qu’ils ne vont pas inventer des pratiques.
V. M.-D. : Le Royaume-Uni a mené une expérience consistant à distribuer des pompes à chaleur à des employés de petites entreprises, dans l’idée qu’ils les installent d’abord chez eux puis qu’ils mettent à profit cet apprentissage sur leur lieu de travail. Il pourrait être intéressant de créer ce type d’ambassadeurs de transformation. Des gens d’âges, de milieux, de conditions différentes expérimenteraient une pratique qui est souvent source d’inquiétude et de blocage, puis en aideraient d’autres à faire le pas. Cela serait utile, par exemple, pour la conduite de la voiture électrique, qui suscite de nombreux barrages psychologiques. Traditionnellement, on se limite à envisager la décarbonation sous l’angle technique et financier, et l’adaptation, sous l’angle de l’aléa et de l’exposition. En réalité, le point clé, ce sont les vulnérabilités, ce sont les injustices climatiques, qui interagissent avec des inégalités sociales, générationnelles, de santé, de territoires, etc. Si l’on n’agit pas contre ces vulnérabilités, la situation deviendra explosive. Prenons le cas des inégalités territoriales. J’ai récemment assisté à une réunion de l’Ordre des architectes où la situation de Mayotte a été discutée. À Mayotte, tout est à terre. On y voit les ravages de cyclones tropicaux de plus en plus intenses sur des territoires très fragiles. Dans une telle situation, les architectes savent poser des diagnostics rapides afin, par exemple, d’évaluer en quinze jours quelle école, quelle classe pourront être utilisées en sécurité le plus rapidement possible afin d’éviter la discontinuité scolaire et la perte de chance et d’éducation qui s’ensuit. Ils peuvent aussi proposer des solutions abordables pour améliorer la résilience des bâtiments avec des leviers d’action accessibles comme la consolidation des fenêtres, l’ancrage des toitures, etc. Ces approches relativement légères qui permettent d’accroître la résilience de bâtiments existants se heurtent parfois aux normes de l’État sur la dimension des bâtiments, sur les critères de résistance, etc., qui imposent de (re)construire des structures surdimensionnées et hypercoûteuses, donc limitées en nombre. On crée ainsi l’incapacité à agir, alors qu’en s’appuyant sur les compétences locales, sur le retour d’expérience, des solutions très simples et agiles peuvent être très efficaces. Tous ces petits enrichissements aident à inventer des réponses nouvelles. J’ai récemment échangé avec de toutes petites communes rurales sur leur difficulté d’articulation avec les régions et l’État, dont les représentants leur semblent raisonner à partir de cadastres et de cartographies sans forcément connaître les réalités de terrain. Or, sur le terrain, pour mener à bien un projet, l’essentiel n’est pas tant de trouver les financements que de parvenir à construire un dialogue, soit l’exact opposé d’une transition planifiée et descendante. Une transition qui, tout en s’articulant au cadre national, tienne compte des réalités, des besoins et des projets des petites communes, des aspirations de leurs habitants, qui les aide à réfléchir aux possibilités en matière de production d’énergie, d’emploi, d’économie circulaire.
L. T. : Dans la Drôme, qui a connu de très graves inondations en 2023, avec les pertes humaines et les destructions que l’on sait, on a réfléchi collectivement. Moins de 10 millions d’euros ont été investis pour simplement mieux comprendre la circulation de l’eau, puis installer de très grosses canalisations aux endroits inondés. Depuis, des inondations se produisent chaque année, mais sans susciter de dommages. Bien sûr, on n’a pas répété l’erreur de construire des maisons sur des sites inondables, à l’inverse de ce qu’il s’est passé en Inde et au Pakistan, en 2022, où 75 % des grands territoires ont été détruits par les inondations et la Banque mondiale n’a donné de l’argent que pour reconstruire à l’identique. Aujourd’hui, ce type de décision centralisée n’est plus adapté. On ne peut agir différemment qu’à partir du terrain.
En 2025, dix ans après l’accord de Paris, quel bilan en tirez-vous ?
L. T. : Clairement, il a un avant et un après Paris, même si l’après Paris a connu beaucoup d’essais et d’erreurs, notamment en matière de gouvernance environnementale. L’accord a cependant permis de déverrouiller un certain nombre de questions non résolues depuis le sommet de la Terre de Rio, en 1992, en particulier celles tenant à la souveraineté nationale et à la dette climatique, c’est-à-dire à la responsabilité passée. Cet apprentissage collectif et international, bien que parfois assez violent, a été extraordinaire. Dix ans seulement après l’accord de Paris, il n’est plus aucun pays, ou presque, qui n’ait instauré une loi climat, un plan pour le climat, et qui ne se soit forgé une compétence pour comprendre les relations entre les différents facteurs du changement climatique. En France, la résilience est devenue une question politique centrale au HCC. Très franchement, quand il a fallu faire adopter l’objectif de zéro émission net d’ici à 2050 aux pays participants à la COP21, ils ont signé sans bien comprendre tout en étant conscients qu’il y avait urgence à s’entendre, que l’on était face à un drame collectif. Émotionnellement, ce fut un moment très fort. Puis, les pays ont commencé à saisir le sens de cet engagement et à le traduire dans la loi et dans les plans pour les entreprises. Même si, grâce à nos amis du pétrole, des retours en arrière ont déjà été effectués sur les plans de décarbonation des entreprises et des investisseurs, la mobilisation a été considérable. Tout cela en l’espace de dix ans, ce qui n’est rien comparé aux deux siècles de développement du pétrole, du gaz et du charbon. Contrairement à ce qui est souvent avancé, le problème n’est pas tant que les engagements ne sont pas tenus – les gens font ce qu’ils disent –, mais plutôt que les engagements restent trop timides compte tenu de la gravité de la situation. Avant l’accord de Paris, l’hypothèse de réchauffement était de 4 °C, ou même de 5 °C. Aujourd’hui nous sommes probablement autour de 3 °C, et j’espère que l’on fera mieux. Les investissements dans les énergies renouvelables et les avancées technologiques se sont déployés beaucoup plus rapidement que je ne l’imaginais le jour de la signature de l’accord de Paris, le 12 décembre 2015. Je ne croyais pas au déploiement du véhicule électrique, même si ce n’est pas la solution miracle. Je ne croyais pas que le prix des batteries diminuerait de 65 % et le coût de production des panneaux solaires, de 90 %. Bien sûr, il existe des freins. Ils sont actionnés par des acteurs dépendants des énergies fossiles, comme les constructeurs automobiles qui s’efforcent de bénéficier de leur rente le plus longtemps possible. Pourtant, la direction à suivre ne fait plus aucun doute. Le cas le plus intéressant est celui de la Chine. Avant même l’accord de Paris, ce pays a su interpréter l’échec de la COP15 de Copenhague en 2009 et il a investi dans le futur. Comme elle sait si bien le faire, la Chine s’est engagée dans toute la chaîne – les minéraux, les batteries, l’électrolyse, etc. Elle a donc intérêt à ce que l’accord de Paris marche. Cela étant, en dix ans, la situation a notablement changé car il faut désormais investir dans l’adaptation et la résilience. Les gouvernements commencent à intégrer les coûts du changement climatique, qui constituent un levier extraordinairement puissant. Les villes et les régions s’activent, y compris en Chine. Elles ont toutes des objectifs pour 2030 et 2035 beaucoup plus ambi-tieux que ceux prévus par les gouvernements. Les théories de coopération internationale interprètent très bien ce phénomène : quand les contraintes légales sont importantes, l’engagement est minimal. Il est maximal quand les contraintes, les instruments de forçage et les sanctions sont les plus faibles. Cela explique que la Chine pourrait réduire ses émissions d’ici à 2035 de 30 ou 35 %.
Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous paraît le plus urgent, aux échelles internationale et locale ?
V M.-D. : L’avis rendu, en juillet dernier, par la Cour internationale de Justice (CIJ) constitue une avancée significative. La cour a affirmé que les États avaient l’obligation de prévenir les dommages significatifs à l’environnement et qu’ils devaient coopérer de bonne foi pour enrayer le changement climatique. Je suis par ailleurs curieuse de savoir ce qu’il adviendra de l’ambition de sortir des énergies fossiles, esquissée lors de la COP28 de 2023 à Dubaï. Le secteur des énergies fossiles représente 60 % des émissions de GES. Le système alimentaire pèse, quant à lui, à peu près 30 %. Or, ce dernier est particulièrement exposé au risque climatique et aucune réflexion structurée ne semble poindre à ce sujet.
L. T. : On y vient enfin. Au moment de l’accord de Paris, il était interdit de parler de l’agriculture. Je me souviens du président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) déclarant : « Si cet accord se fait pour développer l’agriculture biologique, je le bloquerai. » Bloquer l’accord de Paris était un peu au-delà de ses compétences, mais voilà le type de raisonnement que l’on pouvait alors entendre. Aujourd’hui, plus de 1 500 procès sur le climat sont en cours dans le monde. Ils sont généralement fondés sur les droits humains, notamment ceux des futures générations, et sur le respect de l’accord de Paris. Il y a eu le procès contre Shell, alors que Shell, en tant qu’entreprise, n’est pas partie prenante de l’accord de Paris. Il y a eu la Cour constitutionnelle allemande, qui a reproché au gouvernement de ne pas respecter ses engagements. Cette décision a créé un choc incroyable en Allemagne, car elle a utilisé un accord international comme cadre légal national. Il y a eu le tribunal administratif de Paris enjoignant l’État français de réparer le préjudice écologique causé par le non-respect de la stratégie nationale bas carbone, et il ne fait pas de doute que d’autres procès vont suivre contre le gouvernement français. Les tribunaux, le Conseil d’État, les juges administratifs, les Cours suprêmes sont maintenant capables de comprendre le climat. Par porosité entre le droit national et le droit international, si l’on peut dire, une force légale est parvenue à faire exister le caractère contraignant de l’accord de Paris.
V. M-D. : Le tribunal international du droit de la mer (TIDM) a aussi considéré le CO₂ comme un polluant.
L. T. : Et l’Ukraine va porter plainte contre la Russie pour les dégâts environnementaux, y compris climatiques, causés par la guerre.
V. M-D. : Depuis 2015, les tensions géopolitiques se sont accrues, les conflits se sont multipliés, les investissements dans le secteur militaire et celui de la défense ont augmenté au détriment des autres priorités. Cela rend encore plus difficile la construction d’une paix résiliente dans un climat qui se réchauffe, en particulier dans les régions où l’approvisionnement en eau suscite des tensions grandissantes. En même temps, on assiste à la montée en compétences de beaucoup de personnes, dans de nombreux domaines et secteurs différents, avec pour effet d’accroître la redevabilité des politiques publiques. Les conseils et groupes régionaux d’experts climat, par exemple, mettent les faits sur la place publique. Les citoyens sont eux aussi de plus en plus nombreux à se sentir concernés. La demande d’évaluation indépendante des politiques publiques, notamment à l’échelle des villes ou des régions, est de plus en plus pressante.
S. D.-Q. : Les productions du HCC ont acquis une légitimité et une robustesse scientifiques incontestables.
V. M-D. : Nous atteignons un niveau d’interdépendance entre les écosystèmes, la biodiversité, la société humaine et le climat pour lequel les cadres de décision n’existent pas encore. Nos politiques publiques restent largement conçues en silos. « Nexus », le rapport d’évaluation 2024 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques [Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES] consacré aux interactions entre l’eau, l’alimentation, l’agriculture, la santé, l’énergie et le climat est très instructif à cet égard. Nous devons mettre en place des cadres de formation et de réflexion plus ouverts sur toutes ces interdépendances, comme entend le faire la Paris Climate School de Sciences Po.
Accèder au site Conférence de Sciences Po l’espace où Sciences Po affirme sa vocation : éclairer les grands enjeux contemporains à la lumière des sciences humaines et sociales.