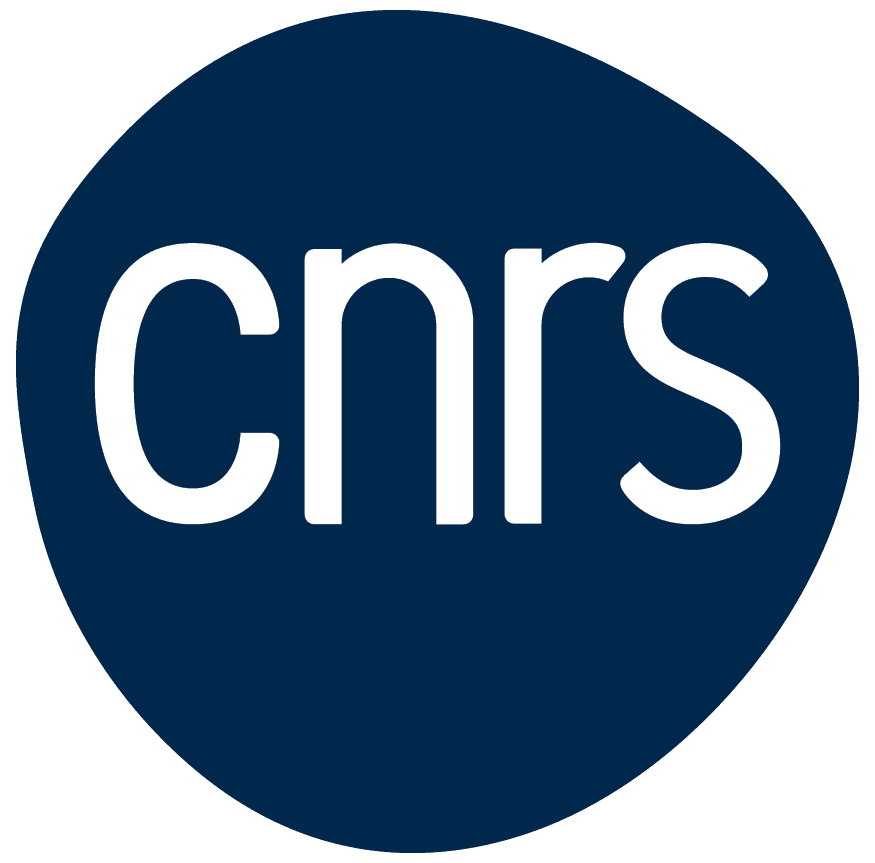Accueil>Entretien avec Martin Sarzier, nouveau chercheur au CSO

13.10.2025
Entretien avec Martin Sarzier, nouveau chercheur au CSO

Depuis septembre, le Centre de sociologie des organisations (CSO) accueille Martin Sarzier au poste d’assistant professor en sociologie. Rencontre avec ce nouveau chercheur.
“ Mes recherches passées et présentes prêtent attention à la reproduction d’inégalités de différentes natures dans les espaces sanitaire et gérontologique. ”
Dans votre thèse, vous vous êtes intéressé à l’émergence et à l’établissement de la gérontopsychiatrie. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cet objet ?
Mon intérêt pour la santé mentale, d'une part, et le vieillissement, d'autre part, remonte à mes années de Master. Quelques lectures marquantes et plusieurs séminaires ont éveillé ma curiosité pour ces questions. Il n'est dès lors pas surprenant que le cas de la gérontopsychiatrie – c'est-à-dire de la psychiatrie des personnes âgées – ait attiré mon attention. C'est ainsi avec l'idée de mener une enquête ethnographique dans un service de psychiatrie spécialisé dans la prise en charge de la vieillesse que j’ai débuté mon mémoire de Master 2. Enquêter sur le travail hospitalier me semblait être une bonne manière de tenir à distance ma fascination ancienne, que je savais naïve, pour le problème de la folie. J’avais également conscience du risque de misérabilisme inhérent à une enquête sur la vieillesse.
Mes premières lectures et entretiens exploratoires avec des gérontopsychiatres m'ont rapidement convaincu de me pencher plutôt, au moins dans un premier temps, sur les dynamiques professionnelles qui agitaient alors depuis une dizaine d'années cet espace spécialisé. Ses porte-paroles s'alarmaient en effet d'un « retard » français en matière de développement de la gérontopsychiatrie et semblaient rencontrer des difficultés à la faire reconnaître. L'émergence et l'établissement de la gérontopsychiatrie m'ont alors semblé constituer un intéressant cas d'étude des processus de spécialisation qui traversent et structurent la profession médicale. C’est avec le projet d’étudier les dynamiques d’autonomisation et de légitimation de cette « sur-spécialité » que je me suis inscrit en thèse, sous la direction d’Anne Paillet.
Quels sont, selon vous, les principaux apports de cette recherche ?
Les travaux de sciences sociales qui s’intéressent aux dynamiques de spécialisation médicale ont pour point de départ une critique de la tradition historiographique issue du monde médical, parfois qualifiée de « iatrocentrique », c'est-à-dire centrée sur le médical. Cette tradition tend à présenter la spécialisation comme le produit logique et inévitable de découvertes diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, elle en sous-estime la contingence et ignore la multiplicité de ses causes. Elle masque en particulier les rapports de force et de concurrence, les négociations et les conflits qui déterminent l'évolution de la profession médicale.
Dans le prolongement de ces recherches sociologiques et historiques, j’ai proposé d’envisager la spécialisation médicale comme un jeu social complexe, à la fois multiscalaire et relationnel. L’originalité de mon travail de thèse est d’avoir pris le parti d'étudier la spécialisation médicale au travail, et ce dans un double sens. Il s'agissait, d'une part, d'analyser ce processus à l'œuvre, en train de se faire, sans présupposer son devenir, et, d’autre part, de l’étudier sous l'angle des situations, des pratiques et des rapports au travail des différents professionnels de la gérontopsychiatrie. L’autonomisation et la légitimation d’une nouvelle (sur-)spécialité ne constituent pas un processus abstrait : elles reposent sur des activités concrètes, conduites dans différents espaces de travail par une grande diversité de professionnels. L’idée était de mobiliser certains outils de la sociologie du travail pour répondre à des questionnements plus traditionnellement formulées par les sociologues des professions, et de contribuer ainsi à une sociologie du travail de professionnalisation.
Pour saisir la spécialisation en train de se faire, j'ai mené une enquête de longue durée au sein de l'espace gérontopsychiatrique, à la fois « par le haut » et « par le bas », articulant différentes méthodes d’enquête (observations à l’hôpital et dans des congrès, entretiens, archives, analyses statistiques). Parce qu’il serait fastidieux d’en résumer les principaux résultats, je me contenterai de souligner brièvement l’un des apports transversaux de cette recherche. Ma thèse montre que les processus de spécialisation médicale, et les dynamiques organisationnelles qui les accompagnent, tendent à reproduire voire à accentuer des inégalités de différentes natures : inégalités matérielles et symboliques entre services hospitaliers, en fonction de leur position dans l’espace professionnel ; inégalités entre professionnels suscitées par la réorganisation de leurs faisceaux de tâches ; inégalités d’accès au soin, du fait de la tendance des professionnels à sélectionner de « bons patients », jugés conformes à leur mandat ; inégalités et différenciations de traitement, liées à l’intensification du travail, aux injonctions gestionnaires à la réduction des durées de séjour ou encore aux dynamiques de standardisation des pratiques diagnostiques et thérapeutiques, autant de dynamiques accentuées par le contexte de spécialisation.
À l’occasion d’une recherche post-doctorale, vous avez justement travaillé sur les inégalités sociales de santé, cette fois-ci dans les prises en charge des troubles cognitifs. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Après la soutenance de ma thèse, j’ai débuté une recherche post-doctorale financée par l’ERC Gendhi (Gender and Health Inequalities) et encadrée par Muriel Darmon. Ce programme de recherche interdisciplinaire, associant sociologues, démographes, épidémiologues et économistes, vise à comprendre comment le genre s’articule à d’autres rapports sociaux pour produire des inégalités sociales de santé tout au long du parcours de vie. Au sein de l’équipe « vieillissement », j’ai commencé à enquêter dans des institutions de prise en charge de personnes de plus de 65 ans auxquelles ont été diagnostiquées des troubles cognitifs, à réaliser des entretiens avec des patients ainsi qu’à exploiter des bases de données quantitatives. Cette recherche, toujours en cours, vise d’abord à montrer par quels mécanismes se reproduisent des inégalités d’accès aux soins. Des travaux soulignent notamment que les personnes vieillissantes, en fonction de leurs socialisations de classe et de genre, tendent à consulter puis à être prises en charge plus ou moins tardivement après la survenue des premiers symptômes. Une autre hypothèse de recherche est que, dans les institutions où je mène l’enquête, la prise en charge produit des effets différenciés sur la patientèle. Celle-ci repose en effet largement sur un travail de socialisation au « bien vieillir », inégalement efficace selon les trajectoires sociales et les expériences socialisatrices antérieures des patients.

Vous développez également une réflexion sur les rapports d’âge. Qu’entendez-vous par là ?
Ce n’est qu’après avoir entamé ma recherche doctorale que la question de l'âge a acquis une place centrale dans mes intérêts de recherche. Au moment de la débuter, j'entendais bien sûr entrer en dialogue avec la sociologie de la vieillesse et du vieillissement. Mais c’est la conduite de l’enquête qui a suscité mon intérêt pour les rapports d’âge. Cette préoccupation rejoignait celle de collègues travaillant sur d’autres catégories d’âge (en particulier les jeunes et les enfants) avec lesquels j’ai coordonné pendant trois ans le laboratoire junior RÂGE, créé à l’initiative de Simon Protar et Lucie Wicky. Au sein de ce collectif de recherche, mais aussi du laboratoire CITERES de l’Université de Tours, auquel j’ai été un temps associé, nous avons conduit, à la suite d’autres chercheuses et chercheurs, une réflexion sur les apports et les limites de l’analogie entre l’âge et les rapports sociaux de genre et de race. Une telle démarche ouvre l’imagination sociologique ! Elle invite à envisager l’âge comme une relation antagonique entre des groupes d’âge majoritaires et minoritaires, produits par cette relation. Mais l’analogie a aussi pour vertu de mettre en relief les spécificités de l’âge.
Comment analysez-vous le déclassement que peuvent ressentir les personnes âgées dans notre société ?
Dans notre société, la vieillesse peut être considérée comme un statut social stigmatisé. Enquêter auprès de celles et ceux qui sont désignés comme « vieux » ou « vieilles » permet d’en prendre la mesure. Dans les services hospitaliers de gérontopsychiatrie où j’ai mené mon enquête doctorale, j’ai été frappé par les contestations que nombre de patients opposaient à leur prise en charge en tant que « personnes âgées ». Des patients indiquaient aux professionnels qu’ils n'étaient « pas des petits vieux », que contrairement aux autres ils n’étaient ni « séniles » ni « grabataires », et qu’ils n’avaient dès lors « rien à faire ici ». Certains mettaient même en œuvre des stratégies de distinction explicites vis-à-vis des « vieux » et « vieilles » qu’ils étaient amenés à côtoyer. L’hospitalisation en gérontopsychiatrie semblait perçue, notamment par les patients membres des classes supérieures, comme une forme de déclassement.
Pour donner sens à ces réticences et à ces résistances, j’ai analysé l’hospitalisation et la prise en charge gérontopsychiatriques comme des formes, parmi bien d’autres, d’âgisation. En partant, à la suite notamment des travaux de Juliette Rennes, des apports et limites de son analogie avec la notion de racisation, j’ai proposé de définir l’âgisation comme l’ensemble des mécanismes qui concourent à la production de l’âge comme un système hiérarchisé entre les âges de la vie et à l’assignation de groupes ou d’individus à des statuts d’âge minorisés. Les personnes « âgisées » se trouvent renvoyées aux marges de l’adultéité, et tendent à se trouver altérisées, uniformisées et essentialisées. Autrement dit, elles sont exclues de ce statut majoritaire socialement valorisé, tout en étant définies par rapport à celui-ci. Le sentiment de déclassement vécu par les personnes qui vieillissent, auquel contribuent ces assignations d’âge, est ainsi le revers de la valorisation de l’âge adulte. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’à âge chronologique égal, toutes les personnes ne sont pas également âgisées : les femmes et les membres des classes populaires, notamment, font l’objet d’assignation à la vieillesse plus précoces.
En matière d'enseignement, vous assurez notamment un cours sur le campus de Nancy de Sciences Po intitulé « Grandes enquêtes sociologiques ». Que souhaitez-vous transmettre aux étudiants ?
Je suis ravi de m’être vu confier, à mon arrivée, l’un des « grands cours » de sociologie de deuxième année. Dans le prolongement du cours d’introduction à la sociologie de première année, cet enseignement a vocation à initier les étudiantes et étudiants de la majeure « Économies et sociétés » à l’enquête sociologique. Bénéficiant des conseils des collègues qui donnent ce cours sur d’autres campus, j’ai choisi de m’arrêter sur un nombre limité d’enquêtes considérées comme « emblématiques » d’époques, de courants ou de styles de démarche empirique différents, afin de mettre en lumière les enjeux méthodologiques, épistémologiques, politiques et éthiques que soulève la pratique de la sociologie. Il ne s’agit nullement de considérer ces « grandes » enquêtes comme des modèles, mais d’en cerner les apports, souvent décisifs, comme les limites. L’un des fils directeurs du cours est précisément de comprendre les conditions d’accès de ces enquêtes à la postérité, de comprendre comment elles ont été canonisées, en s’attardant sur leur réception, parfois chaotique, et sur leur héritage dans l’histoire des sciences sociales. Cette découverte de la sociologie comme science de l’enquête se prolonge dans les conférences de méthodes associées à ce cours magistral, pour lesquelles les étudiantes et étudiants sont amenés à réaliser une enquête en binôme sur un sujet de leur choix.
En arrivant au CSO, quels sont vos projets à venir ?
Au CSO, j’aimerais d’abord contribuer, aux côtés de mes nouveaux collègues, à l’étude de la fabrique organisationnelle des inégalités. Comme je l’ai évoqué, mes recherches passées et présentes prêtent attention à la reproduction d’inégalités de différentes natures dans les espaces sanitaire et gérontologique. À ce titre, nous organisons, avec Manisha Anantharaman et Émilie Biland-Curinier, un cycle de présentations intitulé « Organisations et inégalités », qui se tiendra dans le cadre du séminaire doctoral du CSO, que j’ai le plaisir de co-animer.
À partir de l’enquête débutée dans le cadre de mon post-doctorat, j’aimerais m’intéresser à la manière dont les institutions pour « personnes âgées » participent à ce que je propose d’appeler la « socialisation d’âge » des personnes qui les fréquentent. En d’autres termes, je souhaite étudier les processus par lesquels les individus assignés à la vieillesse en viennent à se vivre comme « vieux » et à agir en cohérence avec cette perception d’eux-mêmes. Une telle approche me semble d’autant plus originale que la sociologie de la socialisation s’est peu emparée de la question du vieillissement, reconduisant implicitement le préjugé selon lequel, en vieillissant, les individus perdraient en « flexibilité » ou en « malléabilité » dispositionnelle.
Dans un second temps, je compte étudier la manière dont l’ordre de l’âge fait l’objet de contestations non seulement individuelles mais également collectives. En ce sens, j’envisage de constituer en terrains d’enquête des associations anti-âgistes.
Enfin, plus largement, j’aspire à contribuer, par ces différents travaux, à une sociologie de l’âge (au singulier), défini comme un système de division hiérarchique entre des âges statutaires.
(crédits : Alexis Lecomte)