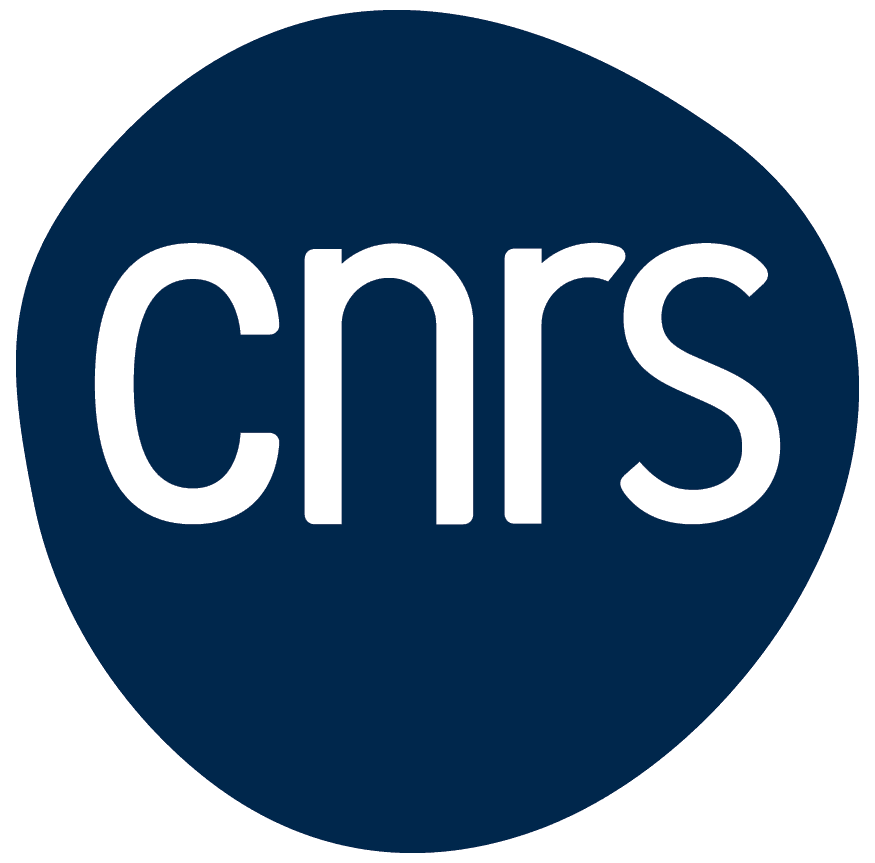Accueil>Pourquoi les partis politiques français fuient-ils l’exercice du pouvoir ?

22.09.2025
Pourquoi les partis politiques français fuient-ils l’exercice du pouvoir ?
Nommé à Matignon, Sébastien Lecornu se heurte à une impasse politique : il doit construire une coalition alors que la plupart des partis semblent réticents à participer au gouvernement. Comment comprendre ce désintérêt pour l’exercice du pouvoir ? Olivier Costa, chercheur au CEVIPOF, éclaire cette situation à travers les spécificités institutionnelles du parlementarisme à la française.
Sébastien Lecornu a pour mission de faire fonctionner les institutions de la Cinquième République comme un régime parlementaire. Michel Barnier et François Bayrou ne s’y sont pas vraiment essayés : ils ont imposé leur équipe et leur programme, et se sont contentés de se dire ouverts au dialogue avec les autres forces politiques. Le nouveau Premier ministre s’emploie pour sa part à construire une coalition majoritaire ou, a minima, à s’engager formellement à ne pas le censurer. Pour cela, il parle à tout le monde, se montre ouvert sur son programme et prend le temps de négocier. Il bénéficie du changement de configuration à gauche ; la crise qui affecte le Nouveau Front Populaire rend en effet le PS, le PCF et les Verts moins dépendants de LFI et plus à même de négocier avec le Premier ministre. Cependant, rien n’indique pour l’instant qu’un parti extérieur à la coalition du centre et de la droite soit prêt à participer au gouvernement ou, à tout le moins, à s’engager formellement à ne pas le censurer.
Les partis sont-ils prêts à jouer le jeu du parlementarisme ?
Pour évaluer les chances de Sébastien Lecornu d’élargir son assise à l’Assemblée nationale, il faut revenir à ce qui motive les élus en général, et les parlementaires en particulier. On peut distinguer trois objectifs principaux.
Le premier est la carrière : l’ambition de la grande majorité des députés est de conserver leur mandat ou de conquérir une autre fonction politique prestigieuse. De nombreux citoyens s’en désolent, et critiquent le phénomène de « professionnalisation » de la vie politique qui affecte les démocraties contemporaines. Il faut toutefois rappeler que les parlementaires doivent, pour la plupart, interrompre leur carrière pour exercer leur mandat, et qu’il n’est pas forcément aisé pour eux d’y revenir. Beaucoup d’élus sont donc en quelque sorte prisonniers de leur choix de s’engager en politique, et font le nécessaire pour y durer.
Le deuxième objectif d’un élu est de promouvoir ses idées, ses propositions et ses valeurs, et donc d’être en situation de les mettre en œuvre. De même, les partis sont des organisations qui ont, en principe, pour objectif la conquête du pouvoir ; seuls les mouvements radicaux n’y aspirent pas nécessairement, car ils s’inscrivent dans un rejet radical du système politique ou refusent de faire les concessions qu’exige la participation à une coalition gouvernementale.
Le troisième objectif de la plupart des élus est de veiller aux intérêts de la collectivité dont ils sont les représentants – ville, département, région ou pays. Si cet aspect est souvent moqué ou tourné en dérision, il reste malgré tout un motif majeur de l’engagement en politique.
Les élus arbitrent différemment entre ces trois objectifs : certains renieraient leurs idées pour un poste, tandis que d’autres sont prêts à rester d’éternels opposants pour défendre leurs idées, et d’autres encore sont disposés à se retirer d’une élection pour empêcher le succès de leurs adversaires politiques.
Dans des circonstances normales, l’ambition des élus devrait néanmoins être de gouverner, quelle que soit l’élection à laquelle ils participent. En effet, les trois objectifs mentionnés les y poussent : accéder au pouvoir, c’est tout à la fois disposer de davantage de ressources pour poursuivre sa carrière politique, mettre en œuvre ses idées et servir une certaine conception de l’intérêt général. Dans un régime parlementaire classique – comme l’Allemagne, la Belgique ou l’Italie – le graal pour un parti est d’appartenir à la coalition gouvernementale. Ils ne l’excluent que si son centre de gravité est trop éloigné de leurs orientations politiques, si leurs partenaires exigent des concessions déraisonnables, ou s’ils sont dans une démarche d’opposition frontale au régime.
Les spécificités du régime semi-présidentiel français
En France, la situation est différente. Les spécificités du régime semi-présidentiel impliquent que l’objectif central des partis et de leurs membres n’est pas de participer au gouvernement mais de conquérir l’Élysée. C’est en effet le lieu cardinal du pouvoir, réel et symbolique, de sorte que les principaux partis sont devenus des organisations au service des ambitions présidentielles d’un homme ou d’une femme. En somme, les institutions de la Cinquième République ont amené les députés et les partis à analyser leurs priorités autrement que dans les régimes parlementaires.
Les responsables politiques français sont ainsi tous animés par la volonté d’accéder à l’Élysée et par la conviction qu’il est nuisible pour cela d’entrer au gouvernement en cours de mandat présidentiel. En effet, sous la Ve République, aucun Premier ministre sortant n’a jamais été élu Président. Plus spécifiquement, les situations de cohabitation ont toutes été préjudiciables au Premier ministre. La première (1986-1988) a vu Jacques Chirac perdre contre le Président sortant François Mitterrand. La deuxième (1993-1995) s’est conclue par l’échec d’Edouard Balladur au premier tour de la présidentielle, et par la victoire de son rival Jacques Chirac. La troisième (1997-2002) a vu le premier ministre Lionel Jospin échouer lui aussi au premier tour de la présidentielle, et a abouti à la réélection de Jacques Chirac. En somme, sous la Cinquième République, les présidents n’ont été réélus qu’à l’issue d’une période de cohabitation (Mitterrand en 1988 et Chirac en 2002) et/ou d’un duel au second tour avec un candidat d’extrême-droite (Chirac en 2002 et Macron en 2022).
L’ombre des prochaines élections présidentielles
Plus largement, dans le contexte difficile que connaissent les démocraties libérales, il existe une prime aux partis d’opposition. Ces derniers peuvent axer leur campagne sur la critique du bilan des sortants, dans un registre plus ou moins populiste, et sans devoir préciser leurs propres propositions et solutions. Face au « dégagisme » et à l’érosion de plus en plus rapide de la popularité des têtes de l’exécutif, les responsables politiques considèrent qu’il est peu avantageux de se présenter aux élections en étant aux responsabilités. La règle est valable pour toutes les élections : les présidentielles, mais aussi les municipales, les départementales, les régionales et les européennes. Elles sont en effet l’occasion pour une partie de l’électorat de désavouer l’action du gouvernement et du Président. Cela vaut également pour les élections législatives qui interviennent en cours de mandat présidentiel (1986, 1993, 1997, 2024), et même, par une sorte de dérèglement des institutions de la Cinquième République, pour celles qui suivent directement la présidentielle (2022).
On pourrait penser que l’ampleur de la crise politique et sociale que traverse la France aujourd’hui donne à Sébastien Lecornu les meilleures chances de succès. Après les échecs des gouvernements Barnier et Bayrou, et face à l’urgence d’adopter un budget pour 2026, de calmer la colère sociale et de redresser l’image du pays vis-à-vis de ses partenaires européens et des agences de notation, les partis concernés par le sort du pays devraient se montrer conciliants. S’ils refusent d’entrer au gouvernement, ils pourraient négocier les conditions de l’absence de censure. Mais rien n’est moins sûr. La manière dont les responsables politiques analysent leurs intérêts – carrière, promotion de leurs idées, poursuite du bien commun – les incite à rester dans l’opposition, pour se donner les meilleures chances de l’emporter en 2027.
Une ressource paradoxale pour Sébastien Lecornu ?
Est-ce à dire que la mission de Sébastien Lecornu est vouée à l’échec ? Paradoxalement non, là encore en raison des obsessions élyséennes des uns et des autres. Si le Premier ministre va sans doute se heurter au faible enthousiasme de ses interlocuteurs pour s’entendre avec lui, il pourrait aussi tirer profit de leur peu d’entrain à gouverner. En effet, une fois son équipe constituée, les leaders de l’opposition n’auront pas d’intérêt immédiat à sa chute et préfèreront sans doute le laisser en poste jusqu’en 2027. Cela leur permettra de faire des élections municipales un test de popularité pour le gouvernement, puis d’aborder la présidentielle dans la position la plus favorable, celle d’opposants à l’exécutif sortant. La passion des responsables politiques français pour l’élection présidentielle est donc tout à la fois la principale difficulté que doit affronter le Premier ministre pour former son équipe, et sa meilleure ressource pour durer à Matignon.
Cette analyse a été publiée le 22 septembre sur Conférence, le nouveau site de décryptages et d'analyse de Sciences Po.
Nous contacter
Adresse : 1 place Saint-Thomas d'Aquin, 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 49 54 39 00
Courriel : info.cevipof@sciencespo.fr