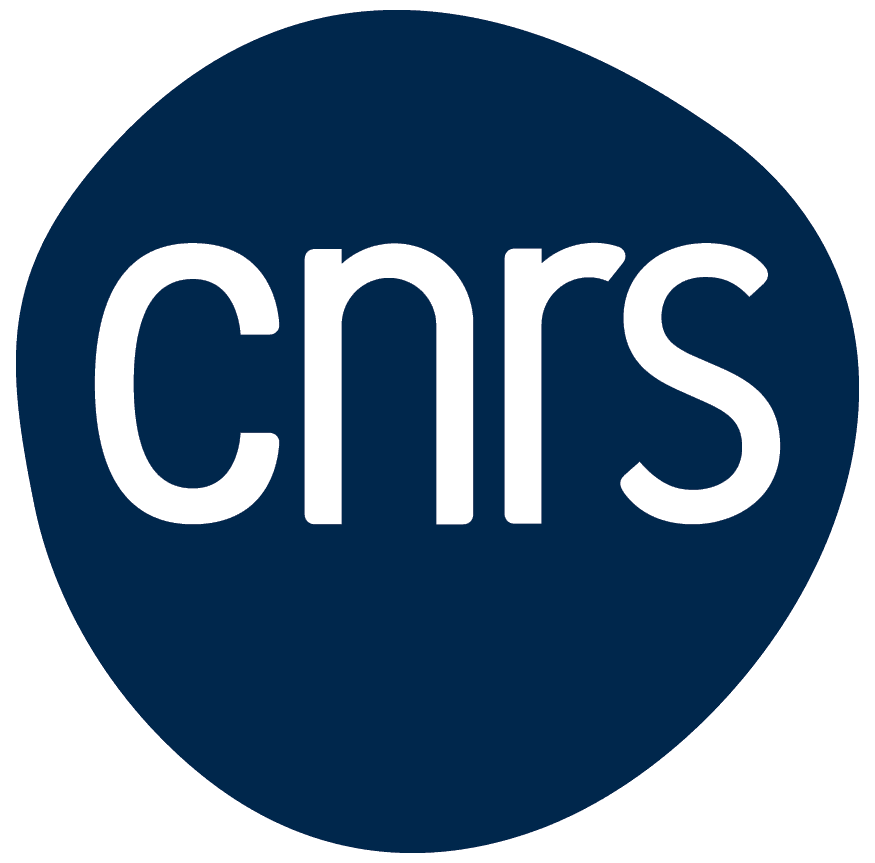Accueil>Fractures françaises : une nouvelle matrice sociopolitique
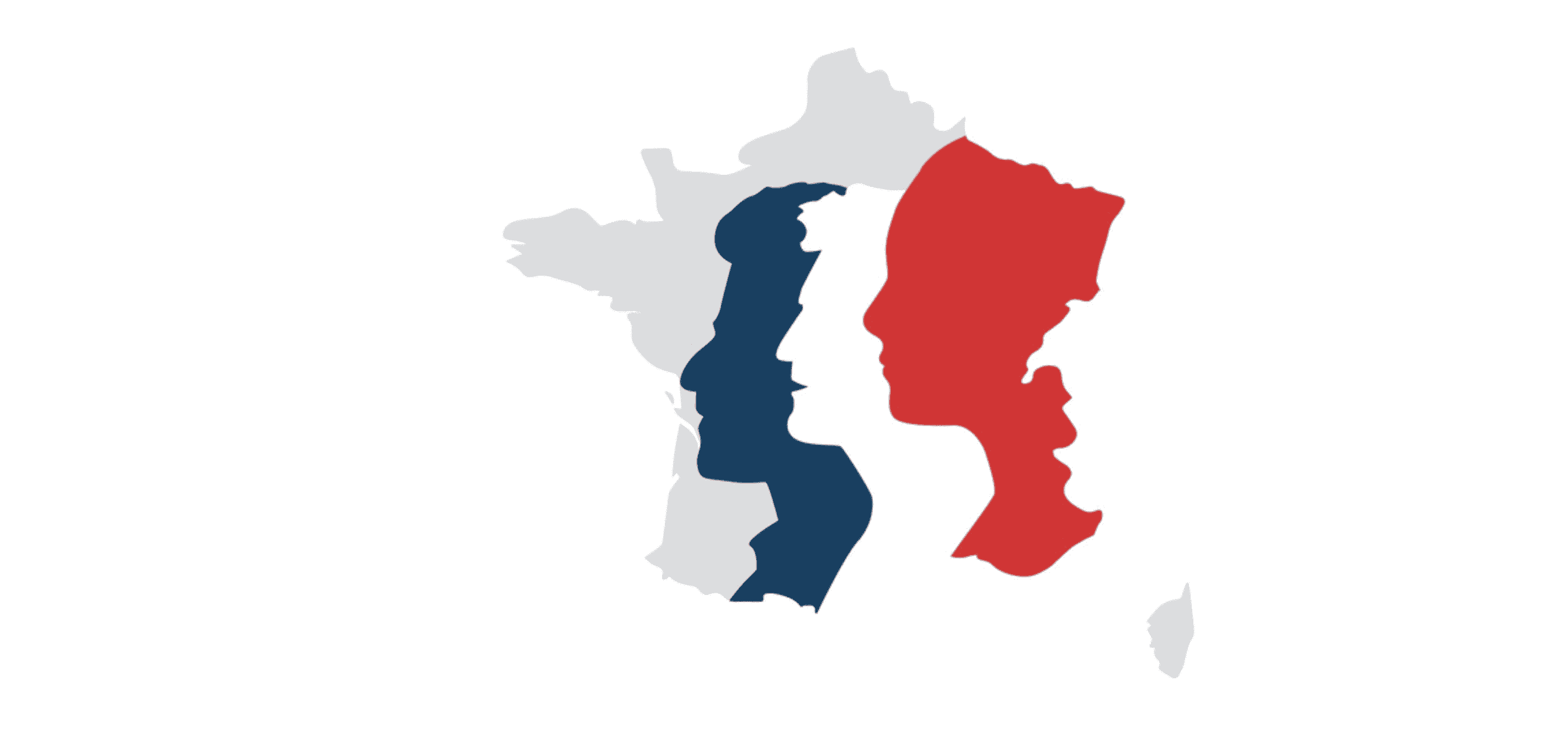
05.11.2025
Fractures françaises : une nouvelle matrice sociopolitique
Au-delà des oppositions gauche-droite, Luc Rouban identifie trois grands groupes sociaux qui structurent désormais la vie politique française. Une typologie inédite pour comprendre la montée du RN et la crise durable de la représentation.
La nouvelle vague de l'enquête Fractures françaises montre que le paysage sociopolitique français connaît une transformation profonde. Ce changement ne peut être réduit à une seule variable, comme la lutte des classes ou le fossé générationnel. Les représentations subjectives des trajectoires sociales, les facteurs géographiques, les conditions de vie ainsi que les ressources économiques et culturelles s’entrecroisent et s’influencent mutuellement. Le paysage politique ne se résume donc plus à quelques clivages simples, mais s’organise désormais autour de trois grands ensembles distincts. Cependant, cette nouvelle matrice sociopolitique ne correspond pas à celle des clivages partisans.
C’est dans ce décalage profond entre ces deux matrices que résident les causes structurelles de la crise politique française.
Un paysage politique en recomposition profonde
Dans la sixième note de la collection Fractures françaises, Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, analyse la nouvelle matrice sociopolitique française à partir des données de la 13ᵉ vague de l’enquête.
Dans un contexte marqué par l’instabilité gouvernementale et une défiance record envers les institutions, cette étude interroge la recomposition des clivages sociaux, économiques et culturels qui redessinent en profondeur le rapport des Français à la démocratie.
Sortir des explications simplistes
Luc Rouban appelle à dépasser les grilles de lecture traditionnelles — classes sociales, génération, opposition ville/campagne — pour comprendre les fractures multifactorielles qui structurent désormais la société.
Les trajectoires sociales perçues, le niveau d’éducation, la localisation géographique, le sentiment d’isolement ou encore les valeurs culturelles s’entremêlent pour former une matrice sociopolitique complexe, distincte des clivages partisans classiques.
C’est dans ce décalage entre la matrice sociopolitique et la matrice partisane que s’enracinent les causes profondes de la crise démocratique que traverse la France.
Trois France sociopolitiques
L’analyse statistique met en évidence trois grands ensembles qui structurent aujourd’hui l’espace politique français :
- Les Seniors libéraux (38,7 %) : majoritairement âgés de plus de 60 ans, économiquement libéraux, critiques envers l’immigration et soutiens du Rassemblement national (RN). Ils valorisent l’ordre et expriment un fort besoin d’autorité.
- Les Jeunes élites (30,4 %) : diplômés, plutôt aisés et culturellement libéraux, ils se situent à gauche ou au centre, proches des valeurs de tolérance et des partis progressistes.
- Les Naufragés (30,8 %) : en échec social, souvent isolés, assignés à leur territoire et marqués par un fort sentiment de relégation. Bien qu’ils partagent certaines attentes de solidarité, ils soutiennent aussi largement le RN.
Ces trois groupes, loin de correspondre aux clivages partisans habituels, forment une nouvelle cartographie du politique où la position sociale perçue, la solitude ou le rapport à la mobilité pèsent autant que les orientations idéologiques.
Vers une convergence électorale inédite
Les résultats soulignent un fait majeur : les Seniors libéraux et les Naufragés, bien que socialement éloignés, partagent un même scepticisme vis-à-vis de la démocratie représentative et une proximité croissante avec le RN.
Ensemble, ces deux groupes représentent près de 70 % de la population, annonçant une dynamique électorale durable en faveur du parti de Marine Le Pen.
Cette convergence entre déclassement social, libéralisme économique modéré et rejet du système politique apparaît comme l’un des moteurs de la recomposition politique française.
Une crise de représentation structurelle
Luc Rouban conclut sa note en affirmant que la crise démocratique actuelle ne peut se comprendre sans reconnaître l’écart grandissant entre les représentations sociales vécues par les citoyens et les catégories politiques figées des partis. La France ne se divise plus entre gauche et droite, jeunes et vieux, urbains et ruraux — mais selon des expériences de vie, des trajectoires sociales et des valeurs subjectives.
Légende de l'image de couverture : Vote FRANCE (crédits : Shuttestock_NStafeeva)