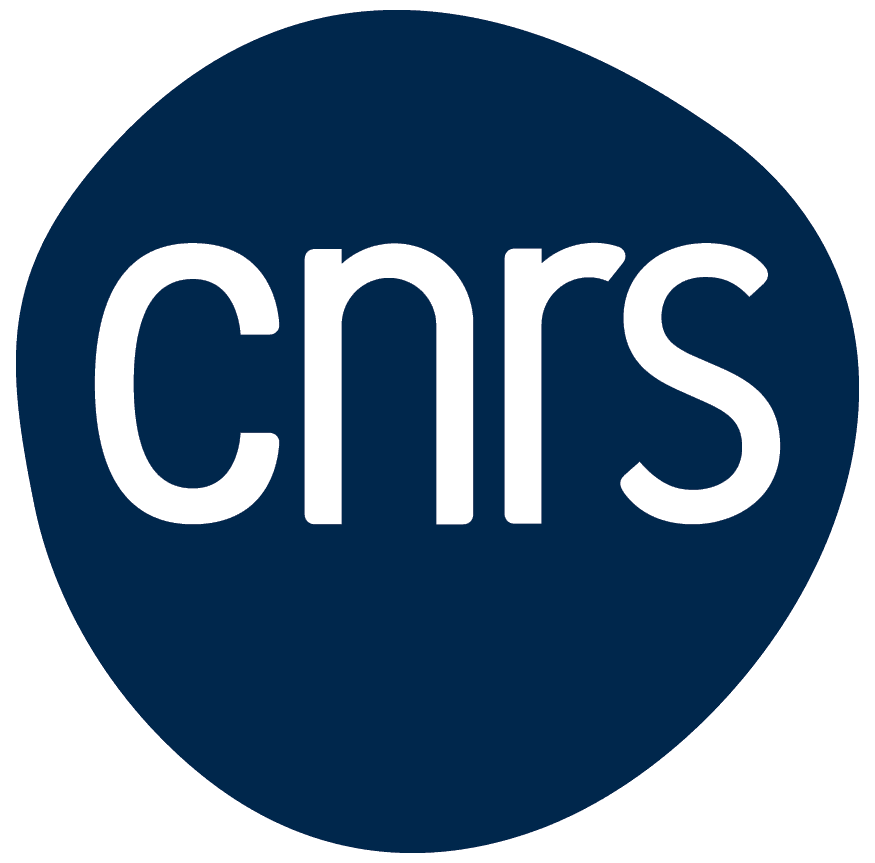Accueil>Double résilience démocratique : le nouveau Grand débat

03.10.2025
Double résilience démocratique : le nouveau Grand débat
La survie d’une démocratie dépend à la fois de sa stabilité interne et de sa capacité à résister aux pressions extérieures. Or, aujourd’hui, le cœur social qui soutenait nos démocraties – les classes moyennes et populaires stabilisées – s’affaiblit. Entre déclassement économique, perte de confiance et pressions géopolitiques, la légitimité démocratique vacille. Alexandre Escudier, chercheur au CEVIPOF, s’appuie sur les outils de la sociologie historique pour analyser le grand défi contemporain : la résilience démocratique
Cette analyse a été publiée le 2 octobre 2025 sur le site de Conférence
Dans le cadre d’une sociologie historique comparée1, la notion de résilience d’un régime politique – qu’il s’agisse d’une démocratie, d’une autocratie, d’une hiérocratie (i.e. monarchie sacrée)2 – recouvre deux dimensions fondamentales, distinctes mais indissociables. Quels que soient l’époque et le cercle culturel considérés, toute « politie » (J. Baechler) ou « unité politique » souveraine (R. Aron), est en effet confrontée à la nécessité de maintenir à la fois la stabilité de son régime interne de pouvoir (dimension endopolitique ou intrapolitique) et sa capacité à agir, subsister et s’imposer dans un environnement composé d’autres polities souveraines (dimension exopolitique ou interpolitique)3.
La première dimension (endopolitique) peut être définie comme la résilience interne du régime : elle désigne la capacité d’un ordre politique donné à se reproduire malgré les chocs sociaux, les conflits de légitimation, les transformations économiques ou les dissensions culturelles, voire religieuses internes. Elle engage la robustesse des médiations institutionnelles, l’adhésion d’une base sociale électoralement majoritaire et la stabilité des mécanismes de pouvoir – y compris la capacité des forces de police, voire de l’armée à gérer efficacement les situations d’urgence systémique, dans le strict respect des normes démocratiques. La seconde dimension (exopolitique) correspond symétriquement à sa résilience externe, à savoir sa faculté à perdurer en tant qu’unité souveraine au sein d’un champ d’interactions géopolitiques – entendues comme rapports de force, de diplomatie, d’alliance, de rivalité ou de dépendance entre polities4.
La résilience d’un régime politique repose sur la co-évolution de ses deux dimensions constitutives – domestique et géopolitique –, qu’une analyse rigoureuse doit penser conjointement, sans pour autant en confondre les logiques respectives. À l’échelle interne, il s’agit de la capacité d’un régime à maintenir la légitimité de la légalité de ses gouvernants, c’est-à-dire à faire reconnaître comme légitime, par sa base sociale active, l’exercice du pouvoir selon les formes établies. À l’échelle externe, la résilience désigne l’aptitude d’un pays à préserver sa souveraineté, tant formelle que matérielle (au sens de la théorie juridique), dans un environnement géopolitique structuré par des rapports d’interaction, de domination ou de conflictualité avec d’autres unités politiques concurrentes.
Résilience interne : le centre de gravité social
L’analyse de la résilience interne d’une démocratie peut être conduite à partir de la notion de centre de gravité social de son régime. Par analogie avec la catégorie stratégique clausewitzienne de centre de gravité militaire – le point d’équilibre et de cohésion des forces d’une armée dont la neutralisation précipite l’effondrement de l’ensemble de l’unité politique ennemie – le « centre de gravité social » désigne, dans une politie donnée, le segment sociopolitique dont la loyauté active, la stabilité et la participation assurent la reproduction minimale du régime. Il ne s’agit ni nécessairement du groupe démographiquement majoritaire, ni exclusivement de la classe dirigeante (oligarchies aristocratiques, patriciennes, sacerdotales autrefois, élites politiques ou technocratiques aujourd’hui), mais du nœud social autour duquel se cristallise l’adhésion au pouvoir institué, sans lequel la légalité cesse d’être perçue comme légitime, désirée dans la durée et soutenue activement par un faisceau d’émotions, de passions et de grammaires idéologiques articulées.
Ce concept occupe une fonction intermédiaire entre les structures macrosociologiques du régime (type de pouvoir, hiérarchie normative, forme de souveraineté) et les dispositifs méso-organisationnels (partis, syndicats, classes intermédiaires, réseaux de reproduction idéologique ou sociale). Il permet d’identifier, pour chaque type de régime – « autocratie » (pouvoir par coercition asymétrique), hiérocratie (pouvoir par autorité sacrale), démocratie (pouvoir par délégation consentie)5 – le groupe pivot dont la désaffection atteste d’une crise imminente de reproduction politique.
Dans le cas des démocraties modernes, ce centre de gravité est constitué par les classes moyennes et populaires stabilisées – entendues comme les groupes qui cumulent des droits politiques formels (électorat), une intégration économique relative (emploi, logement, mobilité sociale à espérance ascendante) et une reconnaissance symbolique suffisante (instruction, dignité, visibilité sociale et médiatique). Lorsque ce groupe central subit un déclassement objectif (précarisation, disqualification sociale, blocage de l’ascension intergénérationnelle) ou une déception subjective (écart croissant entre attentes et expériences vécues), le coefficient de loyauté à la légalité démocratique s’étiole. Cette désaffiliation ne résulte pas seulement d’un appauvrissement absolu, mais aussi d’un mécanisme de frustration relative, au gré duquel la perception d’un progrès collectif global – voire de l’enrichissement continu de certains segments du haut de la stratification sociale – contraste douloureusement avec le ralentissement, voire l’arrêt, de la mobilité ascendante pour soi-même, ses enfants ou petits-enfants. La colère ne naît ainsi pas toujours du pire, mais du moindre mieux : l’écart entre horizon espéré et trajectoire effective creuse un sentiment de trahison silencieuse. Ainsi, le régime peut demeurer formellement légal, mais il cesse d’apparaître comme pleinement légitime aux de ceux qui constituaient jusqu’alors son socle d’adhésion active. Un régime d’affects hypercritique coagule progressivement, à bas bruit d’abord, puis se cristallise en point d’appui manifeste, dont chaque choc exogène amplifie la portée, au profit d’offres politiques disruptives à visée social-révolutionnaire ou national-autoritaire.
L’ensemble de ce processus atteste d’une dynamique de désajustement structurelle entre offres et demandes politiques : le cœur social de l’adhésion se détache des mandatés provisoires du régime, entraînant une crise des médiations politiques (partis, syndicats), une montée des affects polarisants, voire insurrectionnels (à l’extrême droite comme à l’extrême gauche), ou bien une abstention massive. Autant de facteurs qui sapent les ressources motivationnelles fondatrices de la démocratie, jusque-là reprogrammées à chaque génération par la mémoire historique et la culture politique. Dès lors, l’alternance électorale ne joue plus son rôle de pacification, les compromis socio-politiques deviennent quasiment impossibles et le régime entre dans une zone d’instabilité structurelle.
Identifier le centre de gravité social6 d’une démocratie permet d’analyser ses vulnérabilités internes, de repérer les dynamiques de délégitimation progressive et de comprendre les seuils de possible bascule vers d’autres constellations de pouvoirs (césarisme majoritariste, autoritarisme, paralysie ingouvernable ou bien consensus de rebond).
Le Grand désencastrement occidental de la démocratie
Le cas des démocraties européennes offre une illustration paradigmatique de ce diagnostic. On y observe une érosion simultanée des droits sociaux effectifs (santé, éducation, logement, retraite), des canaux d’ascension et de reconnaissance (mobilité intergénérationnelle, mérite scolaire, sécurité de l’emploi) et de la confiance dans l’efficacité, voire la neutralité des institutions (médiations et représentations politiques comme syndicales, médias, partis, justice).
Cette triple fragilisation n’a rien de conjoncturel. Elle procède de causes structurelles cumulatives : le désencastrement des économies nationales sous l’effet de chaînes de valeur globales financiarisées ; la pression croissante de la contrainte énergétique sur les promesses de prospérité partagée ; l’effet corrosif du dumping fiscal et social, y compris au sein même de l’espace européen ; surtout, l’impuissance croissante des États à réguler, depuis leurs seules compétences territoriales, des désordres systémiques qui excèdent désormais l’échelle nationale. L’effet net est un affaiblissement durable du centre de gravité des classes moyennes et populaires salariées, dont le ratio entre espérances démocratiques et expériences publiques déceptives devient négatif. La légalité subsiste par inertie institutionnelle, mais la légitimité, elle, se délite inexorablement. Il en résulte une démocratie vidée de sa substance sociale, désencastrée, où l’adhésion civique large au régime ne soutient plus l’action politique des institutions centrales, rendant la stabilisation négociée d’un ordre commun toujours plus incertaine, et l’irruption de mouvements sociaux désintermédiées – comme les « Gilets jaunes » ou « Bloquons tout » – à la fois plus fréquente, plus conflictuelle et à tous égards plus coûteuse.
Certaines forces anti-démocratiques ont désormais pleinement intégré, dans leur conduite offensive, que les démocraties occidentales sont désormais vulnérables non tant sur le plan militaire qu’en leur fragile équilibre socio-politique interne. Deux types d’ennemis – étatiques d’une part, organisations ou réseaux non étatiques d’autre part – ont élaboré des stratégies explicites visant à miner cette base d’adhésion active des classes moyennes et populaires.
Du côté des acteurs étatiques, deux stratégies indirectes se dessinent. La Russie promeut une guerre informationnelle fondée sur la polarisation idéologique, visant à fracturer le corps civique par la diffusion massive de contenus polémiques, de fausses nouvelles et de récits dissonants, sapant ainsi la cohésion narrative propre aux régimes démocratiques. La Chine, à l’inverse – lorsqu’elle ne facilite pas en sous-main le narcotrafic de synthèse (notamment via l’exportation de précurseurs comme le Benzylfentanyl) – mise sur une démobilisation douce mais durable du lien civique, en dopant les segments les plus fragilisés des sociétés occidentales par un accès généralisé à une consommation à bas coût (Ali Express, Temu, Shein), qui compense artificiellement leur déclassement post-industriel sans pour autant les réaffilier politiquement.
Du côté des acteurs non étatiques, les stratégistes du djihadisme global ont, eux aussi, ciblé délibérément le centre de gravité social de l’Occident : par des attentats aveugles frappant les civils sur leur propre sol, ils cherchent à faire éclater l’équilibre fragile entre pluralisme culturel et inclusion civique, en activant des réflexes identitaristes de repli, de stigmatisation et de durcissement autoritaire, jusqu’à délégitimer les principes démocratiques au nom de l’impératif sécuritaire national.
Modes de restauration du centre de gravité social dans les régimes démocratiques
Lorsqu’un régime démocratique entre dans une phase de désajustement profond entre les offres politiques institutionnelles et les expériences sociales vécues par son centre de gravité, au point que celui-ci ne reconnaît plus la légalité en vigueur comme légitime, plusieurs trajectoires deviennent possibles. L’effondrement n’est ni automatique ni immédiat, mais la résilience dépend alors de la capacité du régime à restaurer sa base d’adhésion active.
Ces modes de restauration peuvent être classés en trois grandes familles, selon la variable principale mobilisée : économique, symbolique ou institutionnelle. Chacune correspond à un type de réponse historique et à un ensemble de dispositifs concrets de recomposition active du consentement politique, à travers des « termes de l’échange politique »7 mieux-disant.
1. Restauration par redistribution économique
La voie la plus classique, historiquement attestée dans les démocraties libérales du XXe siècle (New Deal, Trente Glorieuses, État-providence), consiste à réaffilier politiquement le groupe central par des mécanismes de sécurisation économique, de justice fiscale et d’ascension sociale.
Cela suppose trois choses liées : (a) un réarmement de la capacité redistributive de l’État (progressivité fiscale perçue comme telle, services publics efficaces, transferts sociaux restaurant la mobilité ascendante) ; (b) une revalorisation des conditions de travail, de l’emploi et de la rémunération dans les secteurs structurants de la société salariale ; (c) la garantie d’un accès équitable aux biens fondamentaux (santé, logement, éducation, mobilité) comme conditions de possibilité tangibles de la promesse démocratique d’autonomie.
Ce premier mode de restauration repose sur l’hypothèse probabiliste selon laquelle l’adhésion démocratique ne procède pas exclusivement d’une promesse de prospérité, mais se trouve d’autant plus assurée que les conditions matérielles d’existence s’améliorent de manière tangible – et qu’à l’inverse, leur dégradation entraîne mécaniquement un recul de l’allégeance au régime.
2. Restauration par inclusion symbolique et reconnaissance
Dans des contextes où la redistribution matérielle est limitée (croissance en berne, fiscalité inefficiente, contraintes budgétaires héritées), certains régimes tentent de restaurer leur centre de gravité par des politiques de reconnaissance symbolique : inclusion des groupes marginalisés, reconnaissance des identités subalternes, extension des droits civiques et culturels, considération publique accrue des exclus.
Cette stratégie vise à réintégrer symboliquement des segments désaffiliés en leur offrant un statut de pleine citoyenneté morale, sans que cela implique nécessairement une amélioration économique substantielle – ni pour eux, ni pour le reste du corps social. Elle n’est pas dépourvue de puissants effets de remobilisation morale, sur fond d’affect solidariste – qu’il procède du principe d’égale dignité humaine ou d’un sentiment national partagé – mais au prix d’une polarisation idéologique accrue, dès lors qu’elle est perçue comme une reconnaissance asymétrique au détriment du groupe central historique, en particulier des classes moyennes et populaires déclinantes, qui estiment assumer à elles seules la charge économique, fiscale, voire morale du pays (révoltes latentes contre la taxe foncière et la taxe d’habitation incluses).
3. Restauration par réforme institutionnelle
Une troisième voie consiste à reconfigurer les médiations politiques elles-mêmes, en transformant les règles du jeu représentatif, les modalités de participation et de délibération, ainsi que les conditions de production de compromis inclusivement négociés. Cette stratégie s’emploie à réactiver la confiance par un amendement des procédures, en réduisant l’écart entre la décision politique et la souveraineté populaire immanente au social.
Elle peut inclure des mécanismes de démocratie participative ou délibérative, une refonte des systèmes électoraux visant à restaurer la représentativité – les débats récurrents sur le tirage au sort ou le scrutin proportionnel relèvent exclusivement de ce registre –, la constitutionnalisation de garanties sociales ou d’un plafond d’endettement public (la « règle d’or »), afin d’inscrire certains biens fondamentaux dans l’ordre normatif supérieur, ou encore une rénovation du rôle des corps intermédiaires – syndicats, associations, médias publics non inféodés à l’agenda idéologique des oligarchies privées – en tant que lieux de reformulation des conflits et de réintégration, dans l’agenda public, des demandes sociales et politiques restées électoralement orphelines.
Ces trois modes de restauration des termes de l’échange démocratique – redistribution, reconnaissance, réforme procédurale – visent à rendre sensible la finalité politique intrinsèque du régime : l’instauration d’un ordre juste, légitime et pacifié, en montrant que les institutions ne sont pas de simples coquilles vides ni des instruments de promotion réservés aux élites, mais des vecteurs d’autogouvernement effectif, garants de la paix interne par la justice.
Leur efficacité dépend de leur articulation au sein d’une offre politique cohérente et lisible par le centre de gravité social lui-même. C’est dans leur interaction que réside la possibilité d’une recomposition du lien civique et d’un régime d’affects de soutien. Sans redistribution, la reconnaissance demeure formelle ; sans reconnaissance, la redistribution ne suffit pas à désamorcer le ressentiment accumulé ; sans effets tangibles des procédures, la double sémantique de la redistribution et de la reconnaissance apparaît comme une instrumentalisation cynique des principes de justice au profit de la seule survie sociale des gouvernants.
Résilience externe : le centre de gravité stratégique
Il reste que ces dynamiques internes n’opèrent pleinement que dans un environnement extérieur relativement stabilisé. Les équilibres géopolitiques sont, à ce titre, aussi déterminants que les équilibres internes des termes de l’échange politique : ils délimitent le périmètre réel de la résilience exopolitique des démocraties – c’est-à-dire leur capacité à préserver leurs intérêts vitaux à incidence interne, leur souveraineté formelle et matérielle, leur agentivité stratégique et leur autonomie de décision, dans un champ d’interactions dominé par des puissances soit exclusivement centrées sur leur propre expansion, soit ouvertement hostiles à l’ordre social moderne comme à l’ordre démocratique.
Nous autres Modernes oublions trop souvent que, dans l’histoire, le régime démocratique ne s’est développé que dans des sociétés de petite taille – bandes égalitaires, tribus segmentaires, cités-États8 – dont la pérennité dépendait autant de leur dynamique démocratisante interne (face à l’autocratie, à l’aristocratie ou à l’oligarchie) que de leur position dans le champ géopolitique environnant. Lorsque la masse critique d’une politie démocratique s’avérait insuffisante face à des puissances adjacentes dotées d’un régime autocratique ou hiérocratique, capables de projeter leur puissance par la coercition, la réduction tributaire ou la conquête, ces régimes étaient soit détruits puis territorialement absorbés, soit ravalés au rang d’acteurs subalternes sans souveraineté effective – même lorsque subsistait l’illusion humiliante d’une autonomie domestique de façade. Leur disparition tenait ainsi à un défaut de résilience géopolitique, imputable à une combinaison de facteurs récurrents : sous-capacités militaires et technologiques, inadéquation stratégique, isolement diplomatique, vulnérabilité territoriale, stagnation démographique, ou encore conflictualité interne entraînant à la fois une impréparation stratégique et un affaissement du ressort moral collectif en période critique.
Dans l’ouvrage Résilience démocratique : éléments de sociologie historique dirigé avec Jean Baechler (1937-2022) – ce Max Weber français, à l’œuvre aussi rigoureuse qu’encyclopédique9 – plusieurs études empiriques documentent ces trajectoires d’effondrement démocratique. Elles mettent en évidence la corrélation structurelle entre le coefficient de mobilisation de puissance d’un régime et sa capacité de survie géopolitique. Le cas de la cité de Rome, devenue tête d’empire, en offre une confirmation paradoxale, selon une logique symétrique inversée : ici, ce n’est pas l’insuffisance de puissance qui a provoqué la disparition du régime démocratique, mais son excès même – l’hyper-succès militaire et territorial de la cité ayant déplacé son centre de gravité social en faveur des chefs militaires et de leurs clientèles, jusqu’à rendre inopérante la forme de gouvernement élitaire initial, tempérée par l’institution du tribunat de la plèbe, au profit d’une autocratie impériale structurée par la centralisation du pouvoir militaire.
Dans l’histoire plus récente, rares sont les polities démocratiques à avoir pu conjuguer, durablement, une légitimité interne assurée et une réserve stratégique suffisante pour dissuader les pressions extérieures. C’est le couplage entre régime démocratique, forme fédérale de l’État et double réserve de puissance – terrestre et maritime, à façade bi-océanique – à l’échelle continentale des empires autocratiques ou totalitaires, qui, avec la montée en charge des États-Unis, a permis de franchir un « seuil géopolitique de résilience démocratique » de portée planétaire10. Les Provinces-Unies, dès 1581, avaient esquissé cette voie, mais sans parvenir à franchir le « seuil post-confédéral »11 ni à se doter d’une réserve de puissance suffisante, en raison d’un milieu naturel trop contraint. Seuls les États-Unis y sont parvenus, à l’issue d’une guerre civile dévastatrice.
Le choc provoqué par la politique étrangère de l’administration Trump II, assumant une logique ouvertement transactionnelle – fondée sur des deals et une gestion néo-patrimoniale des affaires extérieures comme commerciales – n’a pu constituer un véritable électrochoc que parce qu’un tel « seuil géopolitique de résilience démocratique », garanti depuis 1945, par la réserve fédérale américaine de puissance, s’était profondément inscrit dans les mémoires collectives – y compris chez nombre d’anti-américanistes de principe, dont les postures rhétoriques s’effacent souvent devant la réalité nue des rapports de force en cas d’agression autocratique ailleurs.
Le dérèglement, désormais chronique, du système politique des États-Unis renvoie dès lors à la finalité profonde des autres formes d’intégration régionale se maintenant dans un état de proto-fédéralisation inachevée à persistance confédérale – à l’instar de l’Union européenne : leur objectif ultime n’est pas seulement de constituer un vaste marché et un espace de prospérité garanti par la paix intra-régionale, mais bien de se doter de l’ensemble des attributs d’un acteur géoéconomique et géostratégique, capable d’assumer, dans l’ordre interétatique mondial et sous contrainte de l’Anthropocène, un rôle structurant de contre-coalition de rééquilibrage en vue de la poursuite effective des intérêts communs humains.
C’est là toute la difficulté actuelle de l’Union européenne, qui, faute d’être une politie fédérale pleinement constituée – en capacité d’agir, sans véto confédéral des États membres, de manière unitaire, accélérée et à l’échelle – demeure structurellement exposée à une double vulnérabilité : d’une part, le risque d’agression autocratique venue de l’extérieur ; d’autre part, celui d’un désengagement unilatéral de son allié historique, dès lors que ce dernier – comme l’illustre l’administration Trump II – verse dans un césarisme majoritariste à logique strictement transactionnelle12.
Dans un tel contexte, la résilience exopolitique des démocraties ne saurait reposer exclusivement sur les États et leurs appareils stratégiques. À l’ère de l’Anthropocène et du capitalisme transnational, une part croissante de la capacité effective à agir – qu’il s’agisse de transition énergétique, de protection des écosystèmes, de sécurisation des ressources critiques ou de riposte aux dépendances logistiques – se déplace hors du périmètre des institutions centrales. Un nombre significatif d’entreprises, de consortiums industriels, de métropoles et de collectivités territoriales en réseau, mais aussi de mouvements civiques transnationaux, assument de fait une fonction de contre-coalition polycentrique, face aux externalités destructrices, tant des autocraties néo-impériales que des formes de consommation planétairement insoutenables. Ces entités doivent dès lors être conçues, dans l’analyse stratégique, comme centres autonomes de décision – certes hétérogènes, inégalement coordonnés, mais capables de peser, par leur stratégie d’investissement, leur pouvoir normatif, leur ancrage territorial ou leur autorité symbolique, dans la reconfiguration des équilibres systémiques. Leur activation concertée ne remplace pas l’action publique, mais elle en constitue un prolongement structurel – parfois le seul encore opérant – lorsque la fragmentation de la souveraineté étatique interdit toute réponse unifiée. Ainsi se dessine un nouvel agencement des puissances exopolitiques, au sein duquel la résilience démocratique ne relève plus d’un monopole institutionnel, mais d’une écologie stratégique polycentrique, dont les foyers de décision doivent être repérés, soutenus et articulés.
Notre « nouveau Grand débat » démocratique
L’ensemble de ces questions se redéploie désormais dans un cadre profondément transformé13. Il s’agit d’articuler l’ordre interne – pacifié parce que juste – de nos démocraties tout en relevant des défis géopolitiques d’ampleur inédite, sous une triple contrainte croissante :
(a) la pression stratégique des autocraties néo-impériales de taille continentale, souvent plus rapides, plus cyniques et moins contraintes par des procédures internes de légitimation ;
(b) l’effondrement progressif des compromis socio-politiques, qui avaient stabilisé les démocraties après 1945, fondés sur une équation énergétique favorable (abondance fossile, croissance, redistribution, sécurisation géopolitique des approvisionnements) aujourd’hui rendue caduque par le franchissement des limites planétaires de l’espèce humaine ;
(c) et la montée d’une ingouvernabilité chronique, nourrie par la dislocation des compromis historiques entre classes sociales. Cette dynamique procède d’une conflictualité croissante entre deux blocs. D’un côté, les perdants de la prospérité mondialisée – précarisés, invisibilisés – et ceux du « double libéralisme » moderne, politique et culturel, dont les effets peuvent déstabiliser certaines formes traditionnelles d’identité, individuelle comme collective. De l’autre, les gagnants d’un nouvel ordre en mutation, qui résistent mieux aux effets de la rareté, du retour de la guerre ou de l’angoisse climatique, en raison de leur insertion dans les chaînes de valeur globalisées ou dans les structures fonctionnelles du pouvoir. Cet ordre est de plus en plus surplombé par une technocratie des normes, souvent perçue comme opaque, hautaine, budgétivore et inefficace, et qui donne le sentiment d’échapper elle-même aux contraintes qu’elle impose. Non exposée aux risques sociétaux qu’elle prétend réguler, cette élite fonctionnelle devient la cible d’une colère diffuse : elle incarne, aux yeux de beaucoup, le bras normatif et fiscal injuste d’une hiérarchie sociale jugée indécente. Ces lignes de fracture ainsi ouvertes forment un terreau idéologique et émotionnel particulièrement fertile pour les entrepreneurs de polarisation. En se posant en porte-parole des nouveaux « sans parts » et « surnuméraires » – ces catégories reléguées, sorties du jeu sans jamais avoir été véritablement invitées à y entrer –, les artisans passionnels du dissensus radical sapent la capacité du régime à maintenir un centre de gravité stable et à produire des compromis prudentiels.
Ainsi donc, quel que soit le cas historique ou contemporain retenu, la résilience démocratique doit toujours être pensée comme le produit instable d’un double équilibre à sans cesse réajuster. D’une part, un équilibre interne entre les demandes sociales et la légitimité institutionnelle, fondé sur des expériences non déceptives des termes princeps de l’échange politique – sécurité, prospérité, solidarité, libertés. D’autre part, un équilibre externe entre la pression sélective de l’environnement géopolitique et la capacité collective de manœuvre multimodale – diplomatique, militaire, stratégique, géoéconomique –, dans le champ interétatique comme dans celui de la société civile internationale.
Pour les démocraties libérales contemporaines, cet impératif d’équilibre se trouve aujourd’hui radicalement complexifié par la convergence de trois dynamiques lourdes : l’affirmation stratégique des autocraties néo-impériales ; la transformation anthropocénique des conditions matérielles de la souveraineté, tant interne qu’externe ; et la montée de nouvelles vulnérabilités du régime, issues de la fragmentation sociale et culturelle, et de l’épuisement des médiations politiques. Il reste que c’est bien sur ces deux registres en vases communicants – résilience endo- et exopolitique – que se joue désormais, au cœur du XXIe siècle, non une adaptation incrémentale des démocraties, mais leur survie historique. Et cette fois, dans l’urgence.
Une urgence que la sociologie historique comparée choisit d’affronter, non dans l’angoisse passionnelle ni la panique normative, mais en proposant quelques clefs probabilistes de compréhension, et en suggérant, non des recettes d’action vaines ou illusoires, mais des points d’attention structurants pour orienter la délibération collective.
Notes :
1. Jean Baechler et Alexandre Escudier dir., Résilience démocratique : éléments de sociologie historique, Paris, Hermann, 2024. Cette première ébauche, analytique et empirique, du problème de la résilience démocratique à travers les âges – et pas le seul présent – fait actuellement l’objet d’un approfondissement comparatiste global au sein du Fonds de sociologie historique Jean Baechler fondé par A. Escudier et Antony Dabila au Centre de Recherches Politiques de Sciences Po (CEVIPOF, Paris).
2. A. Escudier, « Les voies de l’autorité politique », in Id. et alii dir., Le sacré en questions. Lectures et mises en perspective de Hans Joas, Genève, Labor et Fides, 2023, p. 107-142.
3. Sur cette distinction entre « endopolitique » et « exopolitique », cf. Antony Dabila, L’Échiquier stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges, Paris, Le Seuil, 2025, p. 55 sq.
4. Dans les enquêtes de sociologie historique comparée de long terme, les termes délibérément formels « exopolitique », « interpolitique » ou plus simplement « géopolitique » sont pleinement pertinents. En revanche, l’usage courant de l’adjectif « international » est, dans ce contexte, conceptuellement inopérant. Il suppose en effet l’existence de « nations » comme unités de solidarité politique et de projection identitaire, or cette forme de communauté est historiquement spécifique à l’Europe moderne et à ses réappropriations postcoloniales au gré des luttes d’indépendance, via les idéologies nationalistes. En dehors de ce cadre historico-culturel précis, la « nation » n’a été ni le vecteur d’identification principal ni l’échelle pertinente d’organisation de la souveraineté. Employer l’adjectif « international » dans une perspective transhistorique revient donc à projeter indûment un prisme stato-national trop récent et situé sur des configurations politiques qui relèvent d’autres matrices de légitimation, de territorialité et d’interaction entre groupements politiques.
5. J. Baechler, Précis de la démocratie, Paris, Calmann-Lévy/ UNESCO, 1994, p. 51-62.
6. Sur la « tripartition conflictuelle » du centre de gravité social des démocraties contemporaines, cf. A. Escudier, « L’érosion contemporaine des conditions de possibilité de la démocratie ? Vigilance raisonnée et sociologie historique », in Baechler/ Escudier dir., Résilience démocratique, op. cit., p. 345-379, ici p. 374 sq.
7. Cf. A. Escudier, « La troisième grande parenthèse autoritaire ? Lignes de faille et résilience démocratique », in Baechler/ Escudier dir., Résilience démocratique, op. cit., p. 381-405, ici. p. 391 sq.
8. Cf. la sociologie historique comparée fondatrice des différentes variantes sociales de la démocratie élaborée par J. Baechler dans Démocraties (Paris, Calmann-Lévy, 1985), ainsi que sa mise au point synthétique sur « La démocratie archaïque : résilience des bandes et des tribus segmentaires », in Baechler/ Escudier dir., Résilience démocratique, op. cit., p. 15-29.
9. Cf. Jean Baechler, Écrits (1967-2022), édition complète, annotée et introduite par A. Escudier, 6 volumes, Paris, Hermann, 2025, 5.500 p (lien).
10. A. Escudier, « La troisième grande parenthèse autoritaire ? Lignes de faille et résilience démocratique », in Baechler/ Escudier dir., Résilience démocratique, op. cit., p. 399 sq.
11. Cf. la journée d’études organisée au CEVIPOF le 10 septembre 2025 sur « Fédéralismes modernes et expérience fédérale au Brésil » (lien).
12. A. Escudier et Nicolas Leron, « Le Grand détriplement européen », in Le Grand continent, 24 juillet 2024 (en ligne).
13. Cf. A. Escudier, « À l’ombre de Mars : la ‘conduite stratégique », contrainte refoulée ou nouveau Grand débat démocratique », in Le Grand Continent, 8 octobre 2025 (en ligne).