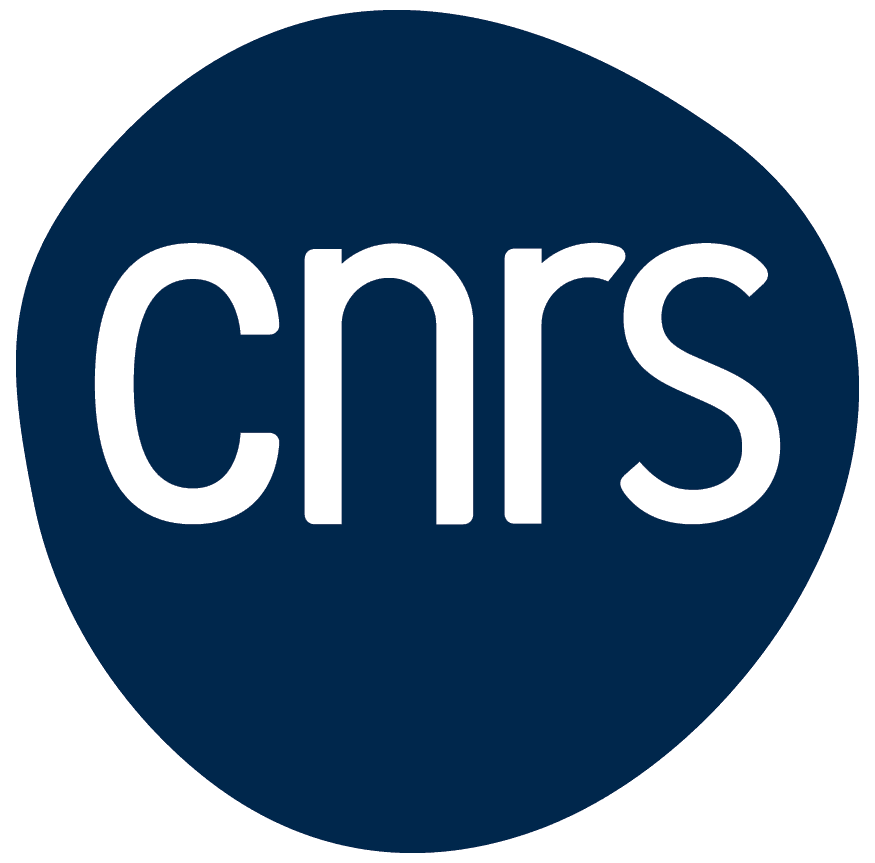Accueil>Démission de Sébastien Lecornu : la crise derrière la crise

07.10.2025
Démission de Sébastien Lecornu : la crise derrière la crise
Premier ministre depuis moins d’un mois, Sébastien Lecornu a déposé sa démission auprès d’Emmanuel Macron. Son échec est un nouveau signe du dysfonctionnement institutionnel de notre démocratie parlementaire. Luc Rouban, chercheur au CEVIPOF, analyse cette instabilité comme le fruit d’une incapacité des professionnels de la politique à comprendre la situation à laquelle nous faisons face.
Cette analyse a été publiée le 6 octobre sur Conférence, le nouveau site de décryptages et d'analyse de Sciences Po.
La démission brutale et presque désespérée de Sébastien Lecornu, faute d’avoir pu organiser un gouvernement cohérent et d’espérer obtenir une majorité même courte pour voter son projet de budget à l’Assemblée nationale, vient ajouter un épisode au feuilleton tragi-comique de la déliquescence politique en France. La brutalité de l'événement semble néanmoins indiquer que le dévouement ne suffit pas et que c’est bien la démocratie représentative elle-même qui s’est bloquée. Il faut donc tenter de comprendre ce que nous dit la démission de Sébastien Lecornu dont on peut sans doute critiquer les choix mais pas la bonne volonté.
Une crise de la lecture politique
On connaît les causes immédiates de la situation : une dissolution ratée en 2024, l’absence de majorité à l’Assemblée nationale, l’incapacité de trouver une forme de compromis sur la question fiscale et budgétaire alors même que la dégradation des finances publiques l’exige. Néanmoins, au-delà de cette description, ressassée sur les plateaux de télévision, se posent d’autres questions plus analytiques.
La séquence politique qui s’égrène assez logiquement depuis 2024, voyant tomber les gouvernements les uns après les autres, semble nous faire revenir aux heurs et malheurs de la Quatrième si ce n’est de la Troisième République où le même personnel politique était recyclé en permanence et se retrouvait dans des gouvernements à très courte durée de vie. Mais si ces Républiques sont tombées ce n’est pas tant à cause d’un déficit de démocratie que d’erreurs de lecture de la situation politique. Ce qui a fait le succès du gaullisme en 1958 tient précisément à la nouvelle interprétation qu’il a faite de l’échange politique entre les citoyens et le pouvoir exécutif. C’est bien une idée du pouvoir moderne qui émerge ou qu’il fait émerger, bien au-delà des rustines juridiques sur le mode de scrutin ou des arrangements électoraux de dernière minute. Or, derrière la crise gouvernementale actuelle, se dessine la crise de la lecture politique et l’incompréhension assez profonde que les professionnels de la politique ont de la société française.
L’échec du macronisme
La crise de la lecture politique se révèle sur deux registres. Le premier registre est celui du macronisme lui-même. Emmanuel Macron a concentré les pouvoirs à l’Élysée de manière inédite, réduisant encore un peu plus le rôle du Premier ministre à celui d’un second secrétaire général de l’Élysée, chargé de l’intendance. Il a clairement adopté une interprétation présidentialiste de la Constitution selon laquelle son mandat prévaut sur tout autre et doit rester à l’abri des vicissitudes de la vie politique, s’éloignant de toute considération gaullienne voulant qu’un Président désavoué par les urnes doive démissionner. Au lendemain des élections législatives de juillet 2024, il en appelle soudain au parlementarisme, disant aux députés qu’ils n’avaient qu’à se débrouiller entre eux pour créer la base d’un consensus minimum dont il n’avait pas à s’occuper si ce n’est pour vérifier que son programme présidentiel était respecté. La lecture très macroniste des institutions, vues davantage comme celles d’une entreprise privée que d’un État, a pu passer pour très moderniste en 2017 mais s’est heurtée très vite au retour du clivage droite-gauche sur la question des services publics comme sur la question fiscale. Le mode gestionnaire du macronisme n’a pas permis d’évacuer le débat sur les valeurs car les projets de LFI et du PS, bien que différents, sont en opposition complète avec ceux de LR et des centristes, rendant le renforcement du « bloc central » macroniste totalement illusoire et l’isolant dans une forme d’obstination à ne pas s’avouer de droite.
Le rôle central du Rassemblement national
Une seconde erreur de lecture politique, sans doute bien plus volontaire et moins systémique, est celle qui a conduit à minimiser la montée en puissance du Rassemblement national, d’abord lors de l’élection présidentielle de 2022, ensuite et surtout, lors des élections législatives de 2024 où il arrive en tête en nombre de voix. La lecture du RN s’est alors faite avec retard, avec des réflexes acquis autrefois, comme s’il représentait encore ce que représentait l’ancien Front national : un parti périphérique infréquentable réduit à l’imprécation et dont les représentants lancent des saillies racistes ou antisémites. Mais le RN a vu son électorat s’élargir aux catégories moyennes diplômées et même aux franges inférieures des catégories supérieures, il a capté le vote des fonctionnaires constituant pourtant un vivier pour la gauche, est devenu le centre de gravité des droites, imposant sa présence sans décliner de programme économique précis, récupérant les électeurs LR et même le gaullisme social en faisant tout pour se dédiaboliser et se présenter comme un parti de gouvernement. Bien plus, et même s’il se différencie dans son électorat de Reconquête !, il a pu capter une forme de trumpisme d’atmosphère qui associe libéralisme économique, autorité de l’État et souverainisme. L’incapacité d’une grande partie du personnel politique à reconnaître son rôle central sur le champ politique soit en se rassurant avec le front républicain de 2024 soit en l’excluant de tout accord de gouvernement a rendu l’exercice gouvernemental impossible pour Michel Barnier, François Bayrou et Sébastien Lecornu.
Une rupture complète entre politiques et citoyens
Et c’est ici que l’on trouve le dernier facteur de crise, l’incompréhension de la société française. Il suffit de parler quelques minutes avec des députés ou d’anciens ministres pour saisir à quel point ils et elles sont enfermés dans des références datées, des mémoires toujours vivantes de leurs anciens succès électoraux, des schèmes d’analyse qui ne font plus sens aujourd’hui, sans rien connaître, souvent, des travaux de science politique dont ils ne retiennent que ce qui les conforte dans leurs certitudes. Les uns vont se caler sur la lutte des classes, sur la soirée merveilleuse du 10 mai 1981 voire sur le Front populaire de 1936 ou le tribunal révolutionnaire de 1793, les autres sur les valeurs traditionnelles de la France dont ils et elles connaissent si bien le terrain, les espoirs placés dans la mondialisation ou la crainte d’une submersion migratoire. Mais ils restent étrangement indifférents, alternativement, aux attentes de probité, à l’idée que la confiance politique naît non pas du succès ou du résultat économique des politiques publiques mais de l’existence d’une règle du jeu équitable, à la croyance toujours vivante, mais de plus en plus déçue, en la méritocratie républicaine, à la volonté de réussite économique notamment des générations les plus jeunes, à la diffusion des solidarités communautaires, locales et associatives, à l’affaiblissement de l’État comme outil historique du lien social en France.
Derrière la crise gouvernementale à répétition que connaît la France se retrouvent donc des éléments proprement politiques liés au fait que les institutions de la Cinquième République ont perdu leur esprit, fait de représentation mais aussi de démocratie directe, comme le rappelle l’article 3 de la Constitution. Mais elle met également au jour ce qui se joue de nouveau dans le rapport au politique, dans la méfiance que génère son inefficacité professionnelle, à savoir l’idée d’une émancipation de la société qui s’est déjà mondialisée, diversifiée, et qui n’a plus besoin des élections pour exister.
(crédits : Antonin Albert/Shutterstock)
Nous contacter
Adresse : 1 place Saint-Thomas d'Aquin, 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 49 54 39 00
Courriel : info.cevipof@sciencespo.fr