Accueil>Trois décennies de cheminement sur les sentiers de l’international
25.11.2025
Trois décennies de cheminement sur les sentiers de l’international
Entretien avec Didier Bigo
La revue trimestrielle Cultures & Conflits, fondée en 1990 fête en 2025, 35 ans de publication. C’est l’occasion de revenir, avec son fondateur, Didier Bigo, professeur émérite au Centre de recherches internationales de Sciences Po, sur la longévité d’une revue indépendante, et la richesse d’une démarche intellectuelle ouverte sur la transdisciplinarité et l’international.
Dans quel contexte la revue Cultures & Conflits a-t-elle été créée, et quelle place cherchait-elle à occuper à ce moment-là?
Cultures & Conflits a été créée en 1990 dans un contexte international particulier qui était celui de la fin de la bipolarité. Cette dernière était envisagée par beaucoup de représentants de l’école du réalisme structurel comme impossible à changer car elle leur paraissait structurellement stable et relativement indépendante de la volonté de nuire des acteurs (c’était le cas, notamment, du politologue américain Kenneth Waltz, fondateur de cette école de pensée(1)). La surprise de voir s’effondrer un canon de cette doctrine, certains disaient une « loi scientifique », a mené à un clivage profond entre ceux qui voulaient comprendre comment il était possible qu’une telle erreur se soit produite en revenant sur les conditions épistémologiques et méthodologiques des relations internationales d’une part, et d’autre part, ceux qui voulaient, au contraire, aménager le dogme aux marges pour continuer avec les mêmes visions pessimistes de la nature humaine, la capacité de la force supérieure à s’imposer et à se légitimer, en se nommant puissance et en créant l’obéissance, par la soumission ou par un soft power.
Cultures & Conflits, revue créée par une association loi 1901 et ne dépendant ni d’une université ni d’une discipline unique, a su inventer un espace de rencontre pour des politistes, des internationalistes, des sociologues, des géographes, des historiens, des criminologues, venant de grandes écoles et d’universités, de toute la France, mais aussi de pays francophones. C’est cette diversité créative et un réel effort de réflexion sur les grands problèmes du monde qui ont permis de proposer une approche à la fois attachée à la complexité du social et « critique », au sens du politologue Robert Cox, par laquelle il s’agit non pas de déconstruire par une opposition stérile, mais de reformuler plus adéquatement les questions posées par les acteurs politiques et sociaux.(2) La naissance, en France, d’une approche transdisciplinaire de la question de l’International, concomitante avec des approches plus épistémologiques sur les fondements des relations internationales et ce qu’on a appelé les approches critiques de la sécurité aux États-Unis, au Canada et en particulier au Danemark a permis de repenser l’étude des conflits, de la sécurité, de la violence (sous toutes ses formes).(3) Cela s’est fait sur des bases permettant un profond renouvellement de la recherche en ouvrant la voie à des questions sur les vies et les acteurs ordinaires, sur les villes, provinces et régions et pas uniquement sur l’échelle nationale, sur l’environnement, sur les solidarités et les luttes à distance entre acteurs sociaux, sur les formes prises par la « violence symbolique »,(4) mais aussi sur les mécanismes par lesquels l’éthique peut jouer sur les comportements des acteurs et des institutions, sur les forces et les faiblesses du droit international dans ses relais nationaux et locaux, bref, toute une série de sujets qui n’étaient pas alors considérés comme de « vraies » relations internationales.
Quelle était alors la situation de la science politique française, et plus particulièrement l’étude de l’International ?
La science politique en France, comme dans d’autres pays, était à l’origine enseignée au sein des facultés de droit, et elle était parfois considérée comme de la « culture générale » à acquérir pour des grands concours. L’international était assimilé aux « affaires étrangères » des États, et elle se couplait souvent avec une histoire nationaliste et culturaliste pré-braudélienne.(5) Si certains lieux plus spécialisés existaient et développaient un savoir sur les relations internationales (la Sorbonne, Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux…) en introduisant les notions de transnationalismes, d’interdépendance complexe, d’agentivité des acteurs, de configuration sociale, de champs, beaucoup d’autres lieux se contentaient de répéter une histoire conventionnelle habillée de ce qui s’appelait le réalisme Aronien,(6) mais sans en avoir la profondeur philosophique. Il y avait dès lors une énorme dépendance à l’égard des débats américains, d’une discipline – la science politique – qui n’avait qu’une vingtaine d’années comme champ spécifique, et une place minorée, en son sein, des relations internationales par rapport aux études électorales et gouvernementales, et des politiques publiques. Le manque de connaissance de la langue anglaise, et les faibles fonds consacrés à la participation des enseignants chercheurs français aux conférences internationales n’ont en rien arrangé la situation. Dans les années 1980 et 1990, un clivage est apparu entre une activité scientifique croissante de quelques centres de recherche, et en particulier du CERI, porteur d’une dimension internationale et rassemblant des chercheurs reconnus dans le monde entier, et une majorité d’enseignants, peu impliqués dans la recherche et reproduisant les canons et les présupposés dits « réalistes ».
Après 1990, cette divergence s’est encore accentuée, avec un élan important venant des étudiants s’intéressant à l’international, aux mouvements sociaux, à l’écologie planétaire, aux violences déterritorialisées, aux déplacements de personnes (dont les migrations) et au sort des réfugiés, ce qui a permis à des auteurs venant de disciplines diverses d’être les plus cités et les plus actifs dans la compréhension des processus de disjonctions liés à la globalisation.(7) Philosophes, géographes, sociologues, anthropologues sont intervenus sur ces questions. Les travaux d’Arjun Appadurai, Ulrich Beck, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Bruno Latour, Saskia Sassen, Sidney Tarrow, et de Charles Tilly ont très largement dépassé, en nombre de citations dans les revues internationalistes, ceux de Robert Gilpin, Stephen Krassner, John Mearsheimer, ou même Kenneth Waltz, porteurs de l’école réaliste. Ils ont profondément inspiré, à des degrés divers, une autre compréhension des relations internationales et nous avons eu le plaisir que certains de ces auteurs contribuent à notre revue.(8)
Comment expliquer ces évolutions ?
Ceux qui ont continué à vouloir s’appeler « réalistes » alors que leur position consistait plutôt en un déni des réalités du monde social et à une lecture du monde trop simplifiée ont progressivement et fortement réduit leur présence aux conférences internationales, y compris en France. Ils se sont tournés vers des activités de chroniqueurs et de journalistes et ont, pour ce faire, changé de « style » : loin de reprendre et de développer les approches des choix rationnels du réalisme classique, qui ont toujours une valeur intrinsèque, ils ont recyclé des approches culturalistes et parfois xénophobes ou chauvinistes dans la lignée du « clash des civilisations » de Samuel Huntington, et se sont alignés sur les questionnements des néo-conservateurs et enfin de la droite radicale, que ce soit pour les promouvoir ou les combattre.
Notre revue s’est au contraire toujours positionnée en faveur d’une analyse relationnelle des identités, insistant sur les changements permanents qui reconfigurent les acteurs en fonction de la temporalité des conflits et des alliances. Les identités se forgent dans les luttes ou les indifférences à d’autres. Elles changent en fonction des relations dans la mesure où les processus sociaux, les configurations d’acteurs et les dynamiques à l’œuvre forment un univers social ou des champs sociaux (locaux, nationaux ou transnationaux) et ce sont ces variations qui permettent de comprendre la complexité du présent. Les auteurs que nous avons choisis de republier dans le numéro anniversaire, malgré leur diversité, ont tous en commun cette ligne de fond des approches relationnelles et ils ont accompagné tous les travaux francophones qui ont su garder ce sens de l’action, cette réflexion sur les pratiques des acteurs, et l’humilité qui va de pair avec le travail de recherche de longue haleine, et non avec les prédictions apocalyptiques.(9)
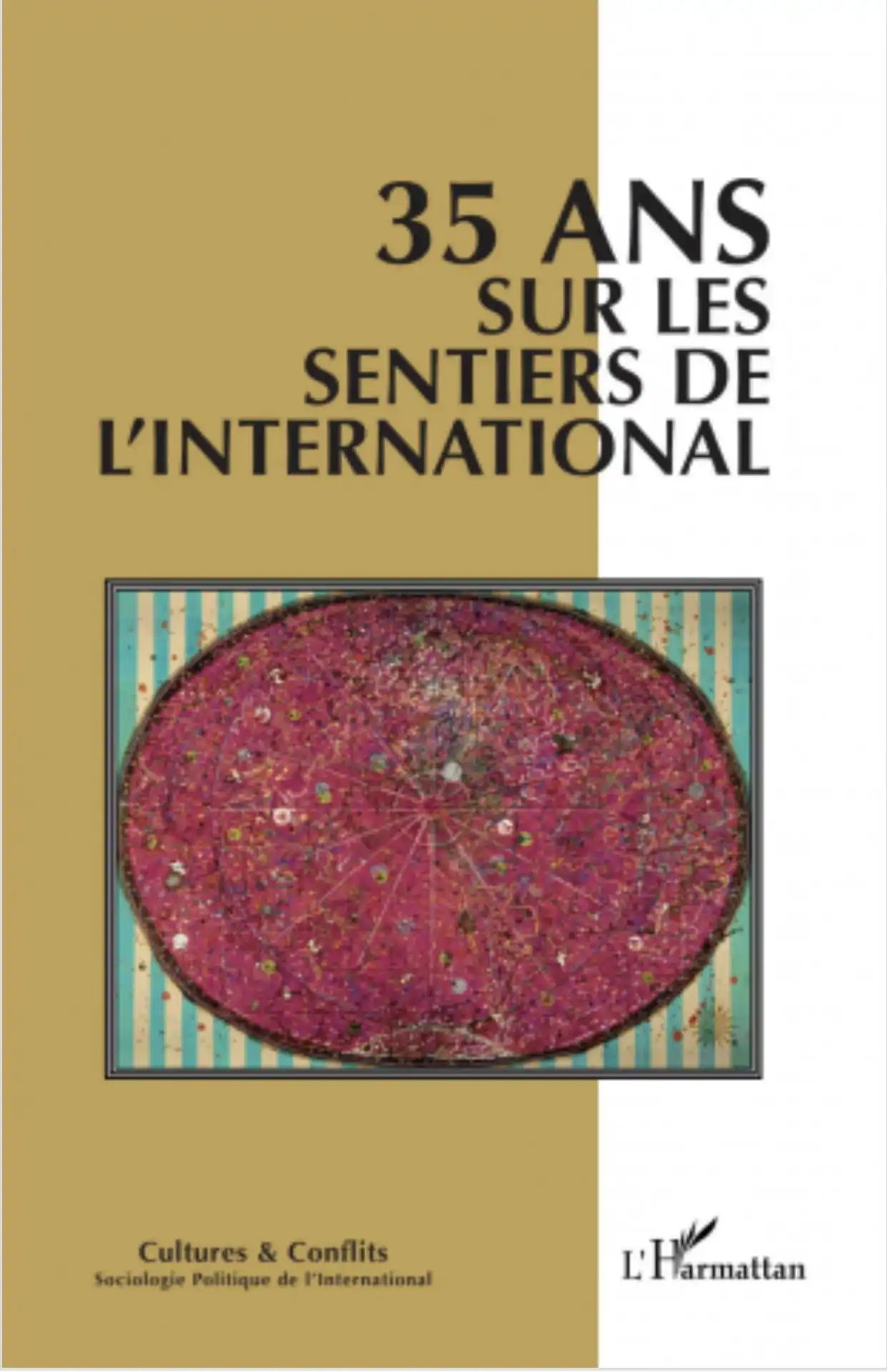
À l’heure actuelle malheureusement, on voit la résurgence de discours ultra simplistes mêlant suspicion, prédiction et politique de la peur à propos des identités, de la citoyenneté ouverte et de la migration, des formes de genre et d’ethnicité, en ignorant souvent les connaissances accumulées par la sociologie, l’anthropologie et l’histoire. Cela rend ces auteurs incapables de comprendre la complexité mais aussi les solutions structurelles possibles, pressés qu’ils sont à proposer des réponses immédiates, et souvent tirées d’une logique ami-ennemi binaire, favorisant le populisme et ces stéréotypes au cœur même du champ universitaire transnational des sciences sociales.
L’exemple le plus flagrant est celui des universitaires qui se sont déclarés trumpistes lors du premier mandat, un phénomène étudié par David Swartz et sur lequel il revient dans le dernier numéro de Cultures & Conflits.(10) Ceux-ci ont modifié leur trajectoire de carrière en se rapprochant d’une certaine forme de journalisme, de blogueurs notamment, et s’ils n’ont pas acquis, loin de là, une reconnaissance scientifique de la part de leurs pairs, leur stratégie a très bien fonctionné sur les réseaux sociaux, les plateaux de télévision et les chaines d’information continue tenues en particulier par des milliardaires réactionnaires. Leur succès tient donc avant tout à la congruence de leur temporalité réciproque. Les média qui cherchent à capter l’attention, ne serait-ce que pour une courte période, cherchent des réponses correspondant à leur format très court et très affirmatif. Cela discrédite les longues explications et la réflexion complexe sur les interdépendances des réseaux, des individus, des associations.
Très récemment, avec la montée des autocratismes et des formes populistes de droite radicale, ces personnes espèrent revenir sur la scène académique, en passant des alliances avec leurs nouveaux partenaires gagnés dans les médias et les think-tanks politiques.
Est-ce que cette popularité a des implications sur le savoir universitaire en tant que tel ?
Beaucoup d’universités et de chercheurs poursuivent leurs travaux et ont toujours pour objectif le progrès des connaissances de la complexité du social à l’échelle mondiale et des lignes transversales qui parcourent les « pluriverses », ces formes d’universalisation « latérales ». Mais les responsables politiques peuvent être séduits eux aussi par les polémiques, certes simplistes, qui influencent leurs électorats.
Ici, la force de l’université publique dans ces domaines, et celle des associations internationales (de sociologie, d’anthropologie, de relations internationales) regroupant les départements d’étude critique des processus de paix, de conflits et de sécurité (voir les cas en Allemagne, en Finlande, au Danemark, au Royaume Uni notamment) a été, pour rester crédible, d’informer que les universitaires dont les financements privés ne permettent pas leur autonomie scientifique, ne pouvaient se prévaloir d’un titre d’enseignant chercheur pour proposer des articles dont la dimension de recherche n’étaient pas prouvée.
L’indépendance, la liberté académique de la recherche de la part des centres de recherche ne peut s’accommoder de la position dominante donnée à d’anciens acteurs politiques ou à des grands entrepreneurs privés dans les nominations ou les axes de recherche. Ceci n’est pas neuf. Comme le signalait John Mueller dans son article paru dans la revue, nombre de ces études n’ont aucun intérêt à décrire les responsabilités objectives de tous les acteurs engagés dans les conflits, et ne veulent pas apparaitre comme des propagandistes. Dès lors, ils s’engagent dans des recherches « fictionnelles » que Mueller qualifie de « prolifération des scénarios catastrophes » pour entretenir une « politique de la peur ». James Der Derian(11) ajoute une autre caractéristique, avec la mise en place d’un « complexe militaro-industriel-politique » incluant aussi le « divertissement » via les chaines d’information continue, les réseaux sociaux et les développeurs de jeux vidéo dès les années 1990. Ce sont des leçons à retenir à l’heure de l’Ukraine et de la Palestine.
Les questions du financement public ou privé de la recherche, de la gestion du risque d’aller et de rester sur le terrain, de l’accès aux archives et aux « contre archives », de l’influence politique indirecte des gouvernements sont toujours présentes, et font que celle de la liberté académique dépasse de loin la simple gestion de manifestation (dite intempestive ou justifiée) lors d’événements où une contestation des décisions gouvernementales (action ou inaction) s’exprime dans les enceintes universitaires. C’est le savoir universitaire qui est en jeu. Les deux numéros de l’année 2025 s’en font l’écho, notamment celui consacré aux libertés académiques.
Comment la revue Cultures & Conflits s’est-elle positionnée au fil des ans, et a-t-elle subi de grands changements au cours de ces 35 années ?
La revue a accompagné le mouvement profond que je viens d’évoquer, en abordant les relations internationales non pas comme une sous-discipline subordonnée à la science politique mais comme un questionnement transdisciplinaire sur les objets monde, sur les logiques sociales transversales et les évolutions professionnelles qui jouent sur l’usage de la violence, sur les rapports entre idéologie, technologie, surveillance, monde numérique, sur les enjeux des communs, et la mise en place de dynamiques centrifuges où la corrélation proximité (géographique, sociale) et alliance ne fait plus sens mais peut au contraire générer des conflits entre proches, et des alliances à distance. Ce parcours d’une plus grande prise en compte du planétaire, de la multiplicité et de la complexité des mondes et des univers sociaux, qui a fait s’émanciper le questionnement de l’international des questions militaires interétatiques et de l’argument de la survie, a permis de renouveler de fond en comble l’analyse des conflits et de la sécurité grâce aux approches transdisciplinaires. C’est pourquoi la revue est à la fois un signe des transformations et une actrice de la prise en compte de nouveaux sujets grâce à l’ouverture de ses objets et de ses auteurs.
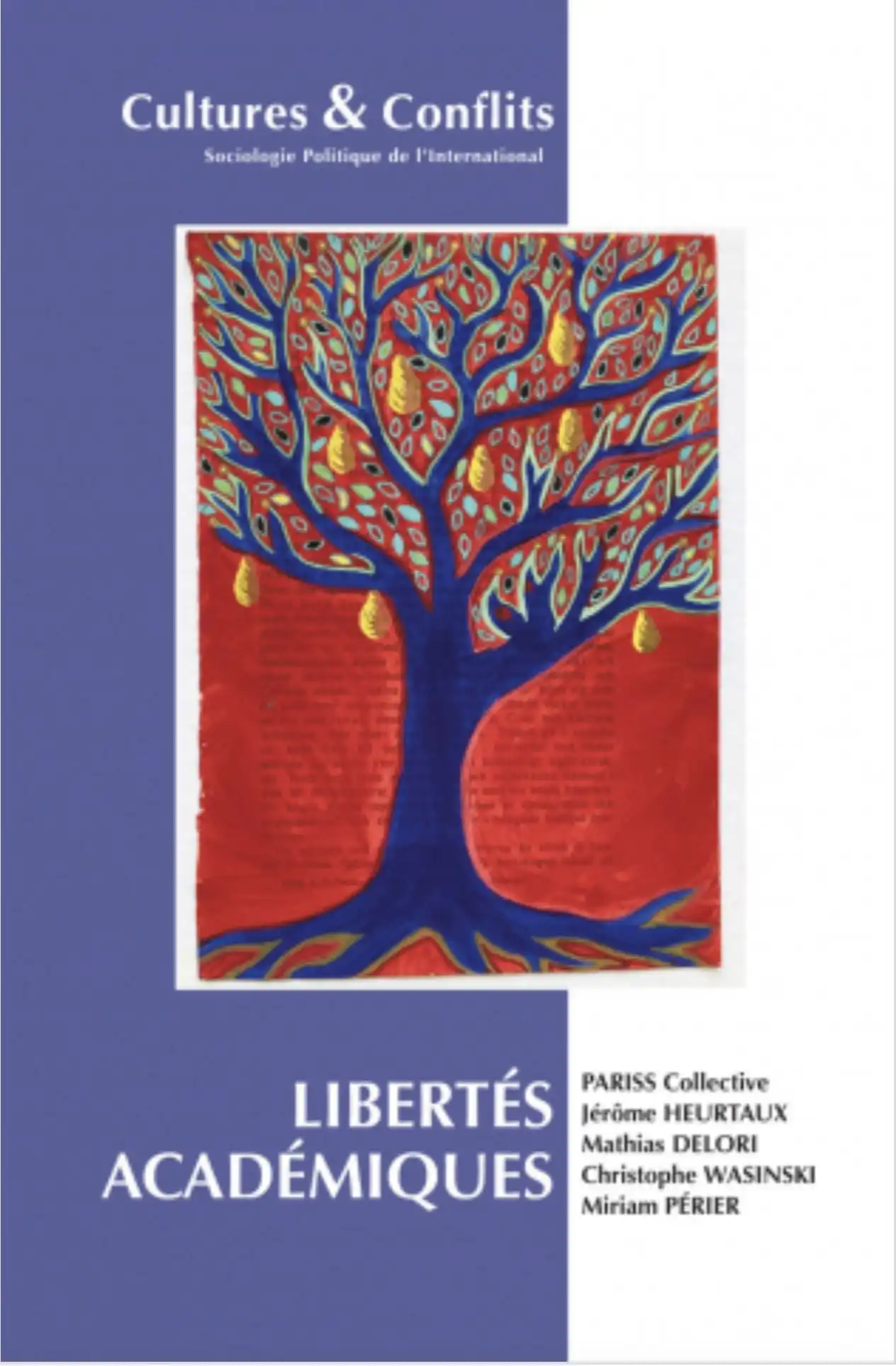
Initialement, Cultures & Conflits a été conçue pour remplacer la revue Études Polémologiques, au moment où la Fondation pour les Études de Défense Nationale voulait fondre cette dernière avec la Revue stratégique, en faisant des deux un seul outil d’analyse pour le gouvernement. Il nous a semblé que le rapprochement entre un gouvernement donné, bien qu’il apporte des financements pérennes, représentait un danger pour la liberté académique et l’autonomie nécessaire à la formulation de la question fondamentale, « désintéressée » du rapport politico-idéologique immédiat. C’est ainsi que nous avons choisi la forme d’une association loi 1901 réunissant des auteurs venant de différentes disciplines et laboratoires de recherche. Des hommes et des femmes, chercheurs au sein de la Maison des Sciences de l’Homme, de la Sorbonne, de Nanterre et de Sciences Po Paris se retrouvaient et rompaient avec les rivalités institutionnelles de l’époque. Quelques numéros significatifs sont sortis de ces rencontres et de leur concrétisation dans des Congrès de l’Association française de science politique mais aussi de l’Association internationale de sociologie (ISA) et encore plus de l’Association des études internationales (International Studies Association, ISA). Publier dans plusieurs langues (français, anglais, espagnol) était une ambition forte portée par la revue dès sa création. Après une vingtaine de numéros, Cultures & Conflits était plus connue dans le monde francophone (Canada, Belgique, Suisse) et le monde anglophone lisant le français, qu’en France. C’est ce « détour » par l’international qui a fait notre réputation avec la publication en français de grands textes d’auteurs anglophones de concert avec de jeunes chercheurs français dont l’originalité des terrains et des approches déplaisait à une certaine science politique.
On peut dire que la deuxième étape pour la revue fut sa publication en anglais comme supplément de la revue dirigée par R.B.J Walker, Alternatives, Global, Local, Political et les co-publications régulières qui s’en sont suivies grâce à d’importants contrats de recherche européens portant sur les enjeux des libertés et de la sécurité du début des années 2000, puis la création de la section International Political Sociology (IPS) et de la revue du même nom au sein de l’International Studies Association. La création de cette nouvelle revue, internationale par son attachement à l’International Studies Association, l’affiliation de ses deux corédacteurs en chef (R.B.J Walker au Canada, et moi-même), et celles des membres de son équipe, a permis la mise en place, en France, d’une réflexion épistémologique commune aux courants dits réflexifs au sein des relations internationales à l’échelle globale. Le soutien de Bruno Latour et de la Direction scientifique de Sciences Po au moment stratégique des débuts de la revue a été crucial pour développer ces lignes transversales, transdisciplinaires et transnationales. Loin de vouloir créer une « école française », il s’est agi de redéfinir les possibilités de faire, non de l’interdisciplinaire où l’on croit pouvoir accumuler les savoirs, mais du transdisciplinaire où l’on questionne les présupposés de chacune des disciplines et des objets pré-constitués de savoir, par exemple l’idée de l’association de l’international à la politique étrangère des États.(12)
Ces vingt dernières années ont été celles d’un profond renouvellement des thématiques et de générations d’internationalistes qui ont développé des réseaux européens et internationaux, qui se confrontent à diverses traditions intellectuelles et sont à même de comparer et d’imbriquer, on dit parfois de « bricoler », des approches créatives sur des sujets originaux, sur des manières de penser et d’écrire l’histoire et les sciences sociales. J’invite les lecteurs à avoir la curiosité de regarder la liste de nos titres lors de ces 35 ans et à les comparer avec les revues qui revendiquent étudier l’international via le prisme de la géopolitique, ils jugeront par eux même.
La revue a poursuivi cet itinéraire dans ce que je qualifierai de troisième étape, avec la forte complémentarité et la publication de thèmes communs entre Cultures & Conflits et la revue PARISS, acronyme pour Political Anthropological Research on International Social Sciences qui est co-éditée par Brill. Cultures & Conflits est très largement lue hors des circuits classiques de la science politique. Elle est lue par les géographes, les sociologues, les spécialistes de criminologie et des études de surveillance, les études critiques de sécurité, et aussi les départements de littérature française à l’étranger ainsi que des départements artistiques. Ce sont ces multiples regards sur l’international qui comptent et on a vu à quel point dans les événements récents en Ukraine et en Palestine, ceux qui avaient vu juste sur les conséquences de ces conflits, venaient de ces formes de savoir, indépendantes des politiques gouvernementales. Avec l’émergence d’autocraties au sein même des démocraties représentatives, il est fondamental d’associer ces points de vue pour ne pas tomber dans une rivalité mimétique, où chacun cèderait à la croyance selon laquelle l’égoïsme du plus fort est une solution. C’est ce à quoi nous avons justement contribué par notre forte présence à la convention de l’EISA à Bologne en août 2025.
Enfin et pour conclure, à l’occasion de cet anniversaire, l’équipe de rédaction de Cultures & Conflits a opéré un certain renouvellement, mais surtout, la revue change d’éditeur. Quelle est l’ambition de ces changements ?
Le compagnonnage avec les éditions L’Harmattan et le fait que nous ayons été coéditeurs de la revue durant trente-trois ans tient à cette capacité d’accueil et de soutien que Denis Pryen nous a témoigné lorsque nous avons créé Cultures & Conflits pour prendre la suite d’Études Polémologiques. Alors que La Documentation Française, qui était notre éditeur, nous demandait de payer d’avance une somme considérable à l’époque, pour lancer la revue, Denis Pryen, persuadé du bien fondé de notre démarche, nous a aidé pendant plus de cinq ans à couvrir notre déficit initial. Ensuite, grâce à nos ventes et aux soutiens de différentes universités francophones, nous avons pu établir un équilibre et même, pendant un moment un salariat, auquel nous avons malheureusement dû renoncer quand les politiques de soutien à la culture et à l’université ont commencé à se rétracter jusqu’à la situation actuelle qui pose structurellement problème à toutes les revues associatives. Par ailleurs, dans les dernières années, la mise en place des éditions en ligne, la forte diminution des abonnements des bibliothèques au format papier a changé la donne. Notre existence sous format électronique depuis de nombreuses années, notre présence depuis plus de quinze ans dans JSTOR et CAIRN nous a permis de tenir là où de nombreuses revues ont dû cesser de publier. Cela nous a dès lors récemment amené à renforcer et à privilégier notre association avec CAIRN, et peut-être Brill-de Gruyter dans le futur, pour développer la diffusion en ligne à une plus grande échelle encore. Néanmoins, la transition est difficile, et il nous faudra au moins cinq ans pour arriver à cet objectif d’une autonomie financière uniquement par les ventes. Durant ce temps, nous aurons besoin encore de l’aide de nos lecteurs et des institutions qui nous soutiennent pour passer ce cap.
L’arrivée en force de nouveaux rédacteurs et rédactrices en chef pour prendre collectivement les décisions de cette transition est fondamentale pour la revue. Elle reflète par ailleurs bien mieux la structure en termes de genre, de diversité des parcours, des disciplines d’origine et cette volonté commune de « faire du collectif ». Les premiers numéros qui sont engagés après ce numéro spécial montrent le dynamisme d’un collectif à l’œuvre, et les discussions passionnées que cela engendre avec des croisements de regards qui sont fondamentaux pour comprendre les différentes facettes et autres problèmes, tels que la liberté académique dans le monde, ou le rôle du droit international dans son rapport à la force.
Propos recueillis par Miriam Périer, CERI.
Retrouvez les numéros de Cultures & Conflits :
- Sur le site de Cairn
- Sur le site de Open Edition Journals
Retrouvez les activités du Centre d’étude sur les conflits, Liberté et Sécurité (CECLS) sur son site.
Notes
- 1.Voir notamment son ouvrage Man, the State, and War: A Theoretical Analysis, New York, Columbia University Press, 1959, mais aussi Theory of International Politics, New York, McGraw-Hill, 1979.
- 2.Cox, Robert W., “On thinking about future world order,” World Politics, no. 28.2 (1976), pp. 175-196. Cox, Robert W., “Critical theory,” International organization and global governance, Routledge, ed 2023, pp. 168-180. Voir aussi son article dans Cultures & Conflits, no. 21-22, « Territoire et interdépendance », 1996, disponible en ligne : https://journals.openedition.org/conflits/249
- 3.Pour une explication détaillée des approches critiques de la sécurité, voir « Critical Approaches to Security in Europe: A Networked Manifesto », Security Dialogue, no. 37(4) (2006), pp. 443-87. https://doi.org/10.1177/0967010606073085 Cet article fameux du CASE Collective trouve son origine à Paris en juin 2005, lors d’une rencontre organisée au CERI entre Didier Bigo, Michael C. Williams, Ole Waever, R.B.J. Walker, Jef Huysmans, et plusieurs doctorants et doctorantes de l’époque, dont presque tous étaient également membres de C&C.
- 4.Au cœur de l’analyse des conflits, se trouve la notion de violence symbolique qui montre les formes d’oppression ou de méconnaissance de la domination permettant de comprendre l’espace-temps des conflits au-delà de la violence et de la force brute. Cette notion qui varie selon les auteurs, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Charles Tilly, Philippe Braud et bien d’autres, est toujours au centre de nos analyses.
- 5.Voir en particulier Braudel, Fernand, Chatelet, François, Kriegel, Annie, et al., « Pour ou contre une politicologie scientifique, » Annales. Histoire, Sciences Sociales, no. 18(1), 1963, pp. 119-132. Disponible en ligne : https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1963_num_18_1_420955
- 6.Aron, Raymond. Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy. Voir notamment l’édition de 1984 avec sa critique des faux réalistes et des marxistes.
- 7.Comme l’explique Arjun Appadurai, loin de provoquer de l’homogénéisation et de l’identité, la mondialisation crée des disjonctions, des revendications de différences. Appadurai, Arjun. "Disjuncture and difference in the global cultural economy." in Diana Brydon (ed), Postcolonlsm. Routledge, 2023.
- 8.Voir le numéro spécial des 35 ans de la revue, qui reprend certains textes publiés au fil des ans.
- 9.Ibid.
- 10.Voir notamment son ouvrage The Academic Trumpists: Radicals Against Liberal Diversity (Routledge 2024) et son entretien paru dans Cultures & Conflits, no. 138, accessible en ligne ici.
- 11.Voir James Der Derian, Virtuous War: Mapping the Military-Industrial Media-Entertainment Network, Londres et New York, Routledge, 2009 (2e édition).
- 12.La revue IPS a maintenant 20 ans. R.B.J. Walker et moi-même sommes longuement revenus sur son rôle, dans le numéro anniversaire à paraître ; je resterai donc concentré sur Cultures & Conflits dans cet entretien.
Suivez-nous
Nous contacter
Contact Média
Coralie Meyer
Tel: +33 (0)1 58 71 70 85
coralie.meyer@sciencespo.fr
Corinne Deloy
Tel: +33 (0)1 58 71 70 68
corinne.deloy@sciencespo.fr
